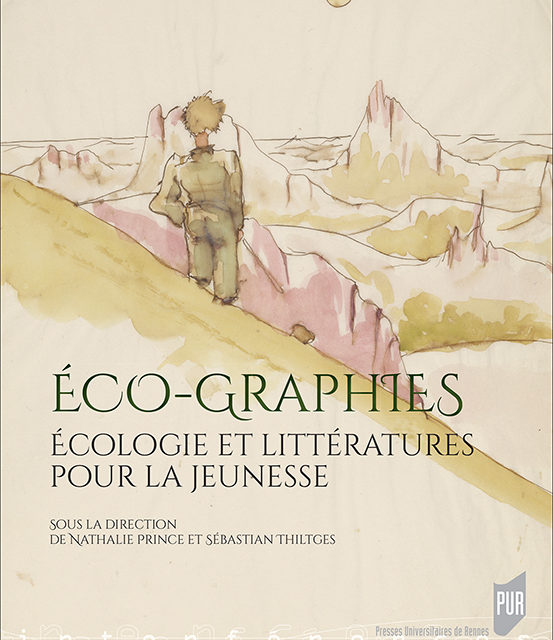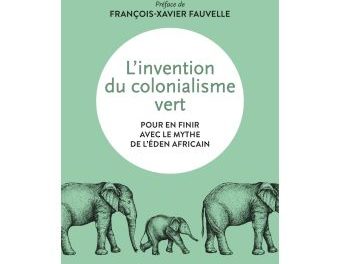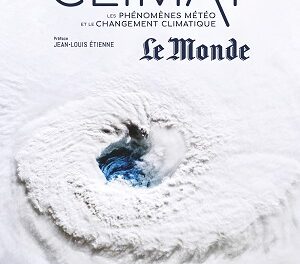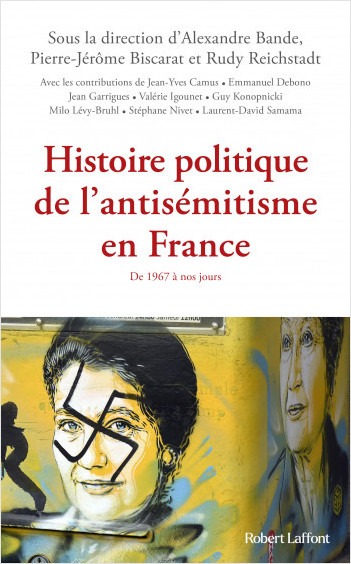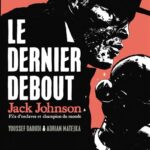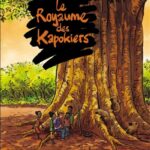L’ouvrage dirigé par Nathalie Prince, professeure de littérature comparée à l’Université du Maine, directrice du laboratoire 3L.AM, et Sébastian Thiltges, docteur en littérature et spécialiste de l’écologie dans la littérature de jeunesse, est la publication de diverses communications présentées lors de deux journées d’études, tenues les 18 et 19 juin 2015 à l’Université du Maine. Cependant, l’ouvrage est davantage qu’un simple compte-rendu de colloque ou de journées d’études. Les coordonnateurs ont pris un soin tout particulier à en faire un véritable outil de réflexion, une sorte de pièce maîtresse pour l’introduction en France d’un nouveau type de littérature pour la jeunesse qui s’intéresserait à l’écologie, à la vulnérabilité de la planète, à la biodiversité et à une « nouvelle écocitoyenneté littéraire ».
Ce qui est particulièrement appréciable dans cet ouvrage est l’homogénéité qui a été donnée à l’ensemble. Chacune des sections est introduite par un texte en italique qui permet de donner du sens à chaque chapitre et de lier les chapitres les uns aux autres. De cette manière, les directeurs de l’ouvrage entendent livrer un argumentaire conduisant à la création d’un nouveau « genre » dans la littérature de jeunesse, l’éco-littérature, l’éco-graphie ou écolije, néologisme créé par Nathalie Prince et Sébastian Thiltges pour l’occasion.
Dans La Littérature de jeunesse, Nathalie Prince parle d’un « complexe du boa[1] », en faisant référence à l’incipit du Petit Prince de Saint-Exupéry : « La littérature de jeunesse nous montre sans cesse des éléphants dévorés par des boas et les grandes personnes ne comprennent jamais rien. La nature se détériore et les grandes personnes ont mis un temps infini à comprendre. Il faut les enfants pour leur montrer cela et il faut les livres de jeunesse pour les dénoncer » (p.14). Dans cette nouvelle mouvance de la littérature de jeunesse, les enfants sont investis d’une mission, celle de sauver le monde qui n’a pas pu l’être par les adultes dont l’exemple n’est dès lors plus à suivre.
Dans l’introduction, l’écolije est abordé comme « un genre à part entière, à son tour composé de sous-genres et développant de nouvelles formes ». Le cadre théorique de l’étude, ainsi que le premier état de la question qui constituera le corps de l’ouvrage, est dressé. Éco-graphies s’inscrit dans le cadre de l’écocritique (ecocriticism). Ce courant est né dans l’ouest des États-Unis au milieu des années 1970. Cheryll Glotfelty, professeure à l’université du Nevada à Reno définit l’écocritique comme l’étude des relations entre la littérature et l’environnement[2]. Au milieu des Années 1980, les universitaires réunis au sein de la Western Literature Association érigent la « Nature writing » (éco-écrits) en tant que nouveau genre littéraire fictionnel. L’écocritique se donne alors des visées comparatives s’intéressant « aux formes, aux contextes sociaux, aux spécificités culturelles, aux lieux et aux frontières des champs littéraires et scientifiques » (p.27).
Le premier chapitre d’Éco-graphies s’intéresse à l’écogenèse et aux premières traces d’un quelconque intérêt de la littérature pour la Nature. Les auteurs rappellent combien cette dernière est omniprésente dans la littérature pour enfants depuis très longtemps. Les contes traditionnels louent les qualités bienfaitrices de la nature tout en mettant en garde l’enfant contre ses dangers objectifs. L’exemple du Fabulario (1614), conte espagnol de Sebastian Mey, montre que l’Espagne prend très tôt conscience de l’existence d’un milieu naturel complexe et fragile avec les Grandes Découvertes et les premières vagues de colonisation. Les contes de Grimm, au début du XIXe siècle, mettent souvent en scène un « imaginaire matriarcal » évoquant une Mère-Nature protectrice. Enfin, à travers les fables d’Ésope illustrées par Walter Crane à la fin du XIXe siècle, l’illustrateur britannique propose une vision idyllique d’une Grèce agraire et rurale. La Nature y reste le dépositaire immuable de la sagesse humaine. Les exemples pris dans ce qui apparaît comme des prémices de l’éco-littérature montrent davantage comment cette Nature, envisagée comme écrin que la Création a donné à l’homme pour s’épanouir, est un sujet récurent dans la littérature depuis l’Antiquité. La conclusion de cette première partie pose d’emblée un problème conceptuel : quel est le sens donné au terme « écologie » ? L’introduction du chapitre laisserait entendre qu’on prendrait le terme, au sens large, dans son acception étymologique, à savoir le logos (discours écrit) de l’oikos (la maison et tous les biens qui s’y rattache). Or, seul le dernier article propose de comprendre l’écologie au sens strict et politique, c’est-à-dire le sens qu’il prend à partir des années 1970 à travers des mouvements contestataires qui entendent alerter l’opinion publique sur les méfaits de la société de consommation qui a entrainé pollution, marée noire, réchauffement climatique, développement du nucléaire, déforestation… Ainsi, Aurélie Gille Comte Sponville, en s’appuyant sur les romans de jeunesses des Trente Glorieuses, montre-t-elle qu’une conscience écologique littéraire, stricto sensu, émerge timidement dans la dénonciation des pollutions de la ville/culture qui viennent salir la campagne/nature, « espace de l’enfance éternelle et triomphale ».
Le deuxième chapitre est consacré aux motifs et aux thèmes de l’éco-littérature et plus particulièrement, hasard ou coïncidence, dans les albums de jeunesse. L’article de Patricia Mauclair, qui s’intéresse à la production espagnole, met en évidence un certain nombre de motifs que nous pouvons également retrouver dans toutes les productions européennes, au nombre desquels nous pouvons compter la ville victime de la pollution, la peur du manque d’eau, l’arbre malade ou en danger ou encore l’animal victime de l’homme. Globalement, l’auteure constate un certain manichéisme réducteur : « le méchant humain contre la gentille nature » (p.105). D’autres thèmes viennent s’ajouter aux précédents comme celui de la cabane ou du loup contre le soi-disant « sauvage », de la cabane ou du clochard contre le soi-disant « civilisé » ; les animaux disparus comme le dodo ; ou encore la chasse. Si les albums consacrés au dodo dénoncent les effets dévastateurs de l’action humaine contre la biodiversité, ceux qui évoquent la chasse sont souvent ambigus. D’un côté, se raillant du chasseur bredouille, ils reproduisent un discours récurrent qui met en cause certaines pratiques néfastes et laissent une place de choix aux animaux victorieux. D’autres, comme le Daniel Boone de Rojankovsky (1931), font du chasseur un héros qui s’insurge contre la violence de la conquête de l’Ouest, contre les premières déforestations, la disparition des bêtes et l’extermination des Indiens. « Daniel Boone est un chasseur, il est surtout un homme en accord quasi mystique avec cette nature », écrit Florence Gaïotti (p.157).
Le troisième chapitre présente la pluralité des genres au sein d’un genre particulier qu’est l’éco-littérature. Cet emboîtement de « genres » semble assez complexe à saisir d’emblée. Ce qui est proposé aux lecteurs dans ce nouveau chapitre, c’est une sélection de quelques genres littéraires, reconnus académiquement comme tels, qui abordent la question écologique. Nous trouvons tout d’abord la fantasy qui reprend certains topoi abordés déjà dans la littérature antique, médiévale et classique. La Nature y est présentée comme un sanctuaire, comme un « lieu » associé au mystère et au sacré sur lequel la puissance de l’homme tente de s’imposer. Les fantasy dénonceraient les menaces qui pèsent sur la nature et constitueraient une « discrète éducation de la jeunesse à l’écologie » (p.188). Ensuite, Laurent Bazin passe en revue quelques romans pour adolescents dans lesquels l’écologie est questionnée. Il parvient à distinguer quatre catégories d’ouvrages : ceux catastrophistes dans lesquels un cataclysme écologique se prolonge tout au long du récit ; ceux alarmistes dans lesquels une catastrophe environnementale est le prélude à une prise de conscience ; ceux formateurs où l’accent est mis sur l’apprentissage de problématiques écologiques et enfin ceux, plus rares nous dit-on, de projets utopiques dans lesquels l’harmonie règne entre l’Homme et la Nature. Pour terminer ce troisième chapitre, trois articles s’intéressent à l’interactivité écologique dans les jeux vidéos, à la co-construction d’un discours écologique dans le théâtre pour jeunes spectateurs et enfin au récit écologique dans les contes merveilleux.
Le dernier chapitre, dans une approche comparatiste, se propose d’analyser des œuvres littéraires à la lumière de différents contextes socio-culturels, de leur réception ou de leurs univers référentiels. Ainsi, sont abordés des questions d’ordre environnemental dans la littérature de jeunesse portugaise, dans un roman contemporain grec traitant du cas des flamants roses et dans des albums de jeunesse congolais. Les deux derniers articles de ce chapitre ne nous semblent cependant pas véritablement à leur place. L’un d’entre eux étudie le thème de la mer dans la littérature pour enfants. Il nous semble que la mer constitue un « écothème » qui aurait trouvé sa place dans le deuxième chapitre. Le dernier article, que l’on doit à Edwige Chirouter, est une approche philosophique très intéressante des relations entre l’Homme et la Nature. Cet article aborde le vaste sujet de l’écologie dans la littérature, et pas simplement celle à visée philosophique. Elle en questionne tous les enjeux épistémologiques, les intentionnalités des discours écologiques ainsi que le rôle de la littérature et du récit pour « interroger le réel et le penser ». Pour l’auteure, la littérature est « comme un immense terrain de jeu où les hommes peuvent modeler, dessiner, redessiner à l’infini les situations, les dilemmes, les problèmes qui les travaillent » (p.293). L’article se termine par une sélection « très subjective car non exhaustive » d’ouvrages permettant de réfléchir avec des élèves de primaire sur les questions liées à la relation entre l’Homme et la Nature. Le contenu épistémologique et didactique de cet article nous amène à penser qu’il aurait trouvé sa place dans la partie introductive de l’ouvrage.
Pour conclure sur ce travail qui questionne pour la première fois en France la place de l’écologie dans la littérature de jeunesse, il nous semble devoir revenir sur deux points qui peuvent sembler très discutables. D’une part, l’ouvrage n’est pas conçu comme une démonstration qui tenterait de prouver que l’éco-littérature est un « genre » de la littérature de jeunesse. Il se base en fait sur un postulat qui est clairement annoncé à la page 20 : « nous nous penchons sur les textes et les images pour y déceler l’existence d’une écolije devenue un genre à part entière ». L’éco-littérature est-elle un genre ? La question reste ouverte et on aurait plutôt tendance à croire, à la lecture des motifs, des thèmes et des genres auxquels elle a recours que l’écologie est une thématique récurrente davantage qu’un genre. Toutefois, la constitution d’un genre offre-t-elle de nouvelles grilles de lecture pour questionner cette littérature qui aborde les rapports entre l’Homme et la Nature ? Nous ne le pensons pas, elle serait même plutôt sclérosante. La question qui semblerait davantage à régler serait davantage celle du champ. En effet, comme nous l’avons écrit précédemment l’éco-littérature se voit accorder un champ bien trop vaste ou tout au moins aux contours bien trop flous. Que faut-il entendre part écologie ? Lato sensu, tous les rapports entre l’Homme et son milieu ? Ou stricto sensu, l’attention portée à la vulnérabilité du monde ?
D’autre part, et pour finir, nous avons été surpris par une déclaration faite dès le préambule de l’ouvrage et qui nous a paru assez clivante. Les directeurs de l’ouvrage affirment : « Nous ne concevons pas le livre pour enfants ou adolescents comme un objet didactique ou un objet éditorial, un marqueur symbolique ou un phénomène social, mais comme un domaine de l’art, de la poésie et du littéraire » (p.9). Cette citation qui figure, rappelons-le, en première page de l’ouvrage semble vouloir réserver aux seuls littéraires la critique des romans, albums ou pièces de théâtres de jeunesse traitant d’écologie. D’une part, cette déclaration est en parfaite contradiction avec la définition donnée de l’écocritique à la page 27 (cf. supra) dans laquelle il est rappelé que cette étude s’intéresse aussi bien aux productions littéraires que scientifiques et que la lecture comparative qu’elle s’impose est de fait pluridisciplinaire. Elle est de plus en parfaite contradiction avec les différents articles de l’ouvrage qui propose des approches philosophiques, anthropologiques, sociales, didactiques et non seulement et simplement littéraires. D’autre part, comme le souligne le dernier article, « la fiction littéraire n’est pas seulement de l’ordre de l’imaginaire, elle dispose d’une fonction référentielle qui nous dévoile des dimensions insoupçonnées de la réalité » (p.292). Qu’on le veuille ou non, la littérature de jeunesse est ancrée dans le réel qui la produit, elle est, dans son essence, un objet éditorial et un phénomène social. Elle peut constituer un objet didactique tant le discours moralisateur, idéologique et/ou intentionnel participe de sa création. En 1995, lorsque Lawrence Buell tente à son tour de définir l’écocritique, il ajoute une autre dimension à celle donnée par Glotfelty. Il fait de l’écocritique un acte performatif en le définissant comme une étude « conduite dans un esprit d’engagement aux pratiques environnementalistes[3] ». L’éco-littérature intéresse donc aussi bien le sociologue, l’anthropoloque, le géographe et l’historien que le littéraire, le poète ou l’élève.
Christophe Meunier
[1] Nathalie Prince, La Littérature de jeunesse, Paris : Armand Colin, 2010, p. 136-137.
[2] Cheryll Glotfelty, Harold Fromm (dir.), The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens : University of Georgia, 1996.
[3] Lawrence Buell, The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press, 1995.