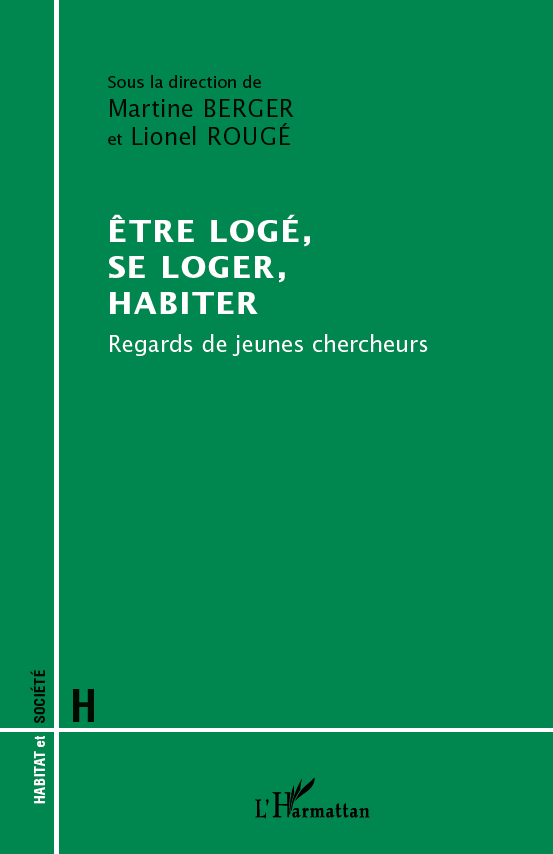
Issues de deux journées organisées en 2005 et en 2007 par le laboratoire LADYSS, les contributions ici rassemblées ont toutes pour point commun de présenter le stade de réflexion de jeunes chercheurs doctorants ou post doctorants sur la thématique de l’Habiter. Inscrite aux programmes scolaires (programme de géographie de sixième) depuis 3 ans, ce concept témoigne d’une évolution épistémologique touchant à la fois la géographie, l’histoire, la sociologie et l’ethnologie. Une conception large de l’habitat et de l’habiter est retenue. La distinction villes – campagnes, dans le cadre de cette thématique n’a plus lieu d’être « lorsqu’il s’agit d’analyser les stratégies résidentielles et les pratiques spatiales des ménages. »
L’ensemble des contributions est organisée en deux parties aux titres assez énigmatiques et peu encourageants. La première partie, intitulée : Quand les pratiques et les politiques s’ajustent, vise à mettre sur l’accent sur les politiques publiques en œuvre et sur les acteurs. Dans les faits, c’est passionnant à lire. Cela commence par le métier d’agent immobilier pour ensuite glisser vers celui des bailleurs sociaux afin d’aborder la question de la rénovation urbaine. Puis, la seconde moitié de cette partie est consacrée à l’autre pendant de la question plus connue : celle de la gentrification. Ces articles sont riches d’enseignement car ils dévoilent des aspects méconnus de la question du logement.
Les stratégies territoriales des agents immobiliers sont analysées selon qu’ils travaillent en réseau franchisé (type Century 21) ou en indépendants. La pratique du mandat exclusif ou libre est décryptée selon le type de réseau auquel appartient l’agence. Instructif pour ceux qui ont un bien à vendre ! Le texte de Pascale Dietrich-Ragon, contenant des tableaux au contenu énigmatique (cf. tableaux de régression), pose une question fondamentale : celle de l’attribution du logement social. Elle décrypte les mécanismes traditionnels d’attribution (mérite, logique des statuts, respect de la loi) qui sont bafoués lors des relogements intervenant suite à des problèmes d’insalubrité. Pour faire face à l’urgence de la situation, l’ordre des demandes est modifié et favorise ceux qui étaient en situation de squat, surtout quand ils ont des enfants. L’auteur ne prend pas position et donne la parole aux habitants demandeurs de logements sociaux qui vivent cela comme une injustice. Un autre article (celui de Sophie Bretesché) décortique la réforme opérée au sein des organismes HLM dans le but d’une rationalisation du travail : mise en place des centrales d’appel. Si certains salariés appliquent les consignes de la direction à la lettre (envoi cadencé de lettres de rappel), d’autres le font aussi mais cherchent à ménager des temps pour recevoir en direct les locataires qui ont des problèmes d’impayés. Ils créent du lien, dans un système qui ne le valorise pas (notamment parce que ces actions ne sont pas évaluables et chiffrables). La politique de la ville, y compris Loi Borloo, est analysée dans le cadre mal connu des copropriétés en difficultés de Clichy/Bois et Montfermeil. Le processus de paupérisation est lié à un fort taux d’endettement qui empêchent les propriétaires de payer les charges et les investissements nécessaires dans la copropriété. Les mesures mises en œuvre ont été multiples mais leurs résultats sont bien peu probants. Au final, ces courts chapitres traitant de rénovation du logement social sont plutôt pessimistes. Le ton est finalement assez proche pour les articles qui portent sur les processus de gentrification. A partir d’un exemple moins connu que celui de Montreuil (étudié par Anaïs Collet), Marie Chabrol et Anne Clerval analysent les processus de gentrification à proximité du métro Château Rouge (à proximité de Barbès) ou de l’impasse Cour de Bretagne (X° arrondissement). Si le patrimoine immobilier a été considérablement valorisé depuis les années 2000, l’emploi du terme mixité sociale reste vain. Les nouvelles catégories socioprofessionnelles (issues des classes moyennes à tendance créatrice) ne se sont pas appropriées le quartier investi. Elles ne fréquentent pas les commerces ethniques du quartier et entretiennent un « entre soi » exclusif qui se traduit spatialement par la mise en place de portillons fermés à l’entrée de l’impasse. Politiques publiques, stratégies privées ont bien du mal à mettre en place du lien et la mixité sociale voulue par tous, y compris par les gentrificateurs eux-mêmes.
La seconde partie du volume : Concepteurs, habitants : s’approprier des lieux et des modèles traite du point de vue des habitants, eux-mêmes, même si un article, assez compliqué de Marilena Kourniati, revient sur les propositions faites par le groupe Team 10 (groupe d’architectes issus du mouvement moderniste) pour rénover les principes de la Charte d’Athènes. De nombreuses études de cas sont exposées dans cette partie. L’approche historique est retenue par Olivier Berger à partir du cas du Parc d’Ardenay (Essonne) à Palaiseau. Dans ce parc de 9 hectares, ont été construites dans les années 1950 des résidences collectives de grand standing pour l’époque dont les appartements ont été achetés par des catégories socioprofessionnelles assez homogènes : fonctionnaires, membres du CEA, enseignants, nombreux rapatriés d’Algérie… Le parc d’Ardenay est surnommé par les habitants de Palaiseau « la cité des Polytechniciens ». Olivier Berger analyse comment les habitants d’Ardenay sont vus par les habitants locaux mais aussi comment ceux-ci se voient. Ce différentiel est surtout le fait des premières décennies. « Aujourd’hui plus aucune barrière ne les sépare des Palaisiens. Le Parc n’étant plus nouveau, il n’est donc plus porteur d’une nouvelle identité. » Le point de vue des habitants est aussi celui retenu par Sabrina Bresson, sociologue, qui travaille, dans une optique historique, sur deux ensembles collectifs : l’unité d’habitation de Le Corbusier à Rezé et les Etoiles de Jean Renaudie à Ivry-sur-Seine. L’approche par les ressentis des habitants permet bien de rendre compte de ce qu’est habiter un espace. La place du jardin et des espaces collectifs dans des petits ensembles d’habitat collectif est une autre clé d’entrée dans la problématique de l’habiter. Ainsi, Magali Paris s’intéresse à la manière avec laquelle les habitants s’approprient leur balcon, leur bout de cours par la pratique du jardinage. « (…), habiter son jardin c’est s’adapter à une situation et l’adapter à soi à travers différentes modalités d’interactions plus ou moins hospitalières ou plus ou moins défensives. » Le jardin est un lieu « synthétique » : « Michel Foucault (1967) le qualifiait d’hétérotopie : capacité d’un lieu à rassembler en son sein plusieurs espaces en eux-mêmes incompatibles. Selon lui, le jardin est la forme la plus ancienne des hétérotopies, la plus petite parcelle du monde qui rassemble en son sein la totalité du monde. » Valérie Lebois, elle, s’intéresse aux espaces collectifs : cour – jardin d’habitat social à Paris et sur le rôle tenu par ces espaces dans la vie collective de la résidence. Ces espaces sont une alternative à la ville dense. Pour cela, il est nécessaire de réunir plusieurs conditions : le calme, l’impression d’espace, la lumière, la présence de végétation. Si l’auteure met bien en avant que, trop souvent, ces espaces sont considérés par les maîtres d’ouvrage comme des espaces inutiles car non rentables financièrement, elle n’aborde pas l’appropriation de ces espaces par des individus extérieurs aux résidences : jeunes qui viennent squatter bruyamment la nuit ces espaces au mépris du repos des résidents. Au-delà d’autres articles qui traitent de la question d’habiter dans des champs géographiques divers (Maroc, Hongrie, Burkina Faso), l’article de Nathalie Ortar approche, par le biais des résidents secondaires, la question de l’habiter selon le concept de l’ancrage qu’elle a précédemment développé dans la lignée des travaux de J. Remy (1996). Posséder une maison de vacances est central pour pouvoir avoir un ancrage, surtout dans le cas de mobilités professionnelles non choisies. « La maison est utilisée comme un épicentre de la vie familiale. Elle représente une attache, une référence dans la vie familiale qui permet d’aller de l’avant vers de nouveaux projets et surtout de nouvelles destinations professionnelles. » C’est tout le paradoxe de la question des mobilités appliquée à notre société. Etre mobile nécessite d’être « de quelque part » : l’habitat permanent ou secondaire participe à la construction de l’identité.
Catherine Didier-Fèvre © Les Clionautes





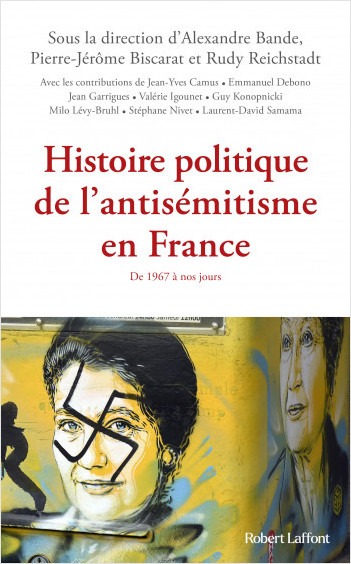




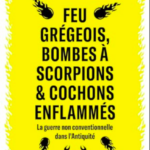



Bonjour j’ai été tres intéressée de lire il y a quelques années le travail du sociologue Olivier Berger sur le bois d’Ardenay .En effet, j’ai vécu plusieurs années dans ce lieu, mes parents revenant du Maroc en 1956. Tout semblait bien analysé.
Maintenant retraitée depuis peu j’aimerais interroger la question du protectorat marocain. Je vois qu’aujourd’hui de nombreux historiens de nationalité marocaine s’emparent de ce sujet et c’est positif. Mais je vois là un sujet pas encore vraiment exploré à partir des archives nationales, sauf erreur. il faut dire que les délais légaux viennent juste de s’ouvrir. Avez-vous des collègues ou connaissances que je pourrais contacter?