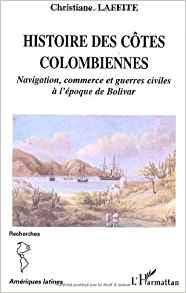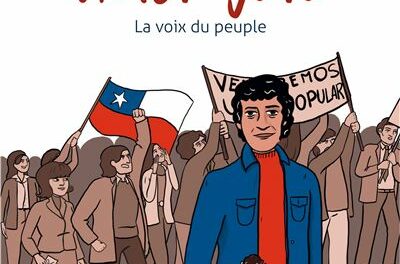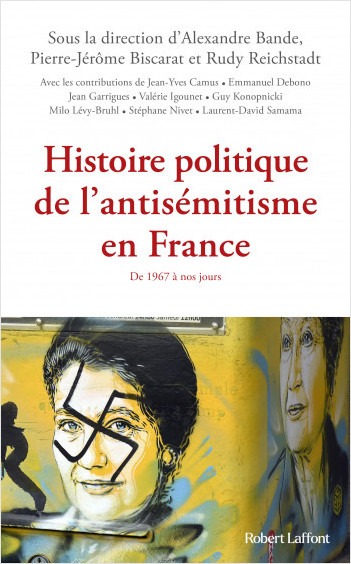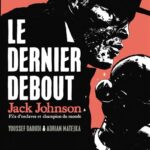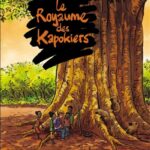Christiane Laffite, maître de conférences à l’Université de Paris-Sorbonne, est spécialiste de l’histoire de la Colombie, et en particulier de son littoral caraïbe à l’époque des Indépendances. Le titre du livre dont nous rendons compte ne doit pas égarer : les « côtes colombiennes » ne concernent en fait que la façade caraïbe de l’actuelle Colombie (la façade pacifique est exclue du champ de l’étude); le propos n’est que partiellement élargi à la Grande Colombie, cette construction précaire qui regroupa, entre 1819 et 1830, la Nouvelle-Grenade (Colombie), le Vénézuéla, l’Equateur et le Panama. Toutefois, cette « Histoire des côtes colombiennes » comble a priori un vide dans l’historiographie française de la Colombie, plutôt focalisée sur les régions andines. Le livre, divisé en trois parties sensiblement équilibrées en nombre de pages, comporte une chronologie, une bibliographie et un index onomastique.
Dans la première partie, Christiane Laffite passe en revue les principaux ports des littoraux continentaux de la Caraïbe, depuis la côte vénézuélienne (avec La Guaira -port de Caracas-, Puerto Cabello et Maracaibo) jusqu’à la côte panaméenne (avec la place déchue de Portobelo) en passant par la côte néo-granadine (avec Riohacha, Santa Marta et Carthagène des Indes).
À la veille de l’indépendance, La Guaira et Carthagène dominaient sur le plan commercial : c’est par Carthagène que transitaient les richesses du vice-royaume de Nouvelle-Grenade, avant d’être expédiées vers la métropole; la fortune commerciale de La Guaira reposait, quant à elle, sur le cacao, produit phare de la province de Caracas. Carthagène et Puerto Cabello jouaient aussi un rôle militaire essentiel, en tant que ports fortifiés.
L’attention portée à Carthagène, tout au long de l’ouvrage, se justifie pleinement : Carthagène était la première place militaire de la Caraïbe espagnole après La Havane, et, sans conteste, le pôle économique du vice-royaume de Nouvelle-Grenade; et c’est autour de Carthagène que se joua en partie le destin des républiques indépendantes de Nouvelle-Grenade et du Vénézuéla…
En dépit d’aléas, la prospérité de Carthagène au cours du second 18ème siècle fut continue. Cette prospérité était bien sûr liée au commerce (commerce extérieur à destination de l’Espagne, commerce négrier, cabotage) mais aussi, et surtout, au rôle militaire qui lui faisait bénéficier, pour l’entretien des fortifications et de la garnison, d’une part notable du produit fiscal tiré des autres provinces néo-granadines. La disparition de ce dernier avantage qui excitait la jalousie des cités néo-granadines (Santa Marta en particulier) allait notamment entraîner une grave crise financière dans les débuts du processus d’indépendance. On pourra regretter que, globalement, le plan adopté ne fasse pas mieux ressortir les principales évolutions qui ont affecté les régions étudiées entre le milieu du 18ème siècle et la veille de l’Indépendance et que la nature et les enjeux des réformes bourboniennes n’aient pas été présentés de manière synthétique.
Dans la deuxième partie, Christiane Laffite recentre son propos sur la Côte Ferme, autrement dit le littoral de l’actuelle Colombie, et montre bien que le commerce souffrait des difficultés de communication entre certains secteurs de la côte (les communications entre Maracaibo et Riohacha par exemple étaient rendues difficiles par la présence des belliqueux Guajiros que la puissance espagnole ne parvint jamais réellement à soumettre) comme entre la côte et l’intérieur : pour acheminer des marchandises depuis Santa Marta jusqu’à Santa Fé de Bogotà, via Carthagène, il fallait emprunter le Canal du Dique, à la navigabilité aléatoire, et remonter le Rìo Magdalena sur des bateaux qui avançaient au gré des humeurs de l’équipage…
Le commerce officiel devait en outre subir les préjudices causés par les activités des contrebandiers : la contrebande était facilitée par le niveau souvent prohibitif des droits de douane, par la complicité plus ou moins passive de certaines autorités, par l’existence de franges côtières peu surveillées et par la présence non loin des côtes de Terre Ferme de véritables « repaires de contrebandiers », comme l’île hollandaise de Curaçao. Les guerres qui ravagèrent le littoral au cours des décennies 1810 et 1820 allaient contribuer à l’explosion du commerce de contrebande, et les mesures prises par les autorités ne parvinrent pas à enrayer cette dynamique… Au cours de ces années, les liaisons entre Carthagène, acquise à l’indépendance, et la métropole allaient s’interrompre, tout comme les activités du Consulat de Carthagène entre 1810 et 1816. La reprise de conditions normales d’activités maritimes et commerciales, une fois terminés les conflits (1821 pour la Nouvelle-Grenade, 1823 pour le Vénézuéla), ne permit pas de renouer avec la prospérité d’antan. Le commerce de Carthagène stagna et fut dépassé, et de loin, par celui de La Guaira, comme le révèle l’analyse comparée de la valeur des trafics respectifs des deux ports entre 1827 et 1829.
Carthagène est donc sortie particulièrement éprouvée des guerres de l’indépendance; les deux sièges qui l’ont meurtrie (en 1815 et 1821) ont même entraîné une baisse de moitié de sa population! C’est d’ailleurs vers la population de la côte que Christiane Laffite tourne ensuite son regard. Elle nous dépeint une société dominée numériquement par les populations noires (libres ou esclaves) et métisses (comme les zambos de La Guajira, aux confins de la Nouvelle-Grenade et du Vénézuéla). L’élite « blanche », formée de Créoles et de Péninsulaires, était, bien entendu, très minoritaire. Au-delà de ce constat, on aurait aimé trouver une véritable esquisse d’histoire sociale et culturelle des territoires côtiers de la Nouvelle-Grenade : or l’auteur se contente de passer en revue, et sans relier ces volets entre eux, « la religion », « les coutumes de la côte », « la classe dirigeante » et les « établissements et moyens culturels »… Le propos se révèle alors trop souvent dépendant de sources descriptives, comme les récits ethnographiques de l’époque émanant d’observateurs néo-granadins ou étrangers. Quand la nécessaire distance critique fait défaut, de regrettables dérapages se produisent : ainsi, pour ne donner qu’un exemple, lorsque Christiane Laffite qualifie la franc-maçonnerie de « secte » (pages 177 et 182)… Par ailleurs, l’évocation du monde des élites, a priori le mieux documenté en termes de sources, est décevante : l’auteur montre que l’élite côtière participa activement à l’indépendance de la Nouvelle-Grenade, puisqu’un tiers des 28 personnalités ayant compté à l’époque était originaire des régions de Carthagène et Mompox (la figure de José Ignacio de Pombo, prieur du Consulat de Carthagène et fondateur de l’école de marine militaire, traverse par exemple l’ouvrage à de nombreuses reprises), mais l’analyse en termes de sociabilités n’est qu’effleurée.
Les guerres d’Indépendance sont plus spécifiquement abordées dans la troisième partie. L’auteur revient sur les causes et motifs de l’indépendance à travers les jugements des principaux ilustrados colombiens, mais ces sources ne sont jamais analysées à la lumière des avancées récentes de l’historiographie (il n’est pas fait mention du concept de « révolution hispanique » ni de son rapport aux « révolutions atlantiques »). Dans le contexte régional de la côte néo-granadine, les guerres sont présentées sous un angle événementiel (mais sans céder aux dérives « épiques » d’une certaine tradition historiographique) : c’était inévitable, même si l’on aurait apprécié que l’histoire régionale soit par moments mieux connectée aux grandes séquences de l’indépendance de la Nouvelle-Grenade (une première République gâchée entre 1810 et 1816, la « reconquête » et la « Pacification » royalistes de 1816 à 1819, puis la conquête définitive de l’indépendance néo-granadine de 1819 à 1821; la périodisation diffère un peu pour le Vénézuéla, mais l’indépendance est définitivement acquise avec la prise de Puerto Cabello en 1823).
L’auteur montre que les guerres des années 1810-1820 furent à la fois des « guerres d’indépendance », en tant qu’entreprises de lutte contre la domination coloniale espagnole, et des « guerres civiles » (le concept méritait d’être discuté). À cet égard, l’auteur rappelle que le processus d’émancipation a révélé au grand jour les « patriotismes » régionaux et locaux : paroxysme de la rivalité (militaire, commerciale, douanière) entre Santa Marta la loyaliste et Carthagène l’indépendante; conflits sévères entre centralistes (autour d’Antonio Nariño et de l’Etat souverain de Cundinamarca, capitale Santa Fé de Bogotà) et fédéralistes (Camilo Torres et la Confédération des Provinces-Unies de Nouvelle-Grenade). Les futurs partis libéral et conservateur colombiens trouvent leur origine dans ce contexte, même s’ils ne recouvrent pas le clivage entre fédéralistes et centralistes.
Quant à Carthagène, elle constitua sans doute l’enjeu majeur des guerres dans cette partie de la Nouvelle-Grenade : les forces de l’expédition commandée par le général espagnol Pablo Morillo en entreprirent le blocus, à la fois terrestre et maritime; la ville, qui avait à maintes reprises dans le passé résisté aux attaques de l’ennemi (pensons notamment à la tentative avortée des Anglais en 1741) se rendit en décembre 1815, après deux mois de siège. La reconquête de Carthagène (définitive en 1821) était vitale pour les « patriotes » puisqu’elle conditionnait en partie la libération définitive de la Nouvelle-Grenade comme de celle du Vénézuéla. C’est à cette occasion qu’allait s’illustrer la « marine de guerre » colombienne, principalement constituée de bâtiments rapides, tels que brigantins et goëlettes, à la tête desquels se trouvaient de nombreux corsaires (parmi lesquels des Français, comme les fameux Jean Laffite, René Beluche ou Louis Aury, le grand rival de Brion, promu commodore de la marine colombienne). Ces flottes et ces personnages, auxquels Christiane Laffite consacre des pages suggestives, ont joué un rôle notable dans la « libération » de la Nouvelle-Grenade et du Vénézuéla, mais n’écartons pas les facteurs liés aux événements internes à la métropole : par exemple, la déroute espagnole dans les années 1820-1823 pouvait sans doute être en partie analysée en relation avec les conséquences du pronunciamiento de Riego en Espagne.
L’ouvrage de Christiane Laffite se termine par une conclusion dont on attendait qu’elle dégage les principaux acquis de cette recherche; au lieu de cela, nous lisons des considérations relatives aux difficultés socio-économiques de la Colombie du début des années 1990, qui peuvent surprendre dans un tel livre publié… en 2003. Il semble en fait qu’on ait affaire à la reprise en français d’un ouvrage -issu d’une thèse- déjà publié en Colombie (Christiane Laffite-Carles, La Costa colombiana del Caribe (1810-1830), Bogotà, Banco de la Repùblica, 1995, 332p.). La bibliographie semble en partie confirmer notre hypothèse car aucun titre postérieur à 1990 n’y figure : dans le strict domaine de l’historiographie colombianiste, des auteurs anglo-saxons marquants, comme Anthony McFarlane, ne sont pas cités. Les thèmes centraux de l’étude (navigation et commerce) intéresseront sans nul doute les spécialistes de ces questions, mais on notera qu’ils ne s’inscrivent pas dans les préoccupations actuelles de l’historiographie des processus d’Indépendance de l’Amérique latine, orientée dans la perspective d’une histoire socio-politique conceptuellement renouvelée (nous pensons en particulier aux travaux impulsés par le regretté François-Xavier Guerra).
Copyright Clionautes