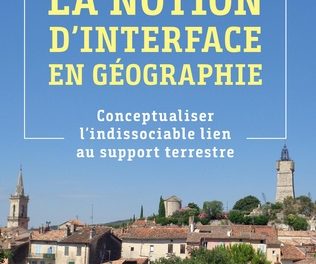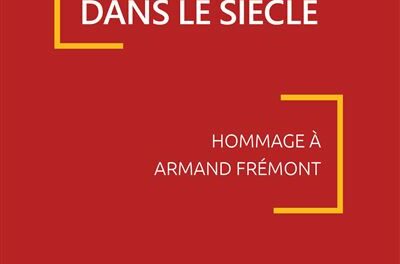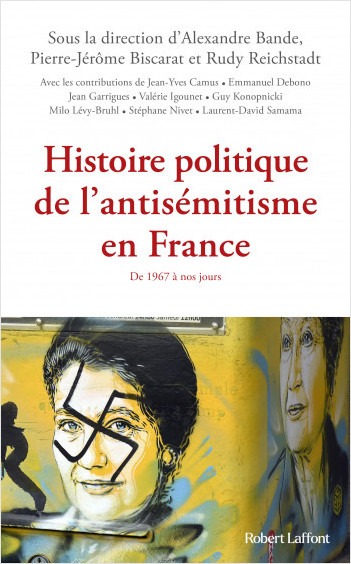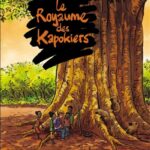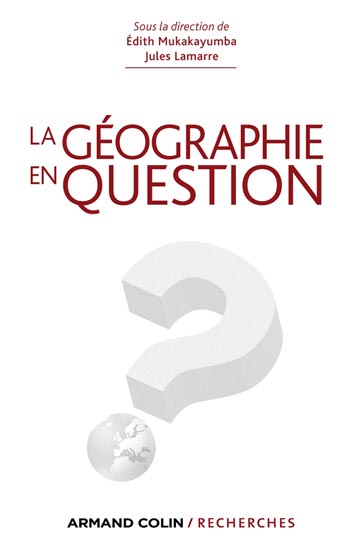
Réunissant 20 contributions d’auteurs aux profils variés, ces actes issus du colloque « Qu’advient-il de la géographie ? » organisé au Québec au printemps 2011 permettent de faire le point sur les tourments de la discipline, son adaptation aux questions spatiales contemporaines, mais surtout sur son (manque de) recul institutionnel.
Des avis concordants
Qu’ils soient tirés dans la première partie sur « les maux de la géographie », de la seconde sur « la prise en compte des contextes nationaux » ou de la troisième sur « le cas québécois », les constats sur la mauvaise santé de la discipline semblent clairement partagés :
– un monde saturé d’images dans lequel la géographie n’est plus la seule pourvoyeuse (comme le rappelle Paul Claval « familiarité n’est pas connaissance » – p 32),
– la dérive technologique ou quand l’outil (cartographie, SIG, géomatique, télédétection…) prend le pas sur la discipline elle-même,
– l’absence des géographes du débat public,
– la quête permanente des financements et des publications de hauts rangs (comme l’évoque Jules Lamarre, p 233, « pourquoi vouloir devenir des producteurs d’articles pour « des revues que personne ne lit » ?),
– un décalage trop grand entre les enseignements généraux du premier cycle universitaire et les attentes des étudiants (ces enseignements n’étant pas si généraux que cela puisque dépendants des thèmes de recherche des enseignants les dispensant),
– et bien sûr, en toile de fond, les querelles entre spécialités, dont l’irréconciliable entre humanistes et physiciens.
L’impossible carrière ?
Après ces constats et avant d’évoquer quelques pistes d’avenir, il apparaît plus que légitime d’accorder un bon développement aux parcours des deux auteurs ayant dirigé cet ouvrage, Jules Lamarre et Edith Mukakayumba.
On ne connaît que trop le parcours du combattant des prétendants aux différents postes permettant une titularisation dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cet ouvrage nous permet de découvrir la situation du Québec qu’on mettra aisément en relation avec le cas français. Combien sont-ils, Combien sommes-nous même… docteurs félicités et qualifiés, ayant répondu à l’exercice de l’enseignement et de la publication et pour qui il manque toujours la ligne superflue (la bonne (hyper)spécialisation, la maîtrise de l’anglais, le passage en ENS ou par l’agrégation, le relationnel…) permettant de faire la différence ?
Ce qui est particulièrement douloureux dans les témoignages de nos deux collègues, c’est que le combat a duré presque une vie, ballotés de contrats temporaires en missions de second rang le tout, et c’est bien là le pire, avec cette reconnaissance de la qualité de leurs travaux et de leur personne, notamment par des personnes n’y connaissant rien, jusqu’au fameux jour où…le coup de grâce d’être devenu véritablement indésirable tombe. Mais, nous le verrons plus tard, à la violence du traitement a su répondre la ténacité de vouloir renaître dans d’autres sphères.
Il est évident que le système engendre un gaspillage des cerveaux de par le simple fait de diplômer massivement des docteurs sans leur assurer embauche et carrière et ce, tant dans le milieu académique que d’autres domaines. Dès lors, faut-il abandonner ? Insister ? Faire des concessions ? Ou essayer de devenir un « passeur » en s’intéressant à un autre niveau d’enseignement ? La situation devient tellement absurde et dangereuse que certains déconseillent carrément de se lancer dans une thèse pour ne pas avoir à traîner, par la suite, cette ligne du CV comme une véritable tâche sur un casier judiciaire.
Si la citation mobilisée ici, celle de Jonathan Katz (1999), « Je connais plus de gens talentueux dont la vie a été ruinée par un Ph.D, que par la drogue » est sans doute un peu extrême, il est nécessaire de s’arrêter sur la liste de Jules Lamarre, celle des raisons qui montre que la simple démarche d’aller chercher du travail ailleurs après une thèse sera inévitablement semée d’embûches :
– un employeur préféra embaucher à diplôme moins élevé pour ne pas avoir à rémunérer à niveau docteur, logique,
– si l’on accepte un emploi moins qualifié, on s’exposera aux railleries des collègues qui percevront le candidat comme un raté dont l’université n’aura pas voulu,
– pourquoi embaucher un docteur qui quitterait le navire dès qu’une offre en université lui serait faite ?
– si l’on passe sous silence ses années de thèse, le vaste trou dans le CV semble injustifiable (fausse oisiveté mal jugée par l’employeur),
– pourquoi engager un vieux lorsqu’on peut prendre un jeune ?
Signe que le problème est profond, des expressions pour décrire ces phénomènes existent déjà, ce « Ph.D trap » donc mais aussi le « Postdoc Trap » qui, lui, consiste à sans arrêt accepter des contrats à durée déterminée sans jamais caresser l’espoir d’être titularisé ensuite.
Dernier élément, lui aussi pour le moins choquant, celui de l’évaluation des étudiants : si les professeurs titulaires ont toute latitude pour noter comme bon leur semblent leurs étudiants et notamment « descendre » ceux qui le méritent, les professeurs comblant les trous, ces « part-timers », se doivent, ce n’est écrit nulle part, de noter correctement leurs élèves, même les plus mauvais, pour continuer à leur « plaire » et à les « divertir » sous peine d’être mis à la rue !
Une discipline évidemment utile, particulièrement aujourd’hui
Comment se rassurer dès lors ?
Déjà en constatant que la géographie n’est pas la seule en crise, voir l’analyse de Eric Waddell qui montre que l’histoire n’est pas « payante », que l’anthropologie peine à reformuler son objet d’étude, que la chimie et la physique n’attirent pas assez les étudiants ou que la télédétection a rendu certains étudiants en géologie superflus.
Mais surtout en reconsidérant correctement la définition de la géographie et son utilité dans le monde contemporain. Des définitions simples et pertinentes se retrouvent ça et là dans l’ouvrage :
– Yannick Brun-Picard n’a-t-il pas tout à fait raison lorsqu’il énonce que la géographie a une importance considérable dans nos existences, que « chaque déplacement est un acte géographique, qu’à chaque espace terrestre est associée une activité anthropique pour parvenir à une réalisation » (pp 62-63) ?
– Lucie Dufresne, qui a mis à profit son parcours de géographe pour écrire des romans historiques, n’est-elle pas non plus dans le vrai lorsqu’elle dit que « la contradiction est frappante entre la science et son objet : la géographie qui se cherche et le territoire qu’on s’arrache ? » (p 273) ?
– Rodolphe De Koninck enfin, n’a-t-il pas non plus résumé la question en louant « l’immense capacité d’analyse multiscalaire qu’elle confère à celui qui sait s’inspirer de la géographie pour critiquer et reconstruire le monde ? » (p 28) ?
L’utilité de la discipline n’est pas à démontrer. Notre monde actuel est complexe et les géographes sont à même de le comprendre et l’expliquer.
Mais des exemples de l’absence de parole des géographes dans les grandes questions publiques ou de manque de culture géographique des décideurs sont pointées du doigt. En effet, si Rodolphe De Koninck dit que les géographes « brillent trop souvent par leur absence, notamment dans la résolution des problèmes liés à l’établissement des frontières » (p 29), Bertrand Lemartinel et Louis Marrou constatent, quant à eux, que si le fait que Cécile Duflot avait placé le Japon dans l’hémisphère sud pouvait relever du coup de fatigue, « il est plus difficile d’accepter l’ignorance d’un risque majeur comme l’inondation lorsque l’on prétend étendre une zone constructible ou la méconnaissance profonde de la géographie sociale d’une banlieue quand on souhaite mettre en place une politique de la ville » et d’ajouter « on aurait bien tort de penser que ces lacunes sont le fait de quelques-uns seulement ».
Sur l’enseignement
Avant d’ouvrir, il est important de dire un mot sur l’étude des contextes nationaux qui cherche à dépeindre les conditions d’enseignement à différents niveaux (Laurent Deshaies pour le Canada, Christian Vandermotten pour la Belgique et Yvette Veyret pour la France).
Si chacun des trois auteurs retrace avec soin historique et défis actuels de l’enseignement de la géographie dans les sphères secondaire et supérieur, on restera sur notre faim au sujet de l’enseignement primaire, sempiternelle dernière roue du carrosse mais pourtant, lapalissade, chronologiquement en amont du reste.
Yvette Veyret n’en dit pas mot alors qu’elle avait pourtant contribué à la rédaction de documents d’accompagnement intéressants lors de la parution des programmes de 2002 et que dire de la phrase de Laurent Deshaies qui énonce au sujet du primaire que « peu de problèmes ont été soulevés pour ce niveau d’enseignement, mis à par l’approche pédagogique par le développement de compétences au lieu de l’acquisition de connaissances et la difficulté à comprendre le nouveau bulletin scolaire par les parents, et parfois par les professeurs eux-mêmes » ? Si le premier argument constitue une vraie question de fond, le second fait franchement sourire…si tout le reste fonctionne si bien, nous sommes preneurs de conseils !
Pratiquer autrement
Face aux carences de l’institution à bien intégrer, voire à intégrer tout court, ses géographes, certains n’hésitent pas à oeuvrer hors des sentiers battus pour faire vivre leur passion et servir leur prochain. Lucie Dufresne, nous l’avons cité, dans le cadre de l’écriture de romans mais également d’autres dans le cas de travaux sur l’histoire ou d’expositions. Notre FIG, de par son ouverture, sa qualité d’organisation et de prestations, sa gratuité, semble enviéNous confirmons ! Outre-Atlantique.
Là encore, l’attention doit être portée sur les deux codirecteurs de l’ouvrage, Jules Lamarre et Edith Mukakayumba, qui ont pris une solide revanche sur le système en érigeant la Maison de la Géographie à Montréal, laquelle ayant pu voir le jour en s’inspirant de l’expérience des Cafés Géo. L’anecdote relatée par Alexandre Brun (Montpellier 3) lorsqu’il est venu en Postdoc à Laval est emblématique: « Alors quoi ? Il n’y a même pas de cafés-géo ici ? » Ni à Lille d’ailleurs….
Une très solide base de réflexion qui permet de montrer qu’il n’y a, hélas, pas toujours à attendre de l’institution et que la géographie peut légitimement sortir de ce cadre pour exister et pour révéler tout son potentiel d’action et d’analyse de nos espaces contemporains. L’enjeu est crucial pour que la géographie affiche son unité et évite de se dissoudre dans des pans du savoir mais surtout de la technique qui profiteraient et profitent déjà d’ailleurs, des vides créés et dont « la nature a horreur » comme le rappelait Raoul Etongué Mayer (p 81).