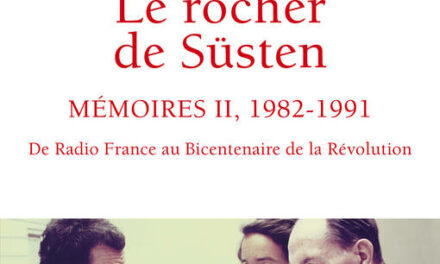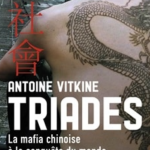Le rapport entretenu par les contemporains d’une époque avec le temps qu’ils vivent est un objet historique assez récent : cette histoire a été conceptualisée entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 1980. Le rapport des hommes au temps, et plus particulièrement au passé est alors devenu un chantier historiographique, les travaux de Claude Lévi-Strauss, Claude Lefort, Reinhart Koselleck (particulièrement son ouvrage, Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques), et François Hartog, ayant joué un rôle conceptuel fondamental. La notion de « régime d’historicité », importée et forgée en français par François Hartog (http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article4463), qui désigne « la manière dont une société ou un groupe humain construit, à un moment donné de l’histoire, conjointement son rapport au passé, au présent et à l’avenir, et dont ces trois temporalités s’articulent les unes avec les autres ») ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives de recherche à des historiens qui s’inspirent des travaux des anthropologues, des sociologues, des littéraires et des philosophes.
XXe siècle, Revue d’histoire consacre son numéro de janvier-mars 2013 à cette notion d’historicité. L’objectif étant « d’en cerner les contours théoriques, mais aussi et surtout d’en tester la validité empirique » comme le propose Ludivine Bantigny dans un des deux articles introductifs, l’autre étant de Quentin Deluermoz, les deux des historiens qui ont coordonné ce numéro spécial. L’article de Ludivine Bantigny « retrace la généalogie du concept d’historicité, ses différentes déclinaisons et ses enjeux pour les sciences sociales en général et l’histoire en particulier » ; celui de Quentin Deluermoz expose la démarche qui a guidé les concepteurs de ce numéro spécial : « faire le point sur la notion d’historicité, en la soumettant à des études de cas concrètes et documentées, afin d’en préciser les contours et les contenus, de rappeler la pertinence de cet outil et d’aider les chercheurs à se positionner face à l’affirmation d’une « crise du temps » qui menacerait les assises de son activité ».
Ce numéro spécial propose treize articles regroupés en trois thématiques : « Entre tradition et accélération : les vacillements de la modernité », « Temps et contretemps de la pensée : représenter l’historicité », « Contestations des temps dominants ? Crises et discontinuités ». Il ne saurait être question ici de résumer chacun d’entre eux, d’autant plus que beaucoup portent sur des points très particuliers, ne sont pas aisément accessibles et concernent surtout les chercheurs. J’ai choisi d’aborder avec plus de précision quatre articles qui sont susceptibles d’intéresser les professeurs d’histoire du secondaire, parce qu’ils portent sur des sujets abordés par les programmes, qu’ils ouvrent de passionnantes pistes de réflexion, mais aussi des perspectives de possibles travaux avec des élèves de lycée.
Johann Chapoutot, L’historicité nazie. Temps de la nature et abolition de l’histoire.
Johann Chapoutot, spécialiste de l’Allemagne contemporaine, auteur d’une remarquable documentation photographique sur le nazisme (http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3909) signe un passionnant article sur l’historicité nazie. Il montre « que le rapport des nazis au temps est une sorte de tension vers l’immobile, toute la culture nazie voulant plonger vers les profondeurs : celle de l’origine de la race et de la nature éternelle », et que « c’est sur un fond d’immobilité temporelle que s’est produite une accélération inédite de l’histoire, qui a précipité 60 millions de personnes dans la mort. ».
Effacer 1789 de l’histoire. Les nazis entendent d’abord effacer une grande partie de l’histoire passée : toute l’époque contemporaine, inaugurée en 1789 par la Révolution française « qui a détruit le monde ancien : la communauté antique et médiévale, cohérente et homogène, fermée et hiérarchisée (…) et donné naissance à la cohorte des «-ismes » funestes : libéralisme, universalisme, parlementarisme, etc. qui ont emporté l’ordre ancien. » Il s’agit donc, pour les nazis au pouvoir en 1933, d’« effacer 1789 de l’histoire », selon l’expression de Joseph Goebbels.
Retrouver la pureté originelle de la race. C’est l’Antiquité qui, selon les nazis, offre la meilleure solution d’organisation sociale. Il faut revenir au modèle des cités antiques, Sparte, mais aussi Athènes et Rome, celles du citoyen-soldat voué à la défense de la patrie. Ce modèle ne doit pas étonner car, selon l’histoire revue par le nazisme, les Grecs et les Romains sont des Germains issus du Nord qui sont allés coloniser et civiliser le Sud. Grecs et Romains ont été peu à peu sémitisés et asiatisés, il faut donc retrouver la pureté originelle du temps passé, « la prime pureté de la race, de son sens et de son esprit. » Le projet nazi ne consiste donc pas à créer « un homme nouveau » mais à « dégager l’homme ancien de sa gangue sédimentaire, au moyen d’un eugénisme discriminant, qui devait traquer l’impureté passée et prévenir toute mixtion future des sangs. »
Se défendre contre l’ennemi judéo-bolchévique et l’abattre. Le projet nazi implique une urgence de réalisation. « Le temps qui passe suscite de l’angoisse : il arme les ennemis de l’Allemagne, il mélange les sangs, il épuise les ressources. La projection nazie dans l’avenir est toute entiere imprégnée de cette angoisse biologique historique (…) de l’écoulement d’un temps qui amenuise et dégrade, conception qui ne peut être conjurée que par un volontarisme vigoureux ». Ce volontarisme se traduit par la planification de l’économie, mais aussi par le Genaralplan Ost qui planifie les déplacements de population et l’aménagement des territoires conquis à l’Est. L’Allemagne est sur la défensive dans la conception nazie, l’ennemi judéo-bolchevique va attaquer et sa victoire serait « une apocalypse pour l’Allemagne, une catastrophe finale et sans remède ». La guerre a pour objectif de mettre fin à la guerre des races sur le continent en détruisant le foyer judéo-bolchevique en Europe.
La promesse d’un avenir radieux. « S’ouvre alors au projet nazi un espace vaste, libre et sans obstacle : les profonds territoires de l’Est et l’éternité du temps. C’est dans cet espace-temps ouvert et dégagé par une victoire proprement eschatologique que se déploie la planification. » Le mélange des races qui menaçait de mort le peuple allemand ayant été conjuré, le danger est écarté et la race allemande peut jouir de son éternité. « L’ontologie nazie, figée dans l’éternité de la nature et de la race, donne donc sens à l’existence individuelle et à l’action de chacun : l’individu vit, se bat et tue pour perpétuer la vie de la race. »
« En surface, le nazisme est bruit et fureur : galvanisé par l’urgence et l’angoisse de la pénurie, il est projection volontariste et résolue vers un à-venir fait de modernité technique, d’accumulation d’espaces, de ressources et de matériels ( …) La culture nazie est une plongée vers les profondeurs, celle de l’origine de la race, d’une pureté physique et d’une authenticité culturelle à retrouver. Dans les profondeurs gouvernent également une éternité immobile, celle d’une nature telle qu’en elle-même qui, depuis toujours, oppose les mêmes antagonistes de race : le « juif éternel » et le Prométhée de l’humanité, qu’il soit grec, romain ou allemand, homme germanique figé dans une biologie d’excellence et de bonté tout comme le juif est, de toute éternité, nomade, destructeur et haineux. Une vision verticale du temps ».
Marc Abélés, Construction européenne, démocratie et historicité
Anthropologue du politique et des institutions, directeur d’études à l’EHESS, Marc Abélés nous propose une réflexion sur l’articulation entre passé, présent et avenir dans la construction européenne. Il observe d’abord que deux interprétations en apparence contradictoires sont possibles à propos des grandes étapes de la construction européenne : d’un côté, la continuité d’un processus, une entreprise de longue haleine qui modifie en profondeur la géopolitique du continent européen, d’un autre côté, de multiples crises, une accumulation de désaccords, de discordes, de blocages et d’avancées. « Le temps communautaire a plusieurs dimensions : il se veut anticipateur et nous projette dans un avenir lointain ; il est aussi celui de la création continue : tout reflux implique une relance, et l’histoire devient un perpétuel commencement ; le temps communautaire enfin, c’est l’obsession du calendrier, de l’urgence érigée en principe (…) Ces trois dimensions sont enchevêtrées. »
L’Europe de l’engrenage. La première dimension correspond à ce qu’il appelle « l’Europe de l’engrenage ». La construction européenne est un processus cumulatif, la méthode étant celle des « petits pas » selon l’expression de Jean Monnet. La construction européenne est ainsi conçue sur le mode de l’engrenage. En effet chaque avancée dans un domaine implique une série de mesures, au nom de l’harmonisation ; or il s’avère rapidement que ces mesures en appellent d’autres pour obtenir un fonctionnement optimal du marché. Le droit communautaire devient l’élément fédérateur et le moteur de l’intégration européenne. On assiste ainsi « à l’irrésistible ascension d’une communauté de droit qui devient le moteur même de l’intégration économique. »
L’Europe de la création continue. La seconde dimension et celle « de la création continue » qui « porte en elle les stigmates de l’histoire ». « L’Europe de l’irréversible se projette dans l’avenir, l’Europe de la création continue se vit dans le présent immédiat. Le passé n’a donc guère de place. » L’anthropologue des institutions observe que, dans les instances européennes, on aime travailler dans l’urgence, on se fixe des dates butoirs, on fait de la contrainte un stimulant afin de « finaliser » dans les délais. « Ainsi se construit l’Union, allant de l’avant sans jamais se retourner. ». Tout se passe comme si l’Europe devait se réinventer continuellement.
Un chantier qui n’est jamais terminé. La Communauté européenne semble donc vivre dans une perpétuelle fuite en avant, l’achèvement du projet étant toujours reporté. L’expression de construction européenne mérite d’ailleurs une analyse : la Communauté est vécue par ses artisans comme un chantier ; on n’imagine pas qu’elle puisse être un jour terminée. C’est même la perspective de l’avenir qui donne un sens à ce processus. « À la différence des États existants, l’Union se vit comme un processus dynamique tendant vers un but qu’elle est encore loin d’avoir atteint (…) La représentation du temps de l’Europe communautaire est donc totalement différente de celle qui prévaut dans les communautés traditionnelles. Elle est toute entière orientée vers le futur. Cela permet aux artisans de l’Europe de résister au mouvement de reflux observé périodiquement (…) Entre chacune de ces avancées, se produisent des périodes de blocages. La machine semble grippée, on sombre dans l’europessimisme, voir l’euroscepticisme. »
Paradoxalement, plus l’Europe avance, plus elle inquiète. L’engrenage, en projetant les citoyens vers un ailleurs dont ils ne maîtrisent pas le sens, provoque des réactions négatives. L’Europe des débuts regardait vers un futur qui était considéré comme positif, c’était le progrès. Le futur aujourd’hui suscite angoisse et inquiétude. Toute initiative politique risque dans ces conditions d’apparaître « intempestive », et de rencontrer « le désaveu des gouvernés.»
Nicolas Beaupré, La guerre comme expérience du temps et le temps comme expérience de guerre. Hypothèses pour une histoire du rapport au temps des soldats français de la Grande Guerre.
Maître de conférences à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, membre du centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre, Nicolas Beaupré a publié chez Belin en 2012 Les Grandes Guerres, 1914-1945. Ses recherches portent sur l’histoire de la Grande Guerre et ses conséquences en France et en Allemagne.
Le rapport des hommes au temps dans l’historiographie récente de la Grande Guerre. L’auteur commence par situer la question du temps dans l’historiographie de la Grande guerre. Les deux thèses « fondatrices d’une histoire renouvelée de la Grande guerre parues toutes deux en 1977, posaient les jalons de l’étude du rapport des contemporains de la Grande Guerre à leur époque. » L’une était celle d’Antoine Prost, Les Anciens combattants et la société française, consacrée aux anciens combattants français dans l’immédiat après-guerre, qui s’intéressait à la mémoire de guerre, l’autre était celle de Jean-Jacques Becker, Comment les Français sont entrés en guerre. Contribution à l’étude de l’opinion publique, printemps-été 1914, qui mettait au centre l’irruption de l’événement comme rupture, et la manière dont celui-ci était appréhendé par les contemporains. Depuis trente ans les questions mémorielles ont davantage préoccupé les historiens que le rapport au temps, qui n’a cependant pas été négligé. Dans son étude de la presse de tranchée, Stéphane Audoin-Rouzeau a montré que « la vie du front a provoqué une mutation complète de la perception du temps et de l’espace et modifié totalement la hiérarchie de l’importance des choses. Tout est ramené à la minute présente ». D’autres travaux mettent désormais « le temps, l’expérience du temps, le rapport au passé et notamment à l’avant-guerre et les attentes de la fin de la guerre, de la paix et de la victoire au coeur de la réflexion historique sur la Grande Guerre ».
Inventaire et critique des sources. Pour écrire l’histoire du régime d’historicité des combattants de la Grande Guerre, l’auteur fait un inventaire et une critique des sources disponibles. Les récits d’après-guerre posent pour ce type d’étude de gros problèmes à l’historien, en raison de la distance temporelle entre le temps vécu et le temps raconté, distance qui est encore accrue par la rupture qu’a constituée la fin de la guerre. Les récits écrits pendant la guerre peuvent informer sur les « horizons d’attente », mais encore faut-il tenir compte de la chronologie de l’écriture de ces récits : les « horizons d’attente » de 1914 ne sont pas ceux de 1916, pendant la bataille de Verdun, ni ceux de 1917 après l’échec de l’offensive du Chemin des Dames, ni ceux de 1918 quand se profile enfin la victoire, ou la défaite. En outre, et c’est fondamental, le récit est par nature une reconstruction et ne permet pas d’accéder immédiatement au présent de l’expérience. Le journal intime, la correspondance et la presse des tranchées sont des sources qui sont précisément datées, qui permettent de suivre chez un même individu l’évolution de « son champ d’expérience » et de ses « horizons d’attente ». Ils sont un « reflet prosaïque des soucis du quotidien » et les « horizons d’attente » qui sont décelables se limitent souvent au très proche avenir. L’auteur montre que « la poésie de guerre, trop souvent négligée par les historiens comme forme courte, est sans doute, lorsqu’elle est datée avec soin, une porte d’entrée dans ce type de recherche. » Il plaide également pour l’utilisation de sources nouvelles, à croiser avec les témoignages, comme, par exemple des oeuvres d’art ou des objets du quotidien. Il observe par exemple que la démocratisation de la montre-bracelet pendant la Grande Guerre pourrait « nous donner maints indices du souhait de s’extraire d’un temps subi pour au contraire se le réapproprier, le maîtriser à nouveau. »
La guerre génère son propre régime d’historicité. Après ses réflexions sur les sources, l’auteur examine les principales caractéristiques des rapports au temps des combattants et émet l’hypothèse que « la guerre générerait son propre régime d’historicité, découlant de la situation même d’être en guerre et de sa perception par les acteurs sociaux. Ce régime reposerait sur une idée partagée par tous, ou presque tous (au front comme à l’arrière, chez les consentants comme les non-consentants), et ceci quel que soit le moment de la guerre. La guerre ne saurait être un état permanent. Une fois entré dans le conflit il n’y a pour ainsi dire que deux issues : la mort ou la paix. Il est donc logique que la paix soit pour l’ensemble des combattants et des non-combattants le principal horizon d’attente ». La guerre est nécessairement transitoire et la paix est inéluctable, il est donc souhaitable qu’elle soit proche, et qu’elle se solde par une victoire.
Ce régime permet de mieux comprendre le consentement des combattants. L’hypothèse permet alors de mieux comprendre la ténacité des combattants. « L’investissement et la projection vers une fin de guerre comme délivrance expliqueraient pourquoi et comment l’offensive peut être acceptable dans une guerre vécue comme défensive : l’offensive permet de se rapprocher de la fin de la guerre. Le refus implicite ou explicite des offensives n’intervient qu’après de longues années de guerre, en raison des échecs répétés de ces dernières. La probabilité de mourir devient alors plus forte que celle d’une offensive victorieuse mettant fin au conflit. C’est donc bien la conjugaison du présent et de la fin attendue qui fait de la guerre un état provisoire, même s’il dure. Ainsi, au-delà des attentes puissantes dont peut-être investie la fin de la guerre, la représentation de la guerre comme une parenthèse dans le temps facilite l’endurance. »
Ludivine Bantigny, Le temps politisé. Quelques enjeux politiques de la conscience historique en Mai-Juin 68
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen, Ludivine Bantigny a publié en 2003 un ouvrage issu de sa thèse de doctorat, Le plus bel âge ? Jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 1960 et plusieurs autres ouvrages depuis dont une histoire des jeunes en France du XIXe au XXIe siècle. Elle applique le concept d’historicité aux événements de 1968. Elle montre que le présent fut vécu avec intensité par les protagonistes qui éprouvèrent un sentiment d’accélération du temps et que le passé fut constamment invoqué et vécu.
Un présent vécu avec intensité. Les acteurs de mai 68 vécurent ce moment avec intensité, plusieurs affirment avoir connu une coupure existentielle. Le temps est vécu comme étant très précieux, en accélération, l’auteur parle d’un « temps de qualité ». Mais elle parle aussi d’un « temps-mouvement » : le mouvement est en perpétuel dépassement, chaque chose, à peine vécue, est « frappée d’une obsolescence accélérée ». Il faut donc parvenir à réagir au cours de cette accélération : « ainsi se dessine le sentiment d’urgence qu’impose une temporalité précipitée. »
Des acteurs conscients de faire l’histoire. Les protagonistes ont conscience de s’inscrire dans l’histoire et de faire l’histoire. « Le moment est vécu comme historique, au sens d’un basculement radical cisaillant le continuum entre passé et futur. »
Un passé omniprésent. Les journalistes et les analystes multiplient les références historiques : la révolution de 1848, les grèves du Front populaire, la Commune de Paris, autant d’événements dont la référence est utilisée comme « un instrument stratégique pour une analyse politique. » Mais la présence du passé n’est pas une simple référence. « Elle fait resurgir des événements, comme souvenirs vécus mais plus encore comme dépassement de la seule mémoire au profit d’une politique active. Ici comme ailleurs, jouent des temporalités différenciées selon les secteurs des espaces concernés. ». Ainsi, par exemple, mai-juin 1968 est vécu comme un lendemain du Front populaire, les organisations révolutionnaires en font un levier pour aller plus loin alors que la CGT et le parti communiste ont tendance rappeler qu’il faut savoir terminer une grève.