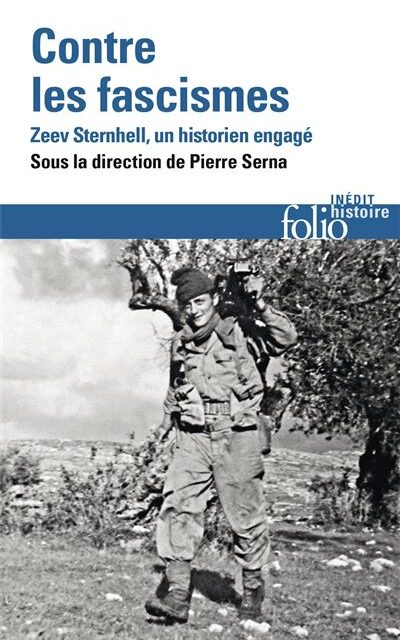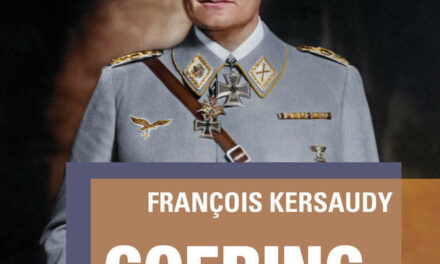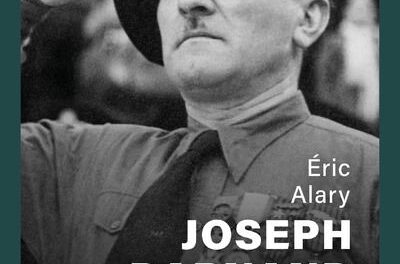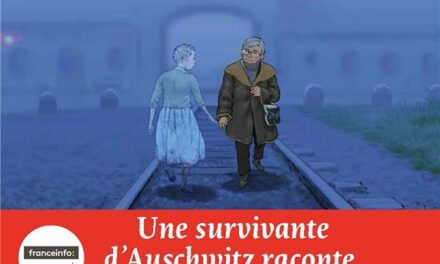Zeev Sternhell (1935-2020) était un grand historien israélien, professeur de sciences politiques à l’Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste du nationalisme français et de l’idéologie fasciste. Sioniste socialiste, il était très critique à l’égard de la droite et de l’extrême-droite israélienne. C’est à cet historien engagé dont certains ouvrages, notamment Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France ont suscité de grandes controverses historiographiques, que cet ouvrage, composé d’une dizaine de contributions, rend hommage.
Dans l’introduction Pierre Serna présente les grands traits de l’oeuvre de Sternhell et montre comment elle peut être une source actuelle de réflexion au moment où des idéologies et des mouvements politiques autoritaires se développent en Europe, aux Etats-Unis et en Israël. Ses premiers travaux portaient sur Maurice Barrès et le nationalisme français à la fin du XIXème siècle. Sternhell montrait que s’était constituée alors une « droite révolutionnaire » qui combinait le conservatisme de la droite et le populisme et la violence de la gauche radicale. Sternhell a ensuite élargi sa réflexion à la naissance et au développement de l’idéologie fasciste en France, qui a imprégné une partie de la société française et conduit au soutien d’une partie des élites au régime de Vichy. C’est cette thèse qui a suscité le plus de débats. D’autres historiens, comme Michel Winock, tout en soulignant l’ampleur des recherches de Sternhell, ont souligné que jusqu’ à Vichy, l’idéologie fasciste n’avait eu qu’une audience intellectuelle et politique limitée. Elargissant ses recherches Sternhell a cherché à faire « l’archéologie du fascisme « en analysant les « anti -Lumières » qui s’opposaient aux idéaux des Lumières ( universalité du genre humain, rationalisme, idéal démocratique d’émancipation individuelle et collective) et à leur mise en acte par la Révolution Française. Les tenants des anti-Lumières faisaient l’éloge de l’antiparlementarisme, de l’autoritarisme, et mettaient en avant la xénophobie et l’antisémitisme. Ce courant hostile aux Lumières et à la Révolution parcourait les sociétés françaises et européennes, et il finit par trouver sa traduction politique avec le régime de Vichy.« La législation raciale ( de Vichy ) c’est un clou dans le cercueil des Lumières française et des principes de 1789 ». Historien israélien, ayant combattu dans plusieurs guerres, défenseur d’un sionisme socialiste, Sternhell était très critique face à la droite israélienne. Lui et son épouse furent victimes en 2008 d’un attentat commis par un militant d’extrême-droite. On peut cependant reprocher à Pierre Serna une approche déséquilibrée. Il dénonce certes le « pogrom du 7octobre 2023 », mais réserve ses attaques à la droite israélienne ainsi qu’à la politique menée par Israël à Gaza, et sous -estime la violence du mouvement Hamas qui n’est jamais nommé. Pourtant, dans le prolongement des analyses de Sternhell on pourrait trouver bien des éléments du fascisme dans l’idéologie et la pratique du Hamas : une idéologie mobilisatrice plongeant ses racines dans l’histoire, un violent antisémitisme, une idéologie belliciste et mortifère, la justification de la violence, le refus de reconnaissance de l’ Autre.
Un historien israélien ou le parcours d’un combattant
Annette Becker évoque les grandes étapes de la vie de Sternhell. Il est né en 1935 à Przemysl en Pologne. En 1942, il est interné dans le ghetto de la ville où sa mère et sa soeur aînée sont assassinées par les nazis. Sternhell et une partie de sa famille parviennent à s’échapper du ghetto et se font passer pour des catholiques polonais jusqu’ à la fin de la guerre. En1945, il est envoyé chez l’une de ses tantes à Avignon. En 1951 il fait son aliyah en Israël et participe à la guerre du Sinaï en 1956, puis aux guerres de 1967, de 1973 et 1982. Dans la deuxième moitié des années 1960 il prépare à l’Institut d’études politiques sa thèse consacrée à Maurice Barrès, thèse qu’il soutient en 1969. Il devient professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem. Sioniste socialiste, il est très critique à l’égard de la droite israélienne. Annette Becker souligne le paradoxe de l’oeuvre de Sternhell. Il a connu la barbarie nazie dans son enfance, été officier de l’armée israélienne, et cependant il a surtout étudié la genèse intellectuelle de l’idéologie fasciste, en sous -estimant le poids de la violence de la Première guerre mondiale dans le développement du fascisme.
Un historien israélien
Plusieurs contributeurs, parmi lesquels Philippe Gumplowucz étudient les rapports de Sternhell à Israël et au sionisme. Sternhell émigra en Israël combattit comme officier lors des guerres de 1956 ,1967 et 1973 et 1982 C’était un sioniste socialiste, l’un des initiateurs du mouvement la Paix Maintenant. En même temps, il se montra critique face aux dirigeants du mouvement sioniste qu’il jugeait plus nationalistes que vraiment socialistes, face à la politique d’implantations juives en Cisjordanie, et face à l’extrême -droite israélienne. Sternhell était également très critique sur la loi adoptée par la Knesset en 2018 qui définit Israël comme l » Etat- nation du peuple juif » en précisant que le « droit d’exercer l’auto- détermination au sein de l’ Etat d’ Israël est réservé uniquement au peuple juif ».
La question des fascismes français
Zeev Sternhell a commencé par étudier Maurice Barrès et le nationalisme français à la fin du XIXème siècle pour élargir son étude au développement de l’idéologie fasciste en France. Philip Nord analyse le premier ouvrage de Sternhell Maurice Barrès et le nationalisme français ( 1972) . Sternhell montrait que dans les années 1880 -1890 était né un nouveau courant politique nationaliste, populiste que l’on peut qualifier de préfasciste. Au coeur de cette invention politique se trouvait Maurice Barrès. D’abord attiré par le mouvement boulangiste, il ne se contentait pas de reprendre les thèmes de la droite traditionnelle : hostilité au parlementarisme, culte du chef, conservatisme social . Il y ajoutait deux composantes venues de la gauche : le peuple et la nation . Barrès était attiré par une certaine forme d’exaltation du peuple ( il revendiquait une partie de l’héritage de la Révolution française et en cela il se distinguait de la droite classique) et du socialisme qui défendait « le peuple » face à la féodalité financière. Cette variante du socialisme comportait une dimension xénophobe et antisémite, les Juifs représentant pour Barrès « l’élément étranger par excellence ». Barrès popularisa également l’idée que le nationalisme n’était pas le monopole de la gauche, mais qu’il pouvait être l’apanage d’une nouvelle droite. Sternhell avait vu que le nationalisme du début du XX ème siècle pouvait transformer l’amour de la patrie en ethno-nationalisme (le culte de la « terre et des morts » ) et que cette pulsion collective avait à la fois des aspects radicaux plébéiens et des aspects traditionnels bourgeois La thèse de Stenrhell apparaissait comme radicalement nouvelle, la droite nationaliste était une sorte d’ hérésie de gauche, un républicanisme ayant intégré un nationalisme xénophobe et antisémite que l’ Affaire Dreyfus allait révéler, l’antidreyfusisme combinant agitation plébéienne et soutien d’une partie des conservateurs. Le passage du préfascisme au fascisme est plus difficile à analyser. Pour Philip Nord, il ne faut pas sous-estimer le poids de la Grande Guerre et de la peur du communisme, qui ont provoqué une radicalisation du nationalisme Par la suite, au-delà de Maurice Barrès,,Sternhell a élargi sa réflexion dans « La droite révolutionnaire « où il affirmait que l’idéologie fasciste était née en France au tournant des XIXème -XXème siècles.
Ni droite ni gauche – l’idéologie fasciste en France, publié pour la première fois en 1983 fut à l’origine d’une importante controverse historiographique évoquée par Olivier Forlin et Kevin Passmore. Sternhell remettait en cause la théorie des trois droites de René Rémond et l’idée que les institutions républicaines et l’union des gauches après le 6 février 1934 auraient immunisé la France contre la tentation fasciste. Au contraire, pour Sternhell le régime de Vichy n’ était un accident, mais le produit de la culture politique de l’extrême- droite et de la contestation de la démocratie depuis la fin du XIXème siècle. Les critiques de Sternhell lui reprochaient de se cantonner à l’histoire des idées et d’exagérer le poids et l’influence des idéologues fascistes ou fascisants en France. Au moment de la parution de l’ouvrage en 1983 le contexte politique pouvait également nourrir le débat : les années 1980 sont celles des difficultés de la gauche, de la montée du Front national dont le chef de file revendique l’héritage de Vichy. De plus l’extrême- droite connaissait unerénovation idéologique avec le développement de la Nouvelle Droite qui défendait des thèses hostiles à l’universalisme et à l’égalitarisme au profit de l’ethno- différentialisme. `
Baptiste Roger- Lacan souligne l’importance de la contre-révolution, de l’hostilité à la Révolution française dans le développement de l’idéologie fasciste. Cette thèse peut paraître en contradiction avec celle de Sternhell qui concluait à l’effacement de la contre- révolution à la fin du XIXème siècle et à l’émergence d’une droite révolutionnaire. Pourtant l’hostilité à la Révolution constitue un élément de l’imaginaire d’une partie de la population ( La Révolution destructrice pour la France, la Terreur ) et cette hostilité se renforce dans les années 1930 ( 6 février 1934 , hostilité au Front populaire) et dans la législation de Vichy ( programmes scolaires, statut des Juifs) Comme le souligne Johann Chapoutot , pour le fascisme et le nazisme il s’agit « d’ effacer 1789 « .
Johann Chapoutot illustre la thèse de l’imprégnation des idées d’extrême-droite, voire des conceptions nazies, dans une partie de la société française, imprégnation qui a conduit à la mise en oeuvre et à l’acceptation de la législation de Vichy. A la suite de Sternhell, il rappelle qu’André Siegfried, professeur de sciences politiques, développait des thèses racialistes pour expliquer des phénomènes politiques et fit preuve, même après 1945, d’un fort antisémitisme. Il rappelle qu’en 1937, Edouard Herriot, alors conseiller général du Rhône suggérait de réduire les crédits alloués aux hôpitaux psychiatriques. Surtout Johann Chapoutot relève qu’un certain nombre d’écrivains comme Jean Giraudoux ou de journalistes développaient dans leurs écrits lus par la bourgeoisie des thèses violemment xénophobes et antisémites, visant surtout les Juifs d’Europe orientale, mais aussi les migrants venus du Maghreb. Giraudoux prônait la nomination d’un » ministre de la Race ». Le Front populaire et l’hostilité aux mouvements sociaux exacerbèrent ces haines. Marc Bloch et le philosophe Emmanuel Mounier avaient bien analysé l’attrait que pouvait exercer le nazisme comme rempart contre le communisme. Pour Chapoutot, une partie de l’opinion européenne pouvait admirer l’efficience du régime nazi voire son racisme qui présentait une différence de degré,mais non de nature avec le racisme colonial. Dès lors en 1940, la hantise de certains chefs militaires était moins celle de la défaite que la victoire du communisme.
Benjamin Stora montre que la « Droite révolutionnaire » était bien présente dans l’Algérie coloniale. Le caractère hiérarchisé de la société coloniale algérienne, la situation des Juifs d’Algérie, citoyens français depuis le décret Crémieux, l’exclusion de la population indigène musulmane soumise à de nombreux contrôles depuis l’adoption du Code de l’indigénat en 1881, expliquent les tensions qui traversaient la société algérienne. Au moment de l’Affaire Dreyfus l’antisémitisme y fut particulièrement virulent. En 1898 Edouard Drumont fut élu député d’Alger, les maires des grandes villes algériennes étaient antisémites et des émeutes eurent lieu à Oran en 1897. Ce sont parmi les membres de cette population européenne que se recrutèrent les partisans du « fascisme à la française ». L’antisémitisme persista dans les années 1920 et 1930 et le régime de Vichy fut accueilli avec ferveur et enthousiasme. Dès le 7 octobre 1940, le décret Crémieux fut abrogé et le 11 les Juifs perdirent le droit de se faire naturaliser. Les Juifs furent exclus des écoles un numerus clausus fut imposé aux professions libérales, aux étudiants. La droite révolutionnaire trouvait son prolongement dans le régime de Vichy.
Situations européennes
Pierre Salmon montre la pertinence des thèses Sternhell en ce qui concerne l’Espagne. L’année 1898 voit la fin de l’empire colonial espagnol (perte de Porto Rico, Guam, Cuba et des Philippines à l’exception du Maroc espagnol) et provoqua des interrogations autour de la décadence et de la régénération de l’ Espagne autour du catholicisme, de la famille et du castillan, thèmes repris par le franquisme. A ces thèmes s’ajoutent ceux de l’hostilité au socialisme et à la démocratie et la dénonciation d’un supposé danger judéo-maçonnique. Pendant la dictature franquiste , les historiens officiels du régime ont évoqué les « responsabilités partagées » entre franquistes et républicains dans le déclenchement de la guerre. De nos jours encore, certains historiens dénoncent les supposées responsabilités des Républicains, et l’indulgence à l’égard de Franco se rattache à la pensée des anti-Lumières décrite par Sternhell. On y retrouve l’idée de la croisade contre des ennemis extérieurs. Cette idéologie trouve une traduction politique. L’Institut des sciences sociales et économiques et politiques de Marion Marechal -Le Pen a été fondé en partenariat avec le parti Vox.
Deux contributions sont consacrées à l’Italie. Frédéric Attal montre que l’oeuvre et les prises de position du philosophe Benedetto Croce illustrent la thèse de Sternhell sur les origines intellectuelles du fascisme. Il était très hostile à la Révolution Française et à la franc-maçonnerie, considérait que les notions de liberté, égalité, fraternité étaient des concepts dénués de solidité. Il était favorable à une monarchie parlementaire censitaire (celle de l’Italie d’avant 1914) dirigée par des notables. Après la Première guerre mondiale, il critiqua l’idée de développer la sécurité collective et valorisait la force des Etats. Sans être antisémite, il faisait plutôt preuve d’antijudaïsme (le judaïsme, religion du passé) Il soutint le fascisme à ses débuts, mais à partir de 1924, sans renier ses choix intellectuels, il protesta contre certaines mesures de la dictature fasciste. Il protesta contre la persécution des francs-maçons. En 1938, lors de l’adoption des lois antisémites, il refusa de signer des déclarations de non -judéité.
Valeria Galimi étudie la réception de Ni droite ni gauche en Italie. La traduction italienne fut publiée par un éditeur d’extrême-droite (ce qui ne plut pas à Sternhell). L’extrême- droite appréciait l’ouvrage de Sternhell pour deux raisons. En premier lieu parce qu’il montrait que le fascisme n’était pas un accident mais s’inscrivait dans un contexte intellectuel plus vaste. En second lieu parce que Sternhell montrait que l’idéologie fasciste puisait certaines de ses racines dans le socialisme révolutionnaire. Par la suite le débat devint davantage un débat universitaire. Certains historiens, tout en reconnaissant l’intérêt des analyses de Sternhell soulignaient qu’il ne tenait pas assez compte de la situation sociale et politique de l’Italie du début des années 1920 (le fascisme était moins révolutionnaire qu’il n’ y paraît, Mussolini ayant fait des compromis avec les milieux conservateurs) et qu’il sous-estimait la violence du mouvement fasciste issue de la Première guerre mondiale.
Comparaisons contemporaines
Philip Nord et Henry Rousso examinent les mouvements illibéraux contemporains à la lumière des travaux de Sternhell et montrent que les vieilles démocraties ne sont pas immunisées contre les menaces polymorphes des fascismes.En ce qui concerne la France on ne retrouve pas dans le Rassemblement national la brutalité des mouvements fascistes, mais on retrouve des éléments de la thématique fasciste : l’idée de « la France d’abord », la xénophobie ( l’antisémitisme a été remplacé par des accents anti -immigrés et anti -musulmans), l’hostilité à l’ Europe, le protectionnisme, le populisme , l’hostilité aux droits de l’homme et aux Lumières, la fascination pour les autocrates. Cependant, le Rassemblement national n’encadre pas les masses dans un parti paramilitaire et ne prône pas la prise du pouvoir par la violence. Il s’apparenterait davantage aux mouvements « illibéraux «qui ont accédé au pouvoir en Pologne , en Hongrie ou en Italie. .
La situation des Etats-Unis est également préoccupante. Le trumpisme révèle les fractures de la société américaine. On peut mentionner les slogans ultranationalistes de Trump, sa politique tarifaire, la xénophobie, le nationalisme blanc, l’hostilité au mouvement woke , l’anti intellectualisme , les manoeuvres d’intimidation contre ses adversaires, y compris au sein du parti républicain, les mesures fiscales en faveur des plus aisés. Trump est soutenu par des milices extrémiste prêtes à agir comme on l’a vu le 6 janvier 2021 lors de l’attaque contre le Capitole. Cependant Philip Nord préfère plutôt parler de proto -fascisme, les violences étant moindres que dans l’Italie de l’après première guerre mondiale. Toutefois, on peut s’inquiéter de la tentation très forte à « l’ingénierie sociale « : révision de l’histoire ( la responsabilité du déclenchement de la guerre en Ukraine), le retrait de certains livres de bibliothèques, et surtout l’expulsion massive d’étrangers.
L’ouvrage se termine par une contribution d’Henry Rousso. Il évoque sa rencontre avec Sternhell au milieu des années 1980, à un moment où des éléments refoulés de l’histoire nationale ressurgissent : le degré d’imprégnation ou d’allergie de la France aux idéologies fascistes, la nature du régime de Vichy et son rôle dans la Shoah. C’est aussi le moment de l’inculpation pour crimes contre l’humanité d’anciens hauts fonctionnaires de Vichy, ainsi que de Klaus Barbie. C’était aussi le début des succès électoraux du Front national. Henry Rousso partageait l’idée de Sternhell selon laquelle la catastrophe de juin– juillet 1940 rendait dérisoire la thèse d’une allergie française au fascisme. Il souligne que par bien des aspects le régime de Vichy possédait des composantes fascistes qui trouvaient leur origine dans les écrits de l’entre- deux- guerres et dans ce que Sternhell nommait les anti-Lumières : haine de la démocratie et de l’universalisme, xénophobie et antisémitisme, vision organiciste de la société, désir de modeler la société. Loin d’être un projet de circonstance, ce projet venait d’une longue tradition d’hostilité à la Révolution française. Cependant il a manqué au régime de Vichy plusieurs éléments qui constituent le fascisme : un parti de masse, un chef mobilisant l’énergie nationale, le recrutement des soutiens du régime au sein des élites traditionnelles, et l’absence de projet belliciste. Cependant aux yeux d’Henry Rousso, l’essentiel du régime de Vichy ne se trouve pas dans les discussions autour du fascisme de Vichy mais dans la politique de collaboration qui a fait de la France « l’un des principaux soutiens logistiques des forces de l’ Axe en guerre ainsi que le complice de la politique répressive et génocidaire du III ème Reich ».