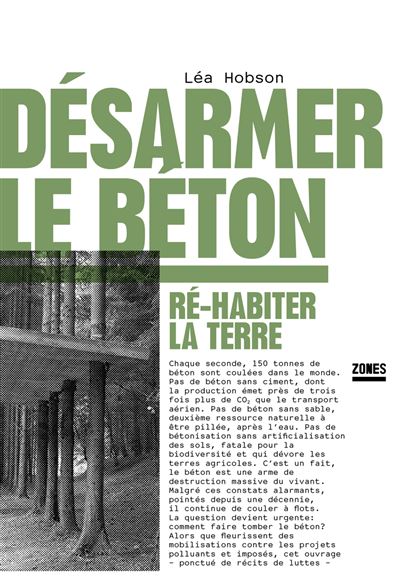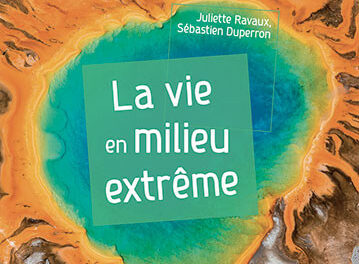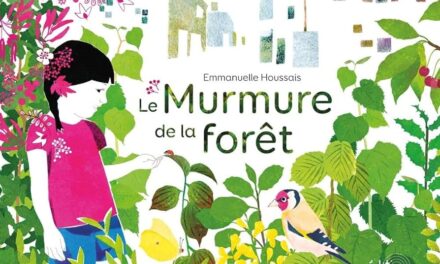En France, 80 % du patrimoine bâti est en béton. Ce chiffre est énorme et les bétonneurs s’acharnent à continuer dans cette voie. Pourtant cette matière est loin d’avoir toutes les vertus : produire 1 m3 de béton émet 250 kg d’équivalent CO² ou revient à brûler 100 litres de diesel. Le ciment, ingrédient principal du béton, représente 9 % des gaz à effet de serre tandis que le secteur de la construction en représente 39 %. Cet outil central de la capitalocène doit être sérieusement questionnée pour l’auteure de ce livre.
Léa Hobson est architecte, scénographe mais également militante écologiste au sein du mouvement « les Soulèvements de la Terre ». Dans cet essai, elle porte un regard critique sur cette industrie qui affiche un monopole dans le domaine de la construction et propose des pistes de solutions.
Du sable à la ruine
La première partie se nomme « du sable à la ruine » et débute sur la transformation brutale du sol qui a mis des années à se modifier et qui a besoin d’être aéré (rôle des vers de terre) notamment pour assurer la bonne circulation de l’eau. L’artificialisation des sols n’est pas en commune mesure avec la hausse démographique qui se révèle bien moindre. « Quand il ne nous noie pas, il nous fait frire » : derrière cette formule, on comprend bien que l’imperméabilisation des sols génère les inondations mais que le béton augmente aussi la chaleur urbaine. La loi ZAN « Zéro Artificialisation Nette » lutte timidement contre cette dérive.
La traçabilité des composants du béton est obscure, notamment le sable. La filière est peu vertueuse : seuls 10 % des granulats sont issus du recyclage des déchets de béton. De plus, les sites d’extraction sont cachés aux yeux du public. L’extraction des granulats s’est d’abord faite dans les lits mineurs des rivières puis, au vu de l’épuisements et des risques, elle s’est arrêtée en 1990. Les dégâts étaient majeurs : incisions massives (parfois 12 m), dérèglement de la circulation de l’eau souterraine, pollution, assèchement, baisse de la biodiversité. Il y a eu ensuite un détournement vers les lits majeurs des rivières et enfin vers les océans (80 % en façade Atlantique et 20 % au niveau de la Manche). Il y a cette fois nécessité de dessalage, une opération couteuse en eau douce. La zone sous-marine est remuée par un tuyau, ce qui accroit la turbidité de l’eau et perturbe la chaine du vivant (la faune est arrachée, déchirée et les souilles d’attraction modifient aussi le relief sous-marin). Les carrières initialement exploitées pour la diversité des ressources se sont ensuite vues racheter après leur fermeture. Autant de balafres paysagères que ces extractions terrestres.
L’analyse biologique durant les études d’impact est réduite à peau de chagrin, le pire étant que les exploitants arrivent à vendre leur projet en quelque chose de vertueux écologiquement. Les cimenteries ont suivi le même modèle que les carrières avec cette recherche du monopole. Le chauffage des fours génère du CO² tout comme la réaction qui se produit quand le calcaire est chauffé. Certaines sociétés font des concessions à la colère des riverains en installant des filtres pour la pollution atmosphérique…tout en contestant les analyses ouvertement ! Ils deviennent, par la suite, des producteurs de « bas carbone »
Des « centrales à béton » maillent désormais le territoire et se donnent une apparence « locale » en produisant « frais » puisque la distance entre les carrières et les cimetières ont augmenté, le secteur étant fortement concentré.
Le bas coût du béton est insensé : 1m3 de béton coûte moins cher que 1m3 de bière !
La norme bétonnée, au-delà du matériau
La seconde partie débute par une histoire de la fabrication du matériau au départ manuelle puis mécanisée ensuite. On coule du béton pour « construire vite et pas cher ». Les modes de construction se sont standardisés mais les corps sont toujours nécessaires pour manipuler. Les problèmes de santé sont là, qu’ils soient dermatologiques ou liés aux charges lourde. Les décès en accidents de travail sont là aussi. Et le recours à la main d’œuvre étrangère à bas coût est une réalité.
La France est le 2ème pays producteur de béton. Et attention à la différence entre « pays producteurs » et « entreprises productrices » : la France n’est pas dans le top 5 de la fabrication de ciment mais les entreprises sont bien françaises.
La tendance est aux grands projets qui donnent le sentiment d’être interminables : le Grand Paris, le plateau de Saclay pour lequel l’ironie est forte : la destruction d’habitats naturels devient elle-même un chantier d’aménagement (écrans, tunnels…pour conserver des formes de vies sauvages).
Le béton est devenu la norme mais il est inadapté aux régions chaudes (et donc à notre futur climatique) ou aux bâtiments pensés pour la « fraicheur artificielle ». Le greenwashing est notable et l’on propose du béton « bas », « très bas » ou même « ultra bas carbone » qui, malgré tout, reste difficile à réutiliser en l’état. Des logements sont vides et il y a peu de rénovation…on préfère hélas démolir et reconstruire. Comme le dit Marc Augé, « l’histoire à venir ne produira pas de ruines, elle n’en a pas le temps » !
Désarmer le béton : reprendre le bâtir et habiter la matière
La troisième partie débute par la question des attaques en justice pour tenter de déstabiliser le secteur (comme pour Total Energies). Il faut viser des points névralgiques car le secteur est très centralisé. Il faut en passer la désobéissance civile et les actions coordonnées, d’où les structures comme « les Soulèvements de la Terre ».
Il est nécessaire de revenir à une diversité pour enrayer le monopole. Le béton doit rester un luxe, il faut l’utiliser uniquement lorsque c’est strictement nécessaire. Il faut aussi créer des alliances et éviter le clivage entre écologistes et travailleurs du BTP. Il faut pourvoir retourner aux savoir-faire multiples et variés des artisans, maçons…
L’axe féministe est mobilisé dans cette dernière partie pour casser ce patriarcat. Il y a eu une évolution mais le plafond de verre est atteint au niveau de la part des femmes dans le secteur. Symboliquement, on peut se demander avec l’auteure « où trouver des EPI en taille 36-38 quand la plus petite taille de chaussures vendue en magasin commence souvent au 42 ? ». Il est difficile de se faire une place tant côté « chantier » que côté « ordinateur ». Les femmes enquêtées sont unanimes sur les comportements misogynes rencontrés dans leur quotidien.
L’architecture est à interroger en elle-même avec un excès de fonctionnalisme et de modernisme. La formation des architectes est aussi à questionner : elle apparait déconnectée du réel, du geste et de la matière avec des « choix faits sur catalogue avec des sens de l’odorat et du toucher qui restent inutilisés ». Peu d’entre eux se mobilisent pour combattre des projets incongrus.
Il faut prendre soin des murs par différentes méthodes afin de les rendre plus efficients. Il y a un paradoxe de la labellisation des performances énergétiques alors que la composition même des murs est négligée. Le béton non armé est finalement plus résistant que le béton armé. Il y a un énorme travail d’entretien du parc existant. On doit viser les matériaux biosourcés. La terre, la paille, le chanvre et le bois permettent d’atteindre l’indépendance et de chercher localement.
Avec ce témoignage de l’intérieur, Léa Hobson réussit parfaitement sa démonstration, ce qui donne toute crédibilité à son combat. Hybrider, sans rejeter totalement un béton qui peut être utile par moments, se veut le chemin le plus raisonnable pour que l’on puisse ré-habiter les lieux en tenant compte des nouvelles conditions climatiques. Un très bon essai à la plume fluide qui servira les enseignements de géographie liés à l’occupation et à l’aménagement des espaces.