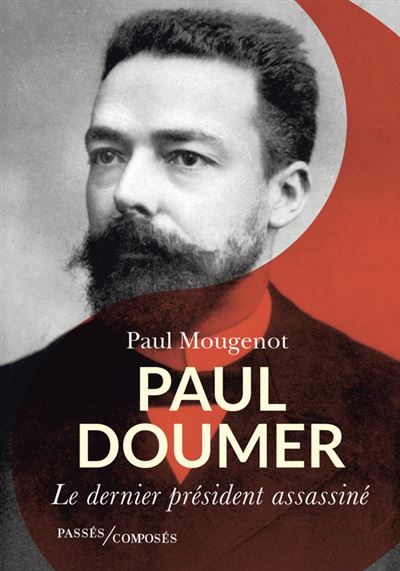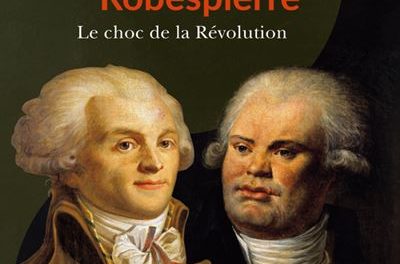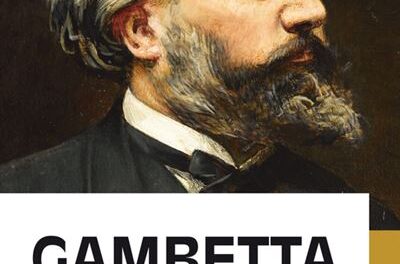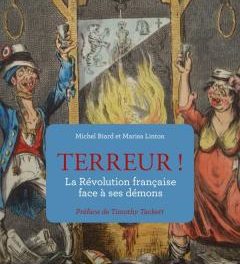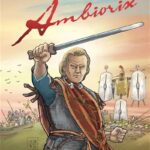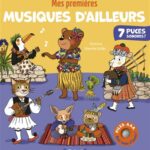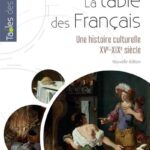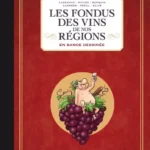En prologue, l’auteur, qui ne se présente pas comme historien, mais comme agriculteur et juriste, précise que sa biographie de Paul Doumer n’a pas vocation à égaler celle d’Amaury Lorin, lauréat du prix de thèse du Sénat en 2012 pour Une ascension en République. Paul Doumer (1857-1932), d’Aurillac à l’Élysée. Nonobstant, Paul Mougenot entend rendre justice au dernier chef de l’État français assassiné, aujourd’hui, sinon disparu, à tout le moins largement oublié de nos contemporains.
Agriculteur et juriste, Paul Mougenot partage sa vie entre l’Aisne et Paris. Ancien collaborateur parlementaire au Sénat, il est conseiller départemental du canton de Villeneuve-sur-Aisne depuis 2021 et premier adjoint au maire d’Aguilcourt. Il a été chargé d’enseignement en droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Les origines
Tout d’abord, l’auteur évoque la naissance de Paul Doumer dans le Cantal, dans un milieu ouvrier. Son père, longtemps présumé mort, mais en réalité déporté à la suite de la commune de Paris, est absent. C’est donc, élevé par sa mère, dans des conditions de vie fort modestes, que le jeune homme va vivre toute son enfance à Paris. Son certificat d’études, il exerce dès l’âge de 15 ans, le métier d’ouvrier graveur.
Nonobstant, grâce à des cours du soir, le jeune homme poursuit des études à la fois littéraires et scientifiques. Avec méthode et rigueur, il parvient à obtenir son baccalauréat à 19 ans. Devenu professeur de mathématiques dans un lycée, Paul Doumer épouse Blanche Richel, fille d’un inspecteur de l’enseignement primaire.
Le jeune enseignant, tout en passant une licence de droit, bénéficie de l’appui des réseaux maçonniques de son beau-père, pour commencer une carrière de journaliste, avant d’occuper les fonctions de rédacteur en chef d’une feuille radicale : Le Courrier de l’Aisne. Bientôt, il fonde La Tribune de l’Aisne, journal « radical radical ».
Journaliste, franc-maçon affilié au Grand-Orient de France, farouchement laïque, il fonde l’Association républicaine du canton de Laon avant d’être élu conseiller municipal, puis premier adjoint au maire du chef-lieu du département de l’Aisne, en 1885.
La carrière politique et coloniale
Élu local, Doumer ne tarde pas à goûter aux joies du combat politique pour la députation. En 1888, à l’occasion d’une élection législative partielle, il est élu député par défaut contre le général Boulanger, qui l’emporte, mais préfère représenter le département du Nord plutôt que celui de l’Aisne au Palais-Bourbon.
Le séjour de Paul Doumer à la Chambre des députés s’achève l’année suivante, par sa défaite face à un candidat boulangiste, à l’occasion des élections générales. Son travail parlementaire, notamment sur les questions de finances, a été remarqué en haut lieu. Aussi, le président du Conseil : Charles Floquet fait de lui son chef de cabinet. À l’occasion d’une élection législative partielle dans l’Yonne, avec l’aide du chef du gouvernement, Doumer se porte candidat à ce scrutin, qu’il remporte.
Par ailleurs, avec Léon Bourgeois et Charles Floquet, Paul Doumer fonde — tout en demeurant affilié au GODF — la loge Voltaire. Maçon actif, il est rapidement élu « vénérable maître en chaire » et siège au conseil de l’ordre du Grand Orient. Cet engagement maçonnique et ses qualités indéniables lui valent sa nomination comme ministre des Finances, dans le cabinet Bourgeois, à 38 ans.
Intransigeant face à l’augmentation des dépenses publiques, Doumer entend conduire une politique budgétaire rigoureuse. Il prône la mise en place d’un impôt global et progressif sur le revenu, dont l’instauration pourrait permettre à la France d’atteindre l’équilibre budgétaire qu’il appelle de ses vœux.
Avant de retrouver le ministère de Finances encore à deux reprises, Doumer est nommé gouverneur général de l’Indochine français pendant cinq ans (1897-1902). Durant son administration, Doumer crée l’École française d’Extrême-Orient et participe au développement du chemin de fer afin d’unifier l’ensemble de la péninsule indochinoise.
Un parlementaire en guerre
De retour en Métropole, ce bourreau de travail repart en campagne et fait son retour au Palais-Bourbon. Président de la prestigieuse commission du Budget de la Chambre, il ne tarde pas à se faire élire au perchoir en 1905. Président de la Chambre des députés, il se porte candidat à l’investiture suprême, mais voit le président du Sénat, Armand Fallières, lui ravir la victoire.
S’il est facilement réélu député en 1906, il est cependant battu quatre ans plus tard. Rejeté par les radicaux de l’Aisne, Doumer opte pour une candidature sénatoriale en Corse. Facilement élu, celui-ci siège au sein des deux plus prestigieuses commissions de la chambre basse : celle des Finances et celle de l’Armée. Doumer s’intéresse aux questions de politique nationale et internationale. La question de réarmement de la France le préoccupe au premier chef. Lorsque le premier conflit mondial éclate, il se met immédiatement au service du général Gallieni, gouverneur militaire de Paris et devient son chef de cabinet civil. S’il fait la guerre depuis le gouvernement militaire de Paris et depuis le Sénat, ses cinq fils la vivent sur le front. Quatre d’entre eux mourront au champ d’honneur.
En 1917, il est appelé au gouvernement comme ministre d’État et membre du Comité de guerre. Il n’est cependant pas reconduit dans ces fonctions lorsque Clemenceau accède à la présidence du Conseil. Au sortir de la guerre, auréolé d’un prestige qui transcende les clivages politiques, Doumer est vu comme le possible successeur du président de la République, Raymond Poincaré.
Le second personnage de l’État
Réélu en terres corses aux élections sénatoriales de 1921, rapporteur général du budget, Doumer continue de s’intéresser aux questions financières, notamment à l’impôt sur le revenu et au système fiscal dans sa plus large acception. Vingt-cinq ans après sa première nomination, Doumer retrouve le portefeuille des Finances.
À ce titre, il négocie le montant des réparations dues par l’Allemagne, lors de la conférence de Londres. Sa nomination comme gouverneur général de l’Algérie, un temps envisagée, Doumer reste au ministère des Finances jusqu’en 1924, où il retrouve le Sénat et sa commission des Finances qu’il préside l’année suivante. De retour rue de Rivoli pour quelques mois seulement, Doumer ne parvient pas à former un gouvernement homogène, comme l’en avait chargé le président de la République.
La défaite du président de la haute assemblée lors des élections sénatoriales de 1927 permet à Doumer son élection à la présidence du Sénat. Réélu sénateur de la Corse en 1929, Doumer est facilement reconduit au plateau, chaque année, jusqu’en 1931.
L’Élysée
Alors que son septennat touche à sa fin, le président Gaston Doumergue fait savoir qu’il n’entend pas briguer un second mandat. Président du Sénat, Doumer est naturellement désigné pour présenter sa candidature. Cependant, beaucoup de parlementaires de gauche lui reprochent son nationalisme belliqueux, et lui opposent Aristide Briand, chantre du pacifisme.
Élu le 13 mai 1931, grâce à l’appui du centre et de la droite, Doumer demeure cet homme austère, hostile aux fastes, tout comme au dispositif de sécurité qui l’entoure à l’occasion de ses voyages officiels. Alors qu’il inaugure le salon annuel des écrivains combattants, le chef de l’État est assassiné par un russe vert, Paul Gorguloff, qui lui tire deux balles de pistolet à bout portant.
Conclusion
Sans prétendre à l’érudition académique, lui-même le reconnaît fort modestement, Paul Mougenot, dans une écriture simple, usant parfois d’un ton familier — qui peut rebuter un public académique — entend redonner vie à ce personnage austère, d’une rectitude morale rare, qu’était Paul Doumer, président de la République pendant dix mois seulement.
N’usant pas de la distance critique de l’historien, l’auteur écrit avec son cœur, moins pour le chef de l’État que pour celui qui fut, parmi ses nombreux mandats, conseiller général du département de l’Aisne, à l’instar de son hagiographe.