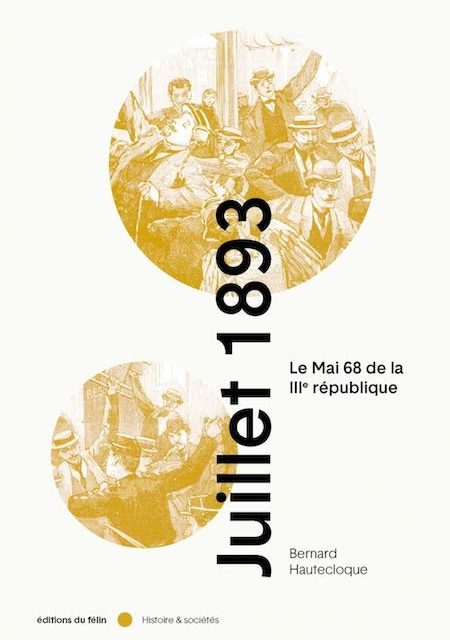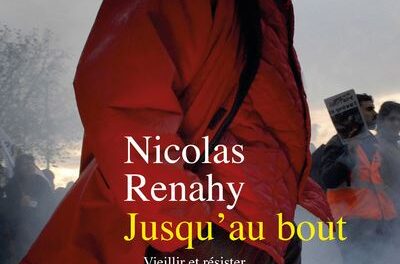Linguiste et agrégé de géographie, Bernard Hautecloque est aussi historien et écrivain. Membre de la Société Française d’Histoire de la Police (SFHP), il est l’auteur d’ouvrages sur l’histoire criminelle en France. On lui doit, entre autres : Brigands, bandits, malfaiteurs. Incroyables histoires des crapules, arsouilles, monte-en-l’air, canailles et contrebandiers de tous les temps (2016), Les affaires criminelles non élucidées (2019). Sa seconde spécialité, outre l’histoire de la criminalité, est l’histoire des relations internationales avant 1914.
Cette publication de 117 pages inclut une introduction (p. 9-14), 12 chapitres (p. 15-101), une conclusion (p. 103-104), une bibliographie (p. 105-108), des références bibliographiques (p. 109-117).
Le Quartier Latin, lieu estudiantin et agité
En quelques pages introductives, l’auteur nous dépeint succinctement l’histoire du Quartier Latin. Il nous le présente, depuis son installation au XIIe siècle sur la rive gauche de la Seine et comment il devint le théâtre d’une vie étudiante hétéroclite et haute en couleurs, du Moyen Âge au XIXe siècle.
Durant les trois premiers chapitres de son ouvrage (I, II et III), Bernard Hautecloque s’intéresse à la sociologie de ce Quartier latin, véritable ville dans la ville. Ainsi nous apprenons qu’en 1893, seulement 20 000 étudiants et auditeurs libres y fréquentaient les universités, les bibliothèques ainsi que les classes préparatoires. À cette époque le Quartier latin concentrait en son sein la plus grande concentration étudiante du monde.
Presque exclusivement issue de la bourgeoisie ou de la noblesse, cette jeunesse (à 98 % masculine) était sûre d’elle-même et suffisante. Frondeuse et insouciante, volontiers brutale et xénophobe, cette jeunesse beaucoup moins politisée qu’on ne le croit généralement, évoluait dans un quartier de la capitale insalubre et surpeuplé, lieu de débauche et de beuveries. Aussi le Carnaval était-il pour ces jeunes gens sortis depuis peu de l’enfance, synonyme de lâcher-prise !
Sortis des amphithéâtres, la plupart ne songeaient qu’à se regrouper pour faire la fête, chanter, boire plus que de raison et bien souvent se confronter aux forces de l’ordre.
Dans les trois chapitres suivants (IV, V et VI), l’auteur montre combien les échauffourées entre étudiants et policiers étaient quotidiennes. À cette époque les interventions musclées de la police étaient la règle. Si les hommes de la préfecture de police ne retenaient pas leurs coups, les jeunes gens qui leur faisaient face ne retenaient pas les leurs non plus.
L’origine des manifestations : le carnaval 1893
Bernard Hautecloque s’intéresse tout particulièrement au Carnaval du 8 février 1893, point de départ du sujet de son ouvrage. La présence de femmes dénudées lors de ces festivités remonta jusqu’à la place Vendôme, après que le sénateur René Bérenger, connu sous le sobriquet de « Père La Pudeur », s’en fut offusqué auprès du garde des sceaux. L’affaire fut portée devant le tribunal de la Seine le 30 juin suivant. Les organisateurs du carnaval et les naïades dévêtues furent sanctionnées et le parlementaire puritain conspué par les étudiants venus en nombre devant son domicile le lendemain du jugement.
Souhaitant ne pas perdre la face devant ces étudiants potaches, qui avaient passé la Seine pour aller chahuter un élu de la République, le préfet de police Lozé envoya ses effectifs place de la Sorbonne afin de mâter cette rébellion étudiante. L’ordre fut donné aux policiers de charger les manifestants. C’est alors que s’ensuivirent de violentes échauffourées, chaque camp renvoyant à l’autre tout ce qui passait entre les mains. Cette intervention de police ne ressemblait en rien à un service de maintien de l’ordre comme nous les connaissons aujourd’hui, mais avait toutes les apparences d’un lâcher de bêtes enragées prêtes à fondre sur d’autres animaux sauvages tout aussi violents.
C’est au milieu d’une pluie de projectiles entre camps rivaux que le drame intervint. Antoine Nuger, employé de commerce de son état, perdit en effet la vie à cette occasion, mortellement blessé au crâne par un projectile lancé de nulle part, alors qu’il prenait un verre au Café Harcourt. Les souvenirs des évènements de la Commune étaient encore bien présents dans la mémoire collective parisienne. Aussi la question du maintien de l’ordre dans la capitale était-elle une question majeure. Pour le pouvoir en place, peu importait la manière du moment que Paris restait debout. Paris tombée, c’était la France qui inexorablement la suivrait dans sa chute !
Il existait un usage reconnu de tous, une loi non écrite du maintien de l’ordre. Les agents de police pouvaient taper autant qu’ils le souhaitaient sur les manifestants. Nonobstant, seule la mort d’un homme était proscrite. Malheureusement, encore fallait-il faire entendre raison à des individus peu ou pas formés au métier de policer. À cette époque les agents de police étaient bien souvent d’anciens miliaires qui n’avaient reçu aucune formation au métier de policier, admis à la préfecture de police par cooptation et dont la mission première était de se faire craindre de la population.
L’escalade
Au cours des trois chapitres suivants (VII, VIII et IX), l’auteur dépeint une atmosphère de tension extrême dans la capitale. L’annonce de la mort d’un innocent, victime collatérale de ces affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, devait soulever une indignation générale dans la capitale. La presse de droite et de gauche ne manquaient pas de s’associer aux étudiants, qui appelaient à la vengeance. Le lundi 2 juillet, Près de 2000 étudiants se rendirent devant la Chambre des députés et le Sénat pour hurler leur indignation, avant de se rendre devant la préfecture de police, où ils subirent les assauts des agents de la préfecture. Devant les proportions que prenait cette révolte étudiante, le gouvernement modéré du placide Charles Dupuy, hésita à rétablir l’ordre par la force, craignant un véritable bain de sang.
Ébranlé sur ses fondations, le pouvoir en place se hésita, dans un premier temps, à faire appel à la troupe pour mater cette révolution en gestation alors qu’au même moment, la grève de quelque 12 000 cochers frappait la capitale.
La préfecture de police devait en effet « combattre » sur deux fronts distincts et ses agents subir les assauts, qui des étudiants, qui des cochers de Paris. Contre toute attente, bien que luttant contre un même ennemi, grévistes et étudiants ne fraternisèrent jamais. Les revendications étaient différentes et l’idée ne leur vint même pas de s’unir contre les forces de l’ordre. Même les anarchistes, pourtant très actif à la même époque, ne tentèrent pas de récupérer à leur avantage ces menées étudiantes.
La fin des manifestations étudiantes
Dans les trois derniers chapitres (X ; XI et XII), l’auteur survole les derniers jours de cette révolte étudiante. Le 5 juillet, jour des funérailles du malheureux Antoine Nunger, dont les journaux avaient dévoilé l’identité, tout en précisant que le défunt n’était pas étudiant, les violences redoublèrent dans le Quartier Latin. Les premières barricades furent dressées le 5 juillet aux cris de « Vive la Commune ! », « Vive l’anarchie ! »
Les manifestants ne cessaient de se regrouper après chacune des charges de la police. Lors-qu’incidemment, ils apprirent que le corps du défunt avait été exfiltré hors de Paris, les manifestants redoublèrent de violence. Le pouvoir était à tel point vacillant, que le président de la République Sadi Carnot, alors en province, se décida à regagner la capitale. Le gouvernement se résigna finalement à faire appel à la troupe pour rétablir l’ordre. Ce fut cette décision qui amena à une sortie de crise.
L’arrivée de la troupe dans Paris le 7 juillet fut favorablement accueillie par la population. Les soldats jouissaient d’une reconnaissance publique dont souffraient les forces de police. Cette présence militaire permit au Quartier latin de recouvrer son calme. Néanmoins, alors que les étudiants s’en retournaient à leurs chères études, les cochers parisiens continuaient à s’opposer aux forces de l’ordre. Les festivités du 14 juillet et la nomination d’un nouveau préfet de police eurent pour conséquence directe d’apaiser les esprits.
Ébranlé par ces manifestations étudiantes, le gouvernement avait invité le préfet de police Lozé à partir sous d’autres cieux. Nommé ambassadeur de France à Vienne, celui-ci fut remplacé par le préfet de Seine-et-Oise, Louis Lépine, qui débutait un règne de près de vingt années à la tête de la préfecture de police de Paris. Populaire, ce haut-fonctionnaire aimait sincèrement les policiers et œuvra pour améliorer leurs conditions de travail, mais surtout instaurer en leur sein une discipline, une éthique ; en un mot, un professionnalisme. Ayant retenu les leçons des émeutes du Quartier latin, il se pencha tout particulièrement sur cette question ô combien stratégique du maintien de l’ordre dans la capitale. Ce travail de fond permit de porter au crédit du préfet Lépine, le fait de ne compter aucune mort de manifestants durant son « règne », entre 1893 et 1913, à la préfecture de police.
Juillet 1893 : le « mai 68 » de la IIIème République ?
L’auteur conclut son ouvrage en considérant ces manifestations de juillet 1893 comme n’étant qu’un feu de paille qui tel les orages d’été, fut aussi violent qu’éphémère. Différentes de celles de 1968, les manifestations de 1893 n’étaient en rien politiques. Les étudiants ne soulevèrent aucune revendication. Les émeutes de juillet 1893 furent différentes par leur ampleur, mais pas par leur nature, elles demeuraient des violences endémiques au Quartier Latin.
Cet ouvrage nous éclaire sur ce qu’était le monde étudiant dans ce Quartier latin de la fin du XIXe siècle. Bernard Hautecloque nous plonge ici dans un quartier parisien sombre, malfamé, dans lequel étudiants et délinquants de droit commun cohabitaient. Cette coexistence entre ces deux mondes, cette porosité entre chacun de ces groupes sociaux joua très certainement dans cette propension des étudiants parisiens à user de la violence face à des fonctionnaires de police, sans déontologie ni formation professionnelle. En outre, le parallèle entre juillet 1893 et mai 1968 est frappant pour ce qui est des violences entre manifestants et policiers.
En 1893, les forces de l’ordre pouvaient frapper aveuglement avec pour seule consigne de ne pas tuer. Durant les manifestations de 1968, les compagnies républicaines de sécurité (CRS), formées au maintien de l’ordre, astreintes à un code de déontologie propre à leur profession, durent user de la force strictement nécessaire pour rétablir l’ordre. Cependant ils entendirent les étudiants les qualifier de « CRS, SS ». In fine, cet ouvrage de Bernard Hautecloque a le mérite de relativiser et mettre en perspective les rapports de force et de violences entre étudiants et manifestants à 75 ans d’intervalle.