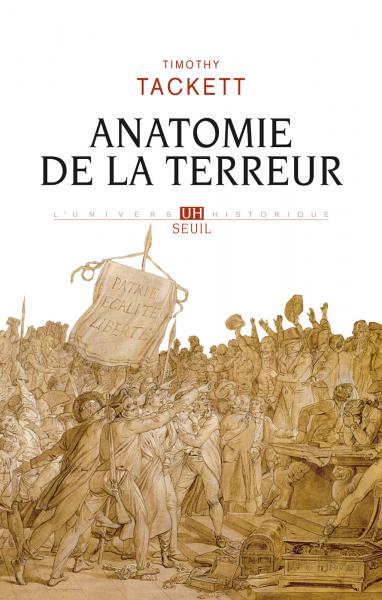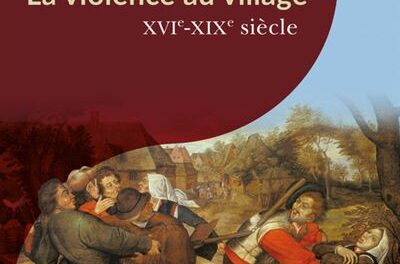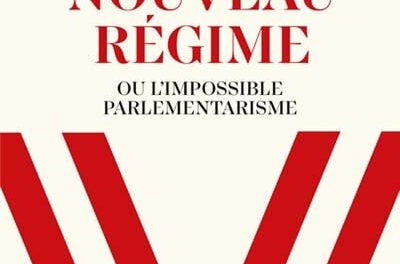Dans ces temps quelque peu troublés où la démocratie semble montrer des signes de faiblesse ici ou là et au sein même de l’Europe, il est toujours salutaire de revenir et de s’interroger sur les moments de l’histoire qui ont aussi connu de telles incertitudes politiques.
Après l’ouvrage d’Annie Jourdan qui ré-explore le processus révolutionnaire au prisme de la guerre civile, c’est au tour de l’historien américain, Timothy Tackett, qu’on ne présente plus depuis son excellent ouvrage sur les députés de 1789, peut-être un des meilleurs ouvrages parus depuis 1989 sur la Révolution, de se pencher sur le phénomène de la violence révolutionnaire.
Pour ce faire, Tackett décide de choisir un angle d’attaque inédit, pour analyser l’émergence de la violence au cours du processus révolutionnaire, celui de l’évolution des mentalités, de la psychologie des élites politiques et de l’influence de l’émotionnel sur leurs prises de décisions. Ainsi, par ce biais, l’historien américain souhaite se défaire des polémiques d’interprétation de la Terreur pour se concentrer non sur l’aspect purement politique, institutionnel et théorique mais celui plus concret de l’individu, afin de nous proposer une histoire revisitée de la terreur, « au ras du sol », en quelque sorte.
Un rapport ambigu des députés du Tiers à la violence d’Ancien Régime
Dans un premier temps, Tackett dresse un rapide portrait de la société française à la veille de 1789. Ici, rien de bien nouveau et on se reportera largement à son premier ouvrage mais l’auteur prend le temps de s’interroger sur deux aspects de la mentalité des futurs révolutionnaires, l’esprit des Lumières et leur rapport à la violence.
L’auteur nous rappelle ainsi à juste titre que si les futurs révolutionnaires entretenaient un rapport familier avec les philosophes des Lumières, c’était moins dans un aspect purement idéologique qu’épistémologique. En un mot, c’était moins les idées démocratiques de Rousseau qui rassemblaient les futurs révolutionnaires qu’un « esprit des Lumières » que l’auteur résume habilement par l’audace, la foi dans le talent individuel de chacun plutôt que dans un programme idéologique.
Enfin, l’auteur se penche sur le rapport à la violence qu’entretiennent les futurs révolutionnaires avec la violence d’Ancien Régime et là aussi, il est difficile d’en tirer des généralités pour l’avenir et l’ambiguïté domine. Mais de manière globale, la violence collective et populaire répugnait ces gens de lettres et s’ils n’étaient pas des fervents défenseurs de la peine capitale, ils n’étaient pas forcément des abolitionnistes et la défendaient même pour le crime de trahison. De plus, ils toléraient les exécutions publiques voire souvent se mêlaient à la foule amassées devant le spectacle…
A l’origine de la radicalisation des députés du Tiers, intransigeance nobiliaire et soutien populaire
Après avoir rappelé de manière classique mais efficace les problèmes financiers de la monarchie, l’auteur résume là aussi son premier ouvrage en avançant deux premières explications à la radicalisation politique des députés du Tiers lors du mois décisif de juin 1789 : le mépris et l’intransigeance des députés de la noblesse et du haut clergé soutenu par la monarchie mais aussi et surtout, la ferveur et le soutient populaire que reçoivent ces députés du Tiers.
En effet, ces députés, déjà expérimentés par deux années d’élections et de débats, n’en sont pas moins assaillis de doutes et de craintes une fois quittée l’effervescence de la salle de réunion dans laquelle furent prises les premières décisions révolutionnaires et le soutient populaire qu’ils purent recevoir dans les rues les conforta sans nul doute dans leur voie.
A l’origine de la violence révolutionnaire, peur, rumeurs et déceptions, la naissance d’une culture du soupçon, le tournant de 1791
Les élections des États-généraux avaient fait naître un grand espoir parmi le peuple, mais les incertitudes des mois de mai et juin associées à la plus grande hausse du prix des grains du XVIIIe siècle générèrent une grande tension au sein des populations et notamment celle de Paris redoutée pour ses excès de violence dont l’attaque de la manufacture Réveillon en avril 1789 en fût une énième confirmation.
Selon Timothy Tackett, les violences de l’été 1789, à Paris puis en province, sont dues à une conjonction de facteurs inédits : la peur d’une réaction militaire de la part du roi alimentée par d’innombrables rumeurs de soldats, de brigands et de disette provoqua dans certains cas le besoin de s’armer, de s’organiser pour se protéger d’où la prise de la Bastille, la constitution d’une garde nationale à Paris ou des renversements de municipalités en province allant jusqu’à l’attaque de châteaux…
Ce sentiment de peur ne disparut pas à la fin de l’année et avec l’arrivée du roi à Paris. Au contraire, pour Tackett, c’est un des soubassements de la terreur. Cette peur fit alors naître, au fur et à mesure que se mentirent en place les premières réformes de l’Assemblée Constituante, une culture du soupçon entretenue par la rumeur du complot révolutionnaire. Les figures de cette opposition contre-révolutionnaires se dessinèrent au détour de l’année 1790 avec l’émergence des prêtres réfractaires puis des nobles émigrés[1] avant que n’y virent s’y ajouter la figure royale en juin 1791…
Cette suspicion croissante chez les patriotes trouva son point d’orgue dans la fuite du roi dont les mémoires de ses ministres ont souligné le double jeu. Ici, Thimoty Tackett insiste sur le rôle de la reine qui presse dès 1789 pour quitter Paris et l’indécision légendaire du roi. Cette fuite discrédita considérablement le roi dans l’esprit d’une partie de la population et par conséquent sur l’Assemblée qui souhaitait le maintenir pour sauver sa Constitution. Et c’est dans ce contexte que survint une rupture fondamentale pour Tackett dans la Révolution avec la fusillade du Champs de Mars du 14 juillet 1791 et le franchissement du seuil de la violence d’Etat. A ce moment-là, les patriotes républicains devinrent à leur tour suspects car complotistes en s’opposant à l’autorité de l’Assemblée.
Des espions de la police circulaient en civile dans les rues de la capitale, la censure était rétablie depuis 1789 et des journalistes conservateurs comme républicains à l’image d’un Desmoulins ou d’un Marat durent se cacher…
Une vague de suspicion s’empara alors des autorités locales dans toute la France, on surveilla les étrangers, les propos, on éplucha les courriers…
De l’espoir à la peur, l’instabilité émotionnelle du peuple de France
En se fondant sur son échantillon de correspondance, Timothy Tackett met le doigt sur ce qui pourrait constituer le cœur même du réacteur de la terreur sous la Révolution à savoir les contradictions émotionnelles qui assaillent et tourmentent les Français, humbles comme élite, ruraux comme urbains.
Bien loin des considérations politiques théoriques furétiennes, l’auteur se penche sur le concret de l’intime et du psychologique pour démasquer les ressorts humains plus qu’institutionnels de la terreur.
Ainsi, dès les débuts de la Révolution, l’espoir a côtoyé quotidiennement la crainte en fonction de l’actualité révolutionnaire : crainte de l’anarchie pour les uns, crainte de réformes trop tièdes ou chimériques pour les autres, euphorie et confiance lors de la fête de la fédération puis peur des armées émigrées…. Le printemps 1791 constitua alors pour l’auteur un des moments les plus éprouvants pour « ses » correspondants gagnés par une inquiétude croissante alimentée par deux phénomènes, deux rouages essentiels de la terreur, la rumeur et la dénonciation.
Selon l’auteur, ce qui change avec la Révolution, c’est que la rumeur se politise et emplit l’espace quotidien grâce à l’émergence d’une presse politique non censurée, aux colporteurs « rugissant[2] » les nouvelles et de nouveaux lieux de sociabilité politique tels les sections, les clubs, gardes nationales…
La crainte est également favorisée par l’apparition d’une pratique encouragée par les patriotes dès les débuts de la Révolution, la dénonciation. Le journalisme constitua le vecteur essentiel de cette pratique dont il représenta chez certains, le cœur de l’activité comme chez un Brissot, Desmoulins et bien sûr le maître, Marat…
A ses côtés, les comités de surveillance des sociétés populaires firent de la dénonciation une quasi-institution implantée dans tout le pays grâce à leur réseau d’affiliation.
Et derrière la dénonciation se dessinait alors peu à peu le spectre du complot. En effet, l’auteur, à l’aide de l’exemple de la société populaire de Bordeaux affiliée comme beaucoup aux Jacobins, remarque que les personnes dénoncées sont au fil des années de moins en moins des réfractaires ou des nobles mais des membres du club lui-même ! A l’automne 1792, ils s’accusaient exclusivement entre-eux ! Tackett l’explique par les jalousies liées à l’exercice de responsabilités mais également à l’émergence de la figure du complotiste caché derrière « le masque du patriotisme »[3].
Très vite, ce tribunal de l’opinion s’institua : un Comité des recherches est crée dès l’été 1789.
Cette culture de la dénonciation généra alors selon l’auteur un climat généralisé de suspicion et de terreur quotidienne préfigurant la Terreur institutionnelle de 1793-1794[4].
Enfin, cette obsession du complot fit naître un « style paranoïaque de la politique » que Timothy Tackett explique par le contexte de crise et de bouleversements que crée la Révolution mais également par quelques signes de conspirations réels dès juin 1789 mais surtout avec la fuite du roi à Varennes qui donne corps à toutes ces rumeurs. Le complot, comme le rappelle l’auteur, était un élément commun de la culture populaire sous l’Ancien Régime, mais la nouveauté ici est que la Révolution en a favorisé son passage dans l’univers mental des élites.
En résumé, et c’est ici le cœur de la démonstration de Tackett, la Terreur est avant tout le fruit d’un changement psychologique des élites révolutionnaires. Ce changement est né d’une maturation assez rapide entre rumeur, délation, incertitude des lendemains et aboutissent à un dernier phénomène constitutif de la terreur, la diabolisation de l’adversaire. Cette diabolisation repose selon l’auteur sur l’émergence complexe d’un phénomène de colère et de haine collectives façonnant alors une nouvelle culture politique tant chez les gouvernants que le peuple.
Le jeu des factions, catalyseur de la terreur
L’autre ingrédient essentiel aux côtés de la tension émotionnelle et qui conduit à la terreur selon Tackett est ce jeu des factions politiques qui se développe avec le renouvellement des députés en octobre 1791.
L’origine de ces factions n’est pas évidente à démêler car idéologiquement, Feuillants et Jacobins auxquels s’ajoutent les Girondins, sont très proches : la monarchie constitutionnelle est alors le seul horizon politique, l’égalité des droits est défendue par tous… Seule la relation et la vision des masses populaires les départagent ainsi qu’une vision de la société plus collective pour les Jacobins et plus individualistes pour les Feuillants[5].
Quoiqu’il en soit, cette rivalité née de la fuite du roi pris un tour nouveau selon l’auteur à partir de l’automne 1791 avec la crainte de la « grande conspiration »[6] et la paranoïa croissante des nouveaux députés[7]. En effet, ce nouvel état d’esprit caractérisé par la culture du soupçon favorisa alors la radicalité dans les propos et l’affrontement politique à l’Assemblée. Cette radicalité aboutit à une scission au sein même des Jacobins entre robespierristes[8] et brissotins dès décembre 1791 au sujet de l’entrée en guerre.
Tackett nous décrit alors une mécanique implacable selon laquelle l’identification à une faction devient absolue et la confrontation ne peut aboutir qu’à la destruction de l’adversaire. Cette lutte pour le pouvoir entre Feuillants et Jacobins puis Jacobins (Montagnards) et Girondins cache donc une lutte pour la survie qui la rend absolue et indépassable.
Cette lutte des factions entraîna dans sa suite le peuple de Paris, les « sans-culottes », mobilisés par des militants des deux camps au sein des clubs et en particulier des Cordeliers à coup de pétitions, manifestations, banquets et défilés dans l’Assemblée…
La guerre, accélérateur des divisions et de la radicalisation politiques
La question de l’entrée en guerre a longtemps divisé les historiens. Selon Tackett, celle-ci est la conséquence de la radicalisation politique à propos du sort des émigrés et des réfractaires et du jeu des factions. Mais il souligne également l’importance de l’émergence d’un fort sentiment d’identité nationale née au cours de la Révolution, faisant de la défense de celle-ci un impératif absolu.
Si les factions au sein de l’Assemblée firent taire un temps leurs querelles pour déclarer avec grand enthousiasme la guerre à l’Autriche et son allié prussien, les premières défaites ou débandades de l’armée française réactivèrent les suspicions et les affrontements politiques. Devant l’échec de leur politique guerrière, les Girondins, pris dans leur fuite en avant, condition sine qua none de leur survie politique (et physique), furent tentés de relancer le thème de la grande conspiration intérieure ourdie par « le comité autrichien ».
Le spectre du complot mis Paris en état de tension permanente mais permis le vote de mesures radicales comme la suppression de la garde personnelle du roi ou la déportation des prêtres réfractaires sur dénonciation de vingt citoyens. Le veto du roi et le remplacement des ministres girondins eut pour effet de mobiliser le peuple parisien qui manifesta, encadré par des militants des sections, devant l’Assemblée et les Tuileries, le 20 juin 1792. La manifestation se transforma en démonstration de force, une délégation, armes à la main défile dans l’Assemblée en intimidant les Feuillants puis se dirigea ensuite vers le palais des Tuileries dont les gardes nationaux cédèrent le passage. Si le roi ne fut pas menacé physiquement, l’épisode suscita de vifs débats dans le royaume les semaines suivantes et l’Assemblée, submergée de lettres, vit sa bipolarisation s’accentuer entre Montagnards et Feuillants. Les Girondins voyaient alors leur position fragilisée et espéraient encore de convaincre le roi de revenir sur ses vetos. L’épisode de La Fayette renforça la théorie du complot et la thématique de la trahison pour les radicaux.
C’est aussi ce thème qui est repris par les gardes nationaux arrivés de toute la France à Paris et les nombreuses pétitions des clubs jacobins du pays pour demander à l’Assemblée la destitution du roi.
Sous la pression du peuple, l’Assemblée se décida, malgré l’opposition des Feuillants et l’indécision des Girondins, à examiner la question. Mais elle fut reportée et le cas La Fayette qui avait menacé l’Assemblée en juin, fut classé sans suite.
Si la majorité des sans-culottes et des gardes nationaux de Marseille et d’ailleurs souhaitait un règlement pacifique de la question du roi, c’est une nouvelle fois des rumeurs de complot se tramant aux Tuileries qui provoquèrent l’attaque du palais.
Ainsi, la guerre, devenue toile de fond de la Révolution, renforça les sentiments de peur, méfiance et suspicion et accrédite la thèse du complot contre-révolutionnaire.
La première terreur et l’incertitude du pouvoir, la dilution de l’autorité
Poursuivant toujours dans une perspective chronologique, l’auteur s’attache à expliquer les ressorts de la première véritable terreur née à la suite de la chute de la monarchie en août 1792.
Si cette chute clarifia la situation politique au sein de l’Assemblée[9], elle posa un grand défi d’autorité à celle-ci avec l’émergence de pouvoirs parallèles à Paris : Commune insurrectionnelle, sections parisiennes et club des Jacobins lui disputaient alors l’exercice du pouvoir et la voix du peuple.
Le concurrent le plus dangereux était la Commune de Paris dont le conseil composé de militants radicaux, boutiquiers et artisans sans-culottes qui avaient dirigé l’insurrection jouissaient alors d’un certain prestige. La Commune, très méfiante à l’égard de l’Assemblée, exerça un pouvoir autoritaire sur Paris en traquant et arrêtant les opposants concurrençant même la Législative en envoyant des émissaires en province et lui pressant d’instaurer un tribunal d’exception[10].
Les sections jouissaient également d’une grande autonomie à l’égard de la Commune et affirmaient la mainmise sur leur quartier grâce à leur comité de surveillance. Cette situation politique complexe aux multiples autorités concurrentes généra une forte instabilité politique dans la capitale, situation attisée par le réveil de la rivalité entre Girondins et Montagnards à propos de la situation du roi, suspension ou déchéance ?
La bataille des Tuileries ne mit pas un terme à la peur et à la suspicion, au contraire. La persistance de ces sentiments, l’auteur l’explique par la dilution de l’autorité et les multiples pouvoirs, mais également l’important désir de vengeance à l’égard des traites ayant soutenu la monarchie[11]. Un comité de surveillance municipal est crée afin de traquer traites, opposants, journalistes et ministres royalistes.
Mais la rapide percée des Prussiens, mi-août, accentue la peur et réveille les suspicions de trahison des chefs militaires et poussent les autorités à organiser à Paris une vaste fouille, à la fin du mois.
Ces peurs se cristallisèrent autour des prisons parisiennes, lieux de secret d’Etat et symboles du pouvoir arbitraire, et en firent le point de départ d’une vaste conspiration et d’une future évasion.
Le 2 septembre, l’annonce de la chute de Longwy puis de Verdun poussèrent la Commune et les sections à mobiliser le peuple pour la défense de la ville. Cette mobilisation se dirigea, telle une sorte d’exutoire, vers les prisons au hasard d’un convoi de prisonniers transféré à la prison de l’Abbaye. Les quatre jours suivants, la plupart des prisons parisiennes furent vidés de leurs occupants et on dénombra entre 1100 et 1400 exécutions. Les tentatives d’enrayer le massacre par les autorités, députation envoyée par la Législative et garde nationale se révélèrent inefficaces.
Les auteurs supposés de ces massacres seraient des volontaires et gardes nationaux de province qui auraient participé au 10 août et Tackett tente d’expliquer ce mouvement par une volonté de vengeance et de service rendu à la ville pour la sécurité de la population. Mais le plus important peut-être ici et que l’auteur souligne, est le consensus et le peu de condamnation que suscitèrent ces massacres, même de la part des élites parisiennes.
L’émergence d’une nouvelle culture politique entre (affrontements) rhétorique et violence
Le procès du roi qui s’engage en décembre 1792 laissa des traces chez les députés comme le suggère Tackett. En effet, il renforce le processus de diabolisation de l’adversaire, à l’œuvre dès 1789. Ici, le roi bien-aimé, père de son peuple devient un monstre, une bête féroce, un barbare[12]…
Ce qu’il y a de nouveau en 1792, c’est que la diabolisation aboutit à l’extermination de l’adversaire, marquant, selon Tackett, une nouvelle étape dans la radicalisation des luttes politiques[13] et notamment celle qui reprend par la suite entre Girondins et Montagnards.
Cette nouvelle culture politique que repère l’auteur se caractérise également par une volonté d’une grande partie des députés de s’identifier au peuple et ainsi d’exprimer les nouveaux idéaux démocratiques[14].
Dans le même temps, la culture politique évolue également chez les militants parisiens des clubs et des sections. On se rencontre dans les cafés et réunions publiques de sections ou de clubs et on s’affronte à coups de rhétorique mais plus sûrement d’invectives grossières et de propos diffamatoires attisant la haine et la peur[15]. Les idées se radicalisent aussi et la diffusion des idéaux démocratiques fit naître des envies de mesures radicales comme le maximum ou la confiscation et redistribution des biens des riches. Les plus extrémistes, les « enragés » adoptent aussi leur style vestimentaire composé du bonnet phrygien, de la moustache et parfois la pique…
Cette radicalisation est attisée par une presse populaire au langage cru et coloré et encourage pétitions, manifestations et défilés à l’Assemblée mettant ainsi la Convention sous la pression quasi journalière du peuple parisien, majoritairement pro-montagnards.
Mais une fois de plus, la guerre devient l’accélérateur de la radicalisation. En décidant de son extension et en votant une levée de 300 000 hommes supplémentaires, la Convention déclencha une véritable insurrection dans plusieurs provinces, notamment de l’Ouest. Face à cette menace qualifiée de contre-révolutionnaire, aux désastres militaires se succédant et à la trahison de Dumouriez, les députés mettent en place toute une série d’institutions répressives, c’est la structuration de la Terreur en mars-avril 1793. Ils décident d’envoyer en province des « représentants du peuple » chargés d’organiser le recrutement et les réquisitions pour les armées mais aussi de réprimer et de purger s’il faut les autorités locales. Puis, mettent en place un Tribunal révolutionnaire, des comités de surveillance sont créés dans chaque municipalités afin de vérifier les passeports des étrangers et d’encourager les dénonciations.
Enfin, longtemps repoussé par les Girondins par crainte d’une dictature, un Comité de salut public est créé le 6 avril, dominé dans un premier temps par les Montagnards et, autre décision lourde de conséquences, l’immunité parlementaire est supprimée.
Dans ce contexte de tensions et de menaces multiformes, la lutte entre Girondins et Montagnards s’intensifia. Les Girondins profitèrent du départ en mission de nombre de Montagnards pour prendre le pouvoir à la Convention et déféré devant le Tribunal le député Marat qui fût cependant acquitté et porté en triomphe. Les Girondins ripostèrent en créant une Commission des Douze chargée de s’attaquer aux radicaux parisiens dont Hébert, arrêté.
Les militants parisiens réagirent et s’organisèrent à partir du 30 mai en défilant quotidiennement durant une semaine et en encerclant la Convention afin de réclamer la suppression de la Commission et l’arrestation des Girondins : le 31 mai, au son du tocsin, ils défilèrent à l’Assemblée qui abolit la commission et le 2 juin, la Commune ordonna à Hanriot, commandant de la garde nationale, d’encercler la Convention pendant qu’une délégation posa un ultimatum. Devant la pression des gardes, les députés ordonnèrent l’arrestation de vingt-neuf députés girondins.
Les rouages de la Terreur se mirent en place de manière improvisée, sous les coups conjoints de la menace extérieure, de la révolte dans les provinces et de la pression parisienne. Aucun plan, nous rappelle Tackett, est ici à l’œuvre, et d’insister sur les sentiments antagonistes qui étreignirent alors les députés depuis l’été 1792, un mélange de passion et de méfiance qui les mirent quotidiennement sous pression. Ce sont ces sentiments qui modifièrent et radicalisèrent profondément leur état d’esprit et leur culture politique en acceptant l’usage de la violence[16] comme nécessité afin de sauvegarder les acquis de la Révolution.
La victoire des Montagnards et la politique de l’intransigeance
Juin 1793, à la menace militaire aux frontières s’ajouta la « menace fédéraliste » à l’Ouest et au Sud. Des mouvements s’organisèrent autour des villes de Caen, Bordeaux, Lyon, Toulon et Marseille pour soutenir les Girondins et marcher sur Paris mais furent circonscrits rapidement[17].
Début juillet, fait inédit depuis 1789, une faction contrôlait l’Assemblée. Mû par une volonté de conciliation face au mouvement fédéraliste, les Montagnards se montrèrent peu revendicatifs mais, selon l’auteur, la rupture survient le 13 juillet lorsque Marat est assassiné et relance du thème de la grande conspiration, elle s’incarne dans un homme, Robespierre.
En effet, depuis le printemps 1793, il est un député dénonçant avec le plus de véhémence, cette vaste conspiration girondine et prônant la fermeté pour la réprimer.
Malgré tout, Tackett souligne le poids du contexte parisien dans la mise en place d’une politique répressive. Pris en étau entre la guerre, la menace fédéraliste et la pression du peuple parisien, les députés montagnards ne semblèrent avoir qu’une faible marge de manœuvre.
Ainsi, le 5 septembre, comme le 2 juin précédent, les militants parisiens soutenus par la Commune et le peuple de Paris défilèrent dans l’Assemblée et la porte du Comité fût même forcée. On y demanda avec une rhétorique empreinte d’une grande violence, une répression accrue.
Ici Tackett souligne le dilemme auquel furent confrontés les conventionnels déjà échaudés qu’on leur ait forcé la main en juin : contenter le peuple tout en restant maîtres de la situation. Le Comité de salut public décida d’accueillir les radicaux Billaud-Varennes et Collot d’Herbois tout en arrêtant Jacques Roux et Varlet, leaders des Enragés, et en limitant l’influence des sections.
C’est à ce moment que s’institutionnalise la Terreur avec la création d’une armée révolutionnaire chargée de parcourir la campagne et de forcer les paysans à vendre leur récolte et la fameuse loi des suspects du 17 septembre. Cette loi offrit alors un pouvoir considérable aux comités de surveillance locaux tenus par des patriotes radicaux en ne définissant pas clairement le terme de suspect et en ne prévoyant aucune procédure d’appel contre une accusation. Le nombre de prisonniers à Paris cru fortement à cette période tout comme le personnel du Tribunal révolutionnaire chargé de les juger. La mise en place de cette politique répressive alla de paire avec une forte centralisation du pouvoir exécutif entre les mains du Comité dont les membres furent maintenus par la Convention durant les onze mois suivant.
La quête d’absolu de l’an II, de l’idéalisme à l’intolérance
La condamnation et la mise à morts des vingt et un Girondins, le 31 octobre 1793, marquait la fin d’une époque autant qu’il en inaugurait une nouvelle[18].
La période qui s’ouvrit alors, l’an II de septembre 1793 à septembre 1794, résume à elle seule les ambiguïtés et paradoxes de la Révolution : d’un côté l’idéalisme, la foi en le progrès de l’humanité et la recherche d’une société plus juste furent à l’origine du vote de mesures révolutionnaires comme l’abolition de l’esclavage ou l’instruction gratuite, et de l’autre la peur, la suspicion et l’intolérance poussèrent les autorités à instituer une politique répressive d’État inédite.
La mort des Girondins modifia cette politique répressive qui outre de s’attaquer aux contre-révolutionnaires, se dirigea également contre les révolutionnaires de la première heure. Ainsi, ce qui restait des Girondins fut traqué et exécuté jusqu’en mars 1794 et les députés de la Constituante qui avaient soutenu une monarchie constitutionnelle avant de se rallier à la République le furent aussi tels Barnave, Bailly, Philippe d’Orléans dit Égalité, Thouret, Le Chapelier etc… Soit près de quatre-vingt-huit anciens députés au total[19].
En outre, la vague de déchristianisation qui s’abattit sur Paris en octobre et novembre 1793 illustre également cette intolérance nourrie d’idéal, celui de renverser l’autorité traditionnelle de l’Église et de lutter contre les superstitions afin de répandre la Raison.
Début de l’année 1794, la folie répressive se porta au sein même des Montagnards divisés entre une ligne modérée incarnés par les Indulgents Danton et Desmoulins et une ligne radicale derrière Hébert. D’un côté, on réclamait plus de conciliation et moins de répression et de l’autre on se posait en porte-parole du peuple et réclamait une politique encore plus radicale. Mais, chacun critiquait le Comité de salut public. Jaloux de son pouvoir et de son autorité, il se devait de réagir afin de ne pas être débordé sur sa gauche ni sur sa droite. Ainsi, après une tentative d’Hébert le 13 mars 1794 pour entraîner les sections à marcher sur le Comité, il fût arrêté, jugé et condamné à mort le 24. Le 30, ce fut au tour de Desmoulins et Danton, très critiques à l’égard du Comité et de son chef, Robespierre. Malgré leur amitié, Robespierre n’hésita pas, au nom d’une certaine pureté ou d’un idéal qu’il se faisait de l’engagement politique, à arrêter et condamner son ami.
Au printemps 1794, on dénombra près de 300 000 suspects arrêtés et l’exécution de 17 000 personnes à l’issue d’un procès très souvent expéditif. Les estimations peuvent monter jusqu’à 40 000 en comptant les exécutions sans procès et les morts en prison[20]. La plupart de ces victimes furent des paysans ou des artisans, les départements les plus touchés furent ceux de l’Ouest et ceux du fédéralisme, mais cela dépendit du l’action des représentants en mission et du zèle des comités de surveillance locaux ainsi que des luttes politiques locales.
La politique de répression s’intensifia encore en juin 1794 avec le vote de la loi de prairial an II qui élargissait considérablement le champ de suspects. Cet ultime palier de la Terreur survint alors que les victoires militaires s’enchaînaient et que la révolte dans les départements était mâtée. Selon Tackett, c’est une fois de plus la peur voire la paranoïa de Robespierre et certains membres du Comité d’être assassinés comme Le Peletier ou Marat qui ont présidé à cette fuite en avant dans la répression. Ainsi, à Paris, durant sept semaines, on exécuta davantage que dans les quatorze mois précédents et le taux d’acquittement tomba de 50 à 20%[21]. Ici, le taux de nobles monta de 8 à 20% car on traqua tous ceux qui occupèrent des positions sous l’Ancien Régime ce qui fait dire à Timothy Tackett que la répression changea de sens et sombra dans la vengeance et la haine pour la classe dominante sous la monarchie[22]. Et de citer Rosalie Jullien, une proche de Robespierre, dont les mots trahissent cet état d’esprit du moment si particulier oscillant entre idéal et intolérance « La perfidie des faux amis du peuple, les noirceurs des aristocrates, le fanatisme sanguinaire des prêtres, l’orgueil atroce des nobles. Tout cela m’inspire une si profonde indignation que je rugis en pensant aux maux dont ils ont accablé l’humanité. Depuis quatre ans, je suis devenue méchante par bonté, barbare par humanité, et si passionnée pour le bien public que tous ceux qui s’y opposent sont mes ennemis et des monstres à mes yeux»[23].
Eté 1794, les belles idées humanistes de la Convention se sont envolées, dispersées par la peur et la paranoïa du Comité, les libertés de parole et de presse sont suspendues à l’appréciation des « mouches » de la police parisienne qui furètent dans tous les recoins de la capitale et suscitent l’angoisse et l’incertitude d’être inquiété même chez les députés. Le député Ruault résumait alors l’atmosphère étouffante de Paris : « La mort plane sur toutes les têtes. Nul de nous ne peut être sûr de l’éviter, car elle frappe à tort et à travers »[24]. Ainsi, des députés prirent les devants et commencèrent à discuter de possibles moyens d’actions à l’encontre de Robespierre, jugé comme la principale menace[25].
Mais au final, ce fut la division entre les deux Comités et celles au sein du Comité de salut public qui mirent fin à la Terreur. Les faits sont ensuite connus quoi qu’emprunts d’une certaine confusion : Robespierre absents des Comités depuis un mois, se présenta le 8 thermidor à la Convention pour y prononcer un discours confus dans lequel il menaça, sans les nommer, des membres des Comités. Inquiets, les députés conspirateurs mirent au point une stratégie. Le lendemain, 9 thermidor, on empêcha Saint-Just et Robespierre de parler et les arrêta. Sur le chemin, la Commune, proche de Robespierre et qui se déclara en insurrection contre la Convention, les libéra et les emmena à l’Hôtel de Ville vers minuit. Mais les députés réagirent en faisant arrêter Hanriot, chef de la Garde Nationale et soutien de Robespierre. Les militants radicaux prêts à défendre à Robespierre se démobilisèrent faute d’ordre précis du député qui ne souhaitait pas apparaître comme un dictateur. Sans défense, l’Hôtel de Ville de Paris fut envahie sous les ordres de Barras qui les arrêta. Robespierre, son frère, Couthon, Saint-Just, Hanriot et d’autres furent condamnés et exécutés le 28 juillet ou 9 thermidor.
Après Thermidor, les députés de la Plaine, qui étaient pourtant majoritaires, reprirent le contrôle de l’Assemblée et des Comités en en réduisant leur pouvoir.
Conclusion, les hommes et les faits remis au centre du mécanisme de la Terreur
Comme à son habitude, Timothy Tackett nous livre un récit dense, très documenté mais clair et dans un style fluide[26] des évènements ayant conduit à la terreur et à la Terreur. Néanmoins, on reste quelque peu sur notre faim car les trois quart du livre constituent dans le fond un récit assez classique des évènements révolutionnaires et on peine à y déceler le fil directeur de l’argumentaire à savoir les mécanismes ayant conduit à la terreur. En effet, le récit, très vivant et illustré de nombreux témoignages, se cantonne trop souvent à la description des évènements sans mettre suffisamment en perspective des éléments d’explications qu’on retrouve difficilement en fin de chaque chapitre.
L’intérêt principal de l’ouvrage est ici d’accompagner le récit de nombreuses citations de correspondance de députés ayant vécu de près les luttes politiques et ainsi de donner chair au récit évènementiel en permettant de retranscrire au plus près l’état d’esprit du moment. Ces témoignages offrent alors à Timothy Tackett la possibilité de mettre en avant les ressorts psychologiques qui présidèrent aux décisions politiques et façonnèrent l’évolution de la culture politique des révolutionnaires.
Les conclusions auxquelles aboutit Tackett sur les mécanismes de la Terreur ne sont pas « révolutionnaires » mais ont le mérite d’avoir été démontrées tout au long du récit, même si insuffisamment mises en avant. La terreur, selon lui, résulte ainsi d’un enchaînement de faits venus du processus révolutionnaire lui-même dans lequel ont jouées les circonstances et où les individus ont été emportés[27].
La force de cet ouvrage est donc de remettre au centre du récit explicatif de la Terreur, les hommes et leurs émotions, et les faits. Il n’y a donc eu ni préméditation ni idéologie dans le mécanisme de la Terreur selon Tackett qui répond ici explicitement à Gueniffey et à Furet, mais simplement des hommes et des faits. Ce sont ces faits nés de l’opposition à la Révolution dès ses débuts et de l’effondrement général de l’autorité qui générèrent cette atmosphère particulière, mélange d’enthousiasme, d’incertitude et de peur qui caractérisa la Révolution. Cette atmosphère associée à la lutte pour le pouvoir à tous les échelons née de la vacance de l’autorité contribua à façonner une nouvelle culture politique faite de suspicion et de violence.
Et Tackett de conclure que ce côté tragique du processus révolutionnaire, qu’on appelle terreur, est propre à chaque révolution, que les transformations sociales et politiques ne sont pas sans heurter le réel et sans générer d’oppositions qui en retour procure ces sentiments antagonistes d’enthousiasme, de crainte et de suspicion…
[1] La plus importante vague d’émigration survint à l’été et l’automne 1791 lorsque les officiers apprirent la fuite du roi et durent comme les prêtres, jurer fidélité serment à la Constitution. En tout près de 10. 000 émigrés furent recensés dont les trois quart des officiers et la moitié des députés nobles des Etats Généraux. Op. Cit., p. 127.
[2] Propos issus d’une correspondance : «…. », Op., Cit, p. 142.
[3] Op. Cit., p. 149.
[4] Op. Cit., p
[5] Op. Cit., p.168.
[6] Op. Cit., p. 171.
[7] Les députés de la Législative sont tous nouveaux mais pas sans expérience politique puisqu’ils ont officié dans l’administration née de la révolution, op. Cit., p. 166.
[8] Robespierre, député de la première assemblée issue des Etats-Généraux n’est plus député en 1791, mais l’opposition se déroule au sein du club des Jacobins.
[9] Op. Cit., p. 215.
[10] Op. Cit., p. 223.
[11] On publia même la liste de ceux qui avaient soutenu aux précédentes élections, els candidats feuillants. Op. Cit., p. 221.
[12] Le terme de « monstre » revient au moins soixante fois dans les cent deux discours des députés publiés. Op. Cit., p. 255.
[13] Op. Cit., p. 263.
[14] Abandon de la perruque poudré, culottes et bas, souliers à boucliers et adoption du tutoiement. Op. Cit., p. 266.
[15] Op. Cit., p. 271.
[16] L’auteur souligne à cet égard l’usage croissant dans les discours des députés de verbe « exterminer ». Op. Cit., p. 299.
[17] Sauf à Toulon qui offrit son port aux Anglais.
[18] Ce fût la plus grande exécution à la guillotine de la Révolution. Op. Cit., p. 333.
[19] Op. Cit., p. 351.
[20] Op. Cit., p. 354.
[21] Op. Cit., p. 357
[22] Ibid. Des fermiers généraux, des magistrats des anciens parlements, des scientifiques comme Lavoisier furent conduits à l’échafaud. La guillotine fut déplacée Place du Trône Renversé (Nation) afin de mieux évacuer sang et cadavres…
[23] Ibid.
[24] Op. Cit., p.359.
[25] On retrouve chez ces « conspirateurs » des montagnards influents et qui eurent plus tard une belle carrière politique tels Fouché, Tallien, Barras ou Carrier.
[26] On peut souligner ici la qualité de la traduction.
[27] Op. Cit., p. 367.