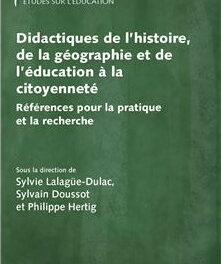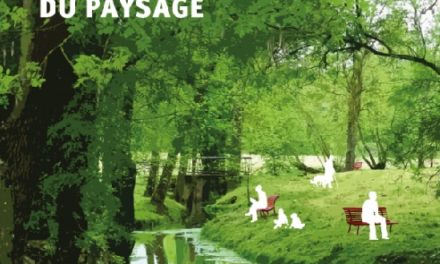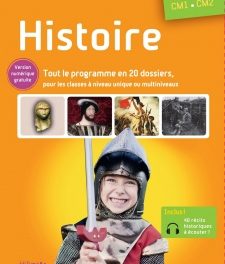Laurence De Cock est docteure en sciences de l’éducation, professeure agrégée en lycée et chargée de cours en didactique de l’histoire et sociologie du curriculum à l’Université Paris-Diderot. Elle a notamment publié, avec Benoît Falaize et Corinne Bonafoux, Mémoires et histoire à l’école de la République : quels enjeux ? (Armand Colin, 2007) et dirigé La Fabrique scolaire de l’histoire (Agone, 2017). Elle vient de publier Sur l’enseignement de l’histoire : débats, programmes et pratiques de la fin du XIXe siècle à nos jours (Libertalia, 2018).
Quelle est l’évolution de l’enseignement du fait colonial en France et quelles sont les influences du débat public sur la rédaction des programmes d’histoire ? Ce livre exigeant issu de la thèse de l’auteur, dont le titre ne présente aucune ambiguïté dans son positionnement, aborde l’évolution d’un sujet brûlant de notre société : comment enseigner le fait colonial en classe face à des élèves porteurs d’une histoire familiale multiforme, issue de l’immigration coloniale ou postcoloniale ?
Laurence de Cock a écumé les archives de l’Éducation nationale, la presse spécialisée (la revue de l’APHG, Historiens Géographes) ou la presse d’opinion, les manuels scolaires et les textes officiels pour tenter de s’interroger sur « la progressive politisation de l’enseignement de l’histoire, révélateur des tensions entre l’école, la société, la République et la nation ». Par contre les pratiques enseignantes n’ont pas été analysées car il fallait circonscrire le sujet de recherches. Pour l’auteur, « le fait colonial est devenu un prisme à travers lequel on perçoit les difficultés à parler de l’immigration dans la société française »
Dans l’introduction, Laurence de Cock explique le choix de son sujet. Jeune agrégée issue d’un milieu bourgeois provincial très favorisé mais politisé et militant, elle se trouve mutée dans un collège au cœur de la cité Pablo Picasso de Nanterre. Les difficultés rencontrées l’ont poussée à réagir. Alors que sa maîtrise et son DEA ont porté sur l’histoire coloniale en Tunisie, cette situation l’a dirigée vers la sociologie. Les écrits d’Abdelmalek Sayad, notamment son livre sur les bidonvilles de Nanterre lui ont ouvert les yeux sur l’imprégnation de la mémoire coloniale sur le territoire français. L’année 2005 montre l’importance des enjeux mémoriels et l’auteur décide de travailler sur la circulation entre les mémoires, les débats de société véhiculés par les médias et le traitement des problèmes coloniaux à l’école, ce qu’elle appelle les curricula. Cet ouvrage a donc l’ambition de s’inscrire à la croisée des sciences sociales, de la didactique de l’histoire et de la sociologie de l’éducation.
1980, l’altérité culturelle dans la crise de l’enseignement de l’histoire
Pour des besoins économiques, la France intensifie les vagues d’immigration après la décolonisation puis les flux sont stoppés en 1974 alors que les naturalisations se multiplient mais la part européenne diminue. S’élabore une politisation de la question immigrée c’est-à-dire une entrée dans le débat politique controversé de cette question. Le nombre d’articles sur le sujet se multiplie tandis que le vote front national progresse. Les « Beurs » ou les jeunes des banlieues deviennent un sujet médiatique tandis que l’école se voit interrogée dans son rôle d’intégration. En 1983, la marche pour l’égalité et contre le racisme introduit le passé colonial dans les cercles militants et la mise au jour d’une jeunesse dite post-coloniale. On assiste à une résurgence du passé qui peut expliquer le présent, liant fait migratoire, passé colonial et intégration républicaine. Le MRAP, l’humanité parlent du massacre du 17 octobre 1961 mais rien ne transparaît dans le débat public à une époque où le président de la République François Mitterrand ne tient pas à faire surgir ses rôles dans le passé et il présente un argumentaire de lissage de l’histoire pour se tourner vers l’avenir.
Quels sont les nouveaux défis pour l’école ? L’imbrication des échelles identitaires existe depuis l’école républicaine obligatoire et laïque. Avec la réforme Haby et l’hétérogénéité du public scolaire, les programmes d’histoire de 1977 changent. L’école doit lutter contre le racisme. Fort du renouvellement de l’école des Annales, le programme d’histoire est pensé comme un outil de démocratisation et une partie historique évoque les civilisations tandis que les mondes lointains sont expliqués en géographie. La veine positiviste chronologique se dilue pour élargir l’horizon d’élèves issus de réalités culturelles variées. Ces nouveaux programmes donnent lieu à des critiques acerbes et violentes largement diffusées sur la dégradation du récit national. Certains appellent à la régénération de l’enseignement de l’histoire.
L’hétérogénéité culturelle est devenue une question sociale et politique dans un contexte de crise économique. L’enseignement de l’histoire doit consolider le modèle républicain, pour certains, par l’exploration de civilisations étrangères et pour d’autres par l’enseignement d’une histoire nationale rempart d’un délitement du patriotisme. Le passé colonial devient à ce moment une manière de penser la présence de l’immigration. En 1985, l’arrivée de Jean-Pierre Chevènement amène de nouveaux paradigmes : la normalisation ou la banalisation de la présence d’enfants (d’) immigrés justifie la fabrication « d’un commun » au pays de départ et au pays d’accueil. Le « caractère immigré » de l’enfant n’appelle donc pas un traitement allogène. L’école toute entière doit s’interroger dans sa capacité aux différences et s’imposer des expérimentations pédagogiques ou des thématiques allogènes comme l’histoire coloniale. L’altérisation des enfants immigrés interpelle une école prête à partager les expériences de l’ailleurs.
Dans la même période, les débats sur la guerre d’Algérie montrent des clivages importants. Benjamin Stora dans « la gangrène et l’oubli » est le premier à faire un rapport entre le retour du racisme colonial et le problème de l’immigration. Pourtant, les manuels des programmes de 1982 explicitent clairement les problèmes de ce qu’on ose appeler « guerre ». La torture est évoquée. A ce moment, le sujet devient politique et des associations interpellent des parlementaires sur leur réalité du conflit. Chez les élèves, on observe une méconnaissance et une certaine passivité. S’y ajoute la thématique des droits de l’homme et l’éducation au développement pour penser la diversité culturelle et agir contre le racisme. Ces thèmes, encouragés par l’UNESCO, entendent dépasser le cloisonnement disciplinaire. Le programme d’Éducation Civique sort en 1985. Conçu pour développer l’amour de la République, il chemine par les droits de l’homme, la tolérance, la solidarité, le refus du racisme vers une instruction et des pratiques de pédagogie active. Le fait colonial apparaît dans la diversité des origines, des croyances, des opinions.
La mémoire de la guerre d’Algérie : un problème public, 1990-2000
La guerre d’Algérie entre dans le curriculum du devoir de mémoire. La politisation de la question de l’immigration se rattache à la religion, notamment le port du voile. Le passé colonial ressort en même temps que les mémoires activées par les associations qui demandent des commémorations. Le savoir historien devient un instrument de catégorisation mémorielle qui va jusqu’à la dénonciation de la torture par exemple. On est à une époque où l’immigré s’assimile au musulman. Depuis 1979 et la Révolution iranienne, on se penche sur le passé colonial et le port du voile est ressenti comme identitaire. 1989 est l’année charnière avec « l’affaire dite du voile » à Creil amis aussi l’année du Bicentenaire de la Révolution Française où l’école s’est tant investie. Maxime Rodinson, spécialiste de l’islam introduit le mot de communautarisme dans la sphère politique. Pour certains, la question du voile remet en cause l’avenir d’une certaine République. L’Algérie tombe dans la guerre civile en 1992 et 1995 est marquée par les attentats meurtriers à Paris. Se mêlent l’islam, la banlieue, le terrorisme et l’islamisme. Les jeunes oscillent entre aspiration à l’autonomie et le souci de reconnaissance. L’occultation des histoires multiples liées au contexte colonial revient dans le débat public tandis que les attentats du 11 septembre 2001 relancent les débats sur la dangerosité potentielle de la religion musulmane. Le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en 2002, raidit les tensions et pousse à la loi sur l’interdiction du foulard à l’école en 2004. Le fait colonial est alors dans tous les argumentaires développés de part et d’autres : le passé colonial reconfigure les débats vers une dramatisation. Raphaëlle Branche, spécialiste de l’historiographie de la guerre d’Algérie, estime que les années 1990 sont un tournant dans la mobilisation des chercheurs sur la période, concomitante avec la construction des mémoires. Leurs canaux font surface aussi à ce moment où une configuration mémorielle du passé algérien se dessine.
Le devoir de mémoire conditionne le rapport dominant au passé douloureux, ce qu’on appelle « le passé qui ne passe pas », d’abord sur la période vichyste (Henri Rousso, Marcel Ophüls) puis la guerre d’Algérie. Benjamin Stora dans son livre La gangrène et l’oubli parle d’enfouissement et de silence des deux côtés de la Méditerranée. Il faut oublier une guerre perdue. En réalité, Stora traque une mémoire au registre de la réparation. L’État a une dette morale pour les « oubliés » de l’histoire, une utilité sociale pour la question de l’immigration et son intégration. Le livre parait en 1991, 30 ans après le massacre du 17 octobre 1961, un événement largement médiatisé pour la première fois. ( Voir Les années algériennes sur Antenne 2)
S’en suivent les années de présidence de Jacques Chirac qui inaugure une politique mémorielle sous le signe de la repentance comme le montre son discours de 1995 sur la responsabilité de l’État dans la déportation des Juifs sous Vichy. Le procès Papon de 1997, acteur pendant la Seconde Guerre mondiale et en l’Algérie, sera le lieu où s’impose l’idée de la reconnaissance des crimes commis. Ceci pousse le parlement a voté le terme de « guerre » pour le conflit algérien, terme déjà utilisé depuis longtemps mais aussi à la dénonciation de l’utilisation de la torture en Algérie, complétant les aveux du général Massu et plus tard du général Aussaresse. Raphaëlle Branche soutient sa thèse sur le sujet en 2000. Il y a bien longtemps qu’on savait mais les journaux ont scénarisé les besoins mémoriels, les commémorations à une époque où le vote extrême droite augmente. L’usage du terme « repentance » devient systématique surtout par les contempteurs de cette posture qui y voit une dévalorisation du modèle républicain national. Tout se passe comme si le public découvrait les horreurs et la violence en Algérie alors que les productions scientifiques en parlaient depuis longtemps.
L’enseignement de la guerre d’Algérie et du fait colonial
Il semble que soit interrogée la vivacité du savoir scolaire. Beaucoup pensent que ces sujets ne sont pas assez traités par les programmes scolaires. Pourtant les manuels font une large place à ces enseignements. On y traite des massacres de Sétif, de la torture, du 17 octobre 1961 et de la répression du métro Charonne. Les connaissances sur la guerre d’Algérie des élèves sondés sont correctes sans distinction avec leur milieu d’origine. D’après une enquête dans l’académie de Versailles sur peu de cas sondés, ce serait plus les enseignants qui craignent le sujet par manque de formation.
Au moment où les mémoires sont prégnantes, s’opère la captation ministérielle de l’enseignement de la guerre d’Algérie à des fins politiques (la rencontre entre le président Jacques Chirac et de son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika). Le ministère de l’Éducation nationale réunit un réseau d’historiens et d’inspecteurs généraux pour organiser un colloque, l’été 2001 où interviennent des protagonistes venant des deux côtés de la Méditerranée. Ainsi l’institution devient promoteur d’événements au lieu de subir les polémiques. Elle déplace le débat et sert de neutralisateur. Ceci n’empêche par le ministère de lancer un chantier de commémorations. Jack Lang promeut la nécessité d’un travail coopératif entre la France et l’Algérie et d’une réflexion sur l’enseignement de la guerre dans les deux pays. Les actes du colloque montrent la fermeté des historiens relayés par Jean-Pierre Rioux qui préfère le camp du savoir. Le colloque se conclut sur la nécessité d’enseigner l’histoire sereinement et de s’appuyer sur les acquis scientifiques.
La création d’un conseil national des programmes est conçue comme un circuit de refroidissement. Ce CNP agit dans les curricula mais se superpose à d’autres instances comme l’IGEN. Ses membres, d’un spectre élargi sont nommés par le ministre. C’est une période où écrire un programme d’histoire prend plusieurs années car il faut auditionner une diversité d’acteurs. 1995,1996 et 1997 voient l’arrivée de nouveaux programmes où sont inscrits des repères, une liste de documents patrimoniaux. Le CNP qui sert l’administration de l’Éducation Nationale, avive les discussions internes, propices à la réflexion sur la finalité de l’enseignement de l’histoire. La thématique coloniale est toujours très présente, soit qu’elle sert la cause de la tolérance soit la cause de l’intégration. La suppression du CNP à l’aube des années 2000 a pour conséquence d’accroître la porosité des débats publics sur une conception des programmes qui s’accélère.
Les années 2000 : exacerbation des débats
Une autre manière d’écrire les programmes commence, plus rapide avec des commissions restreintes selon un calendrier exigeant. En 2005, le fait colonial connaît une médiatisation sans précédent en lien avec la mémoire de la traite et l’esclavage reconnus comme un crime contre l’humanité par la loi Taubira adoptée par le parlement le 10 mai 2001. Le 24 janvier 2005 est rendu public « le manifeste des indigènes de la République » où s’affirme clairement un lien entre les discriminations au temps coloniaux et le racisme d’une République postcoloniale. Il faut donc décoloniser les imaginaires et les pratiques. Une marche est prévue le 8 mai 2005, date anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en 1945. Le texte est signé par des militants mais aussi par de nombreux universitaires ou politiques car il dénonce la stigmatisation de population héritière de l’immigration coloniale. S’ajoute la loi du 23 février 2005 qui porte « reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », appelée la loi Mekachera. Cette dernière entraîne de vives oppositions des historiens car elle induit un positionnement de l’histoire et de son enseignement, en insistant sur les aspects positifs et négatifs de la colonisation. Le CVUH (Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire) est créé dans la but de distancier la mémoire collective de la recherche historique. La médiatisation de la mémoire coloniale et de l’enseignement du fait colonial s’avère exponentielle. L’expression continuum colonial issu des postcolonial studies s’impose. Il s’agit des réverbérations existantes entre le passé colonial de « l’indigène » et les discriminations vécues par les immigrés (ou leurs descendants) dans la France d’aujourd’hui. La connexion entre colonisation/décolonisation et les traites et l’esclavage s’opère. La race est un de ses connecteurs : si le racisme est d’origine colonial alors la connaissance de ce passé peut contribuer à le supprimer. En poussant à l’extrême, ces idées invitent à dire que la République induit le racisme. L’ACHAC (Association pour la connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine) créée par Pascal Blanchard se place dans ce continuum colonial et s’immisce dans la production scolaire (TDC, Historiens et géographes) renouvelant les images coloniales dans les manuels. Laurence de Cock avoue avoir adhérer à ce continuum mais elle s’interroge sur les réceptions de ces images à l’époque. Elle revient sur les conclusions qui enferment le colonisé dans son rôle de dominé. Les interactions dans la société coloniale ne sont pas prises en compte. Puis la question de l’immigration est au cœur de l’école républicaine et l’usage du terme « diversité » se généralise, sous l’impulsion de l’Union européenne. Mobilisé dans les domaines politiques et économiques, il touche aussi l’école interpellée pour favoriser cette diversité.
De nouveaux cadres pour penser l’enseignement du fait colonial
Le terme diversité est né aux États-Unis dans un contexte de management, destiné à devenir une variable de la gestion des ressources humaines. L’Union européenne se dote d’une devise, « Unité dans la diversité ». Cet oxymore typique des slogans de communication politique révèle un mode de lecture du monde social. Le mot diversité apparaît comme un consensus à gauche comme à droite. Il a une connotation positive et il permet de dépasser et de contourner les conflits. De multiples débats liés aux événements politiques (sortie du film « Indigènes », lecture de la lettre de Guy Môquet, parrainage d’un enfant juif mort sous la Shoah par des enfants de CM2…) multiplient les instances de consultation et les espaces de réflexion où l’implication parlementaire est forte. Pourtant, on assiste selon l’auteur à une rupture entre les débats publics et l’école. Le registre de la diversité, constitutif des politiques éducatives des États de l’Union, opère une neutralisation des enjeux politiques liés à l’immigration et de ses liens avec le fait colonial. L’heure est à l’observation dans les manuels du respect de la diversité et aux propositions concernant l’intégration républicaine. Le traitement scolaire du fait colonial reste une donnée sous surveillance en France comme en Europe.
Tentatives controversées et échec final
La suppression du CNP en 2005 est suivie d’une reprise en main par le ministère et l’inspection générale de l’écriture des programmes qui sont en forte adéquation avec les renouvellements historiographiques notamment sur le fait colonial. Les programmes du collège de 2008 sont novateurs. Ils introduisent l’étude d’une civilisation asiatique (Inde des Gupta ou Chine des Han) en 6ème et un ancien empire africain précolonial (Ghana, Mali, Songhaï) en 5ème. Sur la thématique coloniale, la traite négrière doit être explicitée entre la capture, le trajet et l’économie des plantations tandis que au XIXe un thème s’intitule « les colonies » avec l’étude d’une société coloniale où coexistent colons et colonisés dans la logique assumée de la domination. On passe des documents d’accompagnement aux fiches ressources qui suivent l’évolution historiographique. Ces programmes sont vivement critiqués dans l’espace public pour leur décentrage sur d’autres continents et une place moins grande donnée à l’histoire de France.
En 2009, Xavier Darcos annonce une grande réforme du lycée avec la suppression de l’HG en terminale scientifique. L’écriture des programmes de lycée est précipitée. Pourtant les notions nouvelles comme les débats sur le fait colonial sont introduits et l’entrée par l’exposition coloniale de 1931 est proposée dans la fiche ressources. L’année de terminale est dotée d’un programme entièrement thématique tourné vers la réflexion historiographique. L’histoire et les mémoires sont confrontées à propos de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d’Algérie. La fiche ressource reprend le modèle mémoriel proposé par Benjamin Stora. Le chapitre apparaît comme un aboutissement de la finalité critique de l’enseignement de l’histoire enseignée.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en 2012 ouvre une nouvelle séquence. Le Conseil supérieur des programmes est créé en 2013. Sa composition de 18 membres allie des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, des personnes nommées par le ministère de l’éducation nationale… Si le CSP émet des avis et des propositions, seul le ministre décide. Michel Lussault est nommé président du CSP. Des auditions sont faites. Laurence de Cock y a participé représentant son collectif Aggionamento. Il semble que le CSP présenté comme indépendant soit souvent en contact direct avec le ministère ce qui permet de comprendre la forte politisation de ces nouveaux programmes. Après des fuites, le texte divulgué est fortement critiqué car il comprend des parties obligatoires comme l’islam ou les traites et l’esclavage à côté des parties facultatives comme l’Europe des lumières. Après les attentats de janvier 2015, l’exécutif prend largement la main. Le préambule insiste sur l’ancrage de l’histoire de France. Les référents novateurs de l’histoire globale ou connectée sont abandonnés. L’auteur et son collectif ont trouvé une nette régression dans le caractère européocentré de la version définitive. En élargissant le réseau et en écartant l’APHG et l’inspection générale, le CSP a été fragilisé et a manqué de soutien.
Laurence De Cock s’est interrogée sur la nature spécifique d’un programme. Il est intéressant pour nous qui les appliquons de comprendre qu’ils sont une construction collective où entrent en jeu le politique, le scientifique, le pédagogique et le juridique à dosage variable en fonction du réseau qui participe à sa définition. Le choix du contenu sur le fait colonial peut être un analyseur et montre les tensions autour du socle républicain. Il reste à analyser la traduction de ces programmes avec les ressources validées par l’inspection, la formation des enseignants et leur application dans la classe ainsi que leur réception par les élèves.