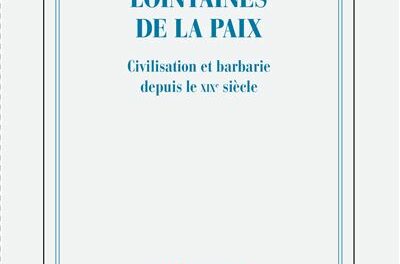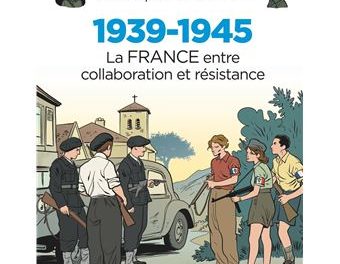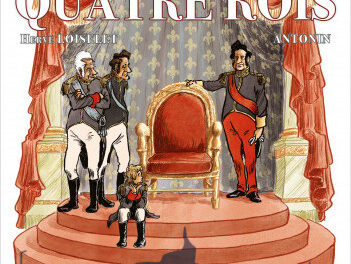Largement présent sur la scène médiatique française, dès qu’il est question de la Palestine, Elias Sambar, le directeur de la revue d’études palestiniennes s’est largement identifié à la cause qu’il défend. Tout comme Ibrahim Souss dans les années soixante dix ou Leyla Chahid, tous deux délégués généraux de Palestine en France, Elias Sambar a su donner un visage familier au problème palestinien.
Le spécialiste de la question, celui qui a lu une bonne partie de la bibliographie sur ce sujet n’apprendra pas grand-chose au niveau factuel. La somme de Henry Laurens, la question de Palestine, (dont il a été rendu compte sur ce site) fait date. Ce qui est intéressant par contre, c’est ce regard identitaire, ce ressenti de l’exilé, qu’est, nolens volens, Elias Sembar.
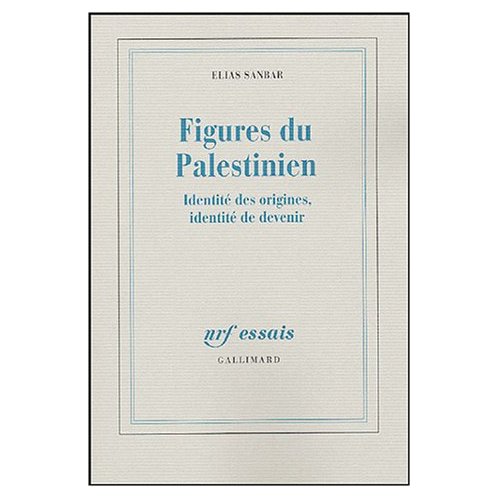
Que l’on me permette ici l’évocation d’un souvenir personnel. Chargé de cours en relations internationales à l’école supérieure de journalisme de Lille entre 1984 et 1993, Elias Sembar avait été notre invité lors des conférences d’actualité du lundi après midi. C’était encore la guerre civile au Liban, les forces de l’OLP étaient dispersées, l’état-major réfugié à Tunis. Il y avait pourtant chez Elias Sembar cette foi dans l’avenir de son peuple, mais aussi cette lucidité qui force encore l’admiration et que l’on se plait à retrouver dans cet ouvrage.
Présenté en trois figures, comme les trois coups qui précèdent une scène de théâtre, une tragédie forcément, cet ouvrage évoque successivement « les gens de la terre sainte », les « arabes de Palestine », et « le Palestinien invisible, l’absent. » Cela peut sans doute dérouter, mais au-delà de ces formulations qui n’ont rien d’artificiel, ce sont les trois actes d’une tragédie qu’Elias Sembar dévoile.
Gens de la terre Sainte
Le drame Palestinien aurait-il eu lieu si cette terre n’avait pas été le lieu d’élection des trois monothéismes, la terre où le Dieu unique, après la tentative du Pharaon hérétique, est apparu ? Sans doute pas. On retrouve dans l’univers mental de ces peuples, organisés et soumis depuis le XIe siècle à l’Empire ottoman, un dualisme de culture, celui qui oppose les ruraux et les urbains, les bédouins et les sédentaires, les Turcs et les Arabes, mais aussi les arabes du Nord, Qaysi, arabes du Nord, Yamani, arabes du Sud ; cette division, transcende toutes les autres avant le XIXe siècle, lorsque l’administration ottomane, en quête de modernité face aux pressions de l’Europe s’engage dans une voie unificatrice porteuse de tragédies…
Sans doute est-ce là le point de départ de cette histoire, plus que ce que l’on raconte souvent sur une quelconque antériorité d’occupation qui serait la source du conflit. Cette société ouverte, était contrôlée par quelques familles, vassales en apparence des maîtres ottomans, mais dans la pratique, assurant par le contrôle des waqf, les biens des mosquées, la stabilité économique de leurs territoires respectifs, garantissant un équilibre relatif entre les différents modes de vie et clans et chefferies de cette société du XIXe siècle. La modernisation de l’Empire ottoman par les tanzimat, les réformes, va être le premier élément déstabilisant.
Pour autant, d’après l’auteur, cette société Palestinienne reste remarquable à plusieurs égards. D’un monde où l’Islam domine mais où la place des populations non musulmanes, juives compris, reste forte. Cette société connaît aussi une intégration dans le système monde, associant agriculture vivrière et de plantation, notamment les agrumes fournissant les pays occidentaux.
Au milieu du XIX e siècle, d’après l’auteur qui reprend peu ou prou la thèse de Henry Laurens dans « l’invention de la terre sainte », les chercheurs européens cherchent aussi à retrouver dans ces paysages de Palestine, l’historicité du récit biblique. On voit bien la démarche de l’auteur qui cherche à démontrer dans une certaine mesure l’inanité de la revendication sioniste.
Cela donne lieu à des développements tout à fait passionnants notamment sur la recherche, dans une géographie largement imaginaire, d’une confirmation sur le terrain du récit biblique.
Cette approche se retrouve ensuite lors de la pénétration Européenne en Palestine Ottomane qui se réalise à la faveur de l’occupation Egyptienne entre 1831 et 1839.
Cette pénétration des puissances se retrouve avec l’Angleterre, suivie par la Prusse, la Russie et la France qui se présentent toutes comme protectrices des Chrétiens locaux. L’Angleterre et la Russie affirmant dans ce terrain leur rivalité qui se concrétise lors de la guerre de Crimée.
Les pogroms tsaristes qui se déroulent en Europe Centrale favorisent ensuite la pénétration juive, proto-sioniste, en Palestine. Cette pénétration trouvera sa justification territoriale et historique dans le développement du sionisme politique avec cette circonlocution trouvée par Théodor Herzl, parlant d’un heimstaat alors que l’on pense judenstaat. D’après l’auteur, cette revendication d’un foyer n’est qu’une précaution de langage pour apaiser les inquiétudes de la Sublime Porte dont l’Empire subit déjà sur les marges les agressions des puissances coloniales.
Arab Filastin, arabes de Palestine
L’argumentaire de l’auteur s’inscrit dans une logique particulière, celle de la dénonciation justifiée d’une situation shakespearienne, évoquant sans doute une tragédie en trois actes.
« En Palestine, une nation a solennellement promis à une seconde le territoire d’une troisième ». ( Arthur Koestler.)
Cette démarche se retrouve expliquée dans l’analyse faite de la déclaration Balfour, dans laquelle les Palestiniens n’apparaissent jamais en tant que peuple détenant des droits sur sa terre. L’affirmation de la Palestine sous mandat Britannique devient le point de départ d’une perception communautariste de ce territoire, ce qui permet nier en tant que telle l’existence des populations non-juives de Palestine, définies de façon exclusivement négative.
L’auteur s’attache à décrire sans passion apparente, ce qui rend son propos d’autant plus crédible, la longue démarche des différents mouvements sionistes, assimilés au trident, « terres vidées, remplaçants, armes, » permettant de déposséder les palestiniens de leurs terres.
Exclusion du travail, projet de partage d’un territoire qui resterait sous souveraineté Britannique, mais qui impliquerait des transferts de populations, alliance précoce, entre sionisme et Etats sont décortiquées par Elias Sambar comme autant de faisceaux convergents vers un même but, la négation des droits nationaux des Palestiniens.
La perception des premières relations entre cercles sionistes et élites étasuniennes est significative et peut éclairer la politique de l’administration Bush du point de vue du soutien de fond qu’elle apporte à l’actuel gouvernement israélien.
Face à cela, les Palestiniens se dotent d’une forme de résistance à cette appropriation de leurs terres. Cette affirmation se forge lors de la grande révolution Palestinienne de 1936-1939, appelée Al Thauwra Al Kubra. Cette dernière prend son essor à l’occasion des obsèques du Syrien Qassam, un des premiers combattants de cette indépendance Palestinienne qui se serait forgée en réaction à l’arrivée d’un sionisme agressif et conquérant.
Le mouvement national Palestinien est né de cette ambivalence. Unité du monde arabe et lutte nationale Palestinienne. Le Syrien Qassam trouve son terrain de lutte en Palestine, face à une double menace coloniale.
La Grande révolte de 1936 qui contraint les Britanniques à revoir leur politique voit ses effets annulés par la guerre. Les errements politiques du Mufti de Jérusalem qui se rapproche des nazis à partir de 1941 permettent au sionisme de s’imposer durablement.
Pourtant, le mouvement national cherche à investir le terrain de la culture, sans doute trop tard pour influer sur la marche inexorable des événements qui conduisent à ce désastre appelé Al Nakba.
L’auteur reprend d’ailleurs et argumente sur le massacre de Deir Yassine, dans la nuit du 8 au 9 avril 1948 tout comme sur le départ programmé des Palestiniens et prévu de longue main par les services de Tsahal.
Le palestinien invisible : l’absent
Dernière partie de cet essai qui ne prétend en aucune manière à l’exhaustivité, l’absent reprend et développe l’argumentaire des intellectuels palestiniens sur leur patrie perdue, noyée ou engloutie plutôt.
Les exemples sont nombreux et parlants, notamment sur la judaïsation des noms arabes comme volonté pour les autorités du nouvel Etat de faire disparaître la Palestine en tant qu’entité historique et surtout géographique. Ce ne sera pas le moindre des mérites du mouvement national Palestinien, malgré un certain nombre d’erreurs, que d’avoir su maintenir l’existence de la Cisjordanie, ce territoire que les sionistes radicaux s’obstinent à appeler Judée Samarie…
La judaïsation des toponymes traduit bien une volonté d’effacer l’existence de ces gens de la terre sainte, évoqués en première partie, tous mêlés, comme Juifs de Palestine, Chrétiens d’Orient et musulmans, et de les remplacer avec une lecture talmudique du judaïsme importé d’Europe.
Cette volonté d’éradiquer les palestiniens en tant que peuple se retrouve aussi dans l’organisation des déplacements des populations, y compris des palestiniens-israéliens, qualifiés d’arabes israéliens par les autorités de Tel Aviv.
Ces arabes israéliens sont pourtant capables, malgré un fort sentiment de culpabilité peut-être, de résister de façon identitaire, en développant une littérature spécifique.
La situation et la perception du problème change après la guerre des six jours et l’occupation des territoires. Premier échec israélien sans doute puisque malgré la victoire militaire écrasante, les territoires conservent leur nom de Cisjordanie, plutôt que l’appellation hérodienne de Judée Samarie. Ces territoires qui auraient pu servir de monnaie d’échange en 1976, et légitimer les annexions de 1948 se retrouvent dans une situation différente du fait des implantations de colonies juives.
Cela donne d’ailleurs à ces palestiniens absents une autre figure, celle du réfugié des camps, celui qui résiste en restant sur place et qui fournit les troupes nombreuses de l’activisme armé.
Ce dernier se retrouve aussi dans les camps de réfugiés situés à la frontière d’Israël, et qui vont contribuer à la fois à la popularisation de cette question de Palestine, mais aussi à l’émergence d’une bureaucratie militaire, organisée autour des cercles dirigeants de l’OLP.
De fait, les différentes figures du Palestinien souffrent toutes de cette impossibilité de se retrouver, de se réunir en fait.
La conclusion de l’auteur est en fait assez abrupte et même dans une certaine mesure désenchantée. Si les régimes arabes apportent un soutien inversement proportionnel à leur éloignement de la Palestine, ils sont en fait plus enclins à vouloir contrôler la force explosive dans leur propre opinion publique du fait national Palestinien, comme porteur d’espoir pour les populations de ces pays arabes eux-mêmes.
Cet ouvrage est bien un essai et, malgré un appareil documentaire très important, ne peut en aucun cas suffire à éclairer le problème dans sa complexité ni à renouveler la problématique de la question.
Pour autant, et surtout depuis la mort d’Arafat, il permet aussi de comprendre en filigrane comment s’est opérée la fracture entre les intellectuels palestiniens et cette rue palestinienne qui soutient de façon massive le fondamentalisme islamique et ses courants les plus radicaux. Les victimes de ces derniers sont bien ces jeunes déracinés, ces sans-figures qui trouvent dans l’embrasement des attentats suicides une réponse à la négation de leur identité.
Certes, les élections présidentielles palestiniennes n’ont pas encore eu lieu, mais pourraient traduire la fracture entre les composantes de ces « figures » du Palestinien, qui s’éloigne, sans doute encore plus aujourd’hui qu’à la veille de 1948, de son unité.