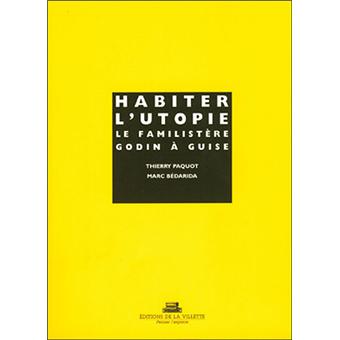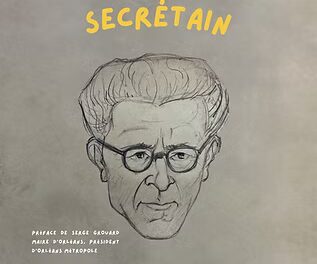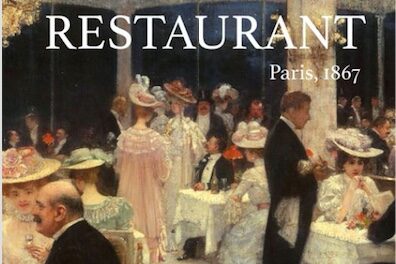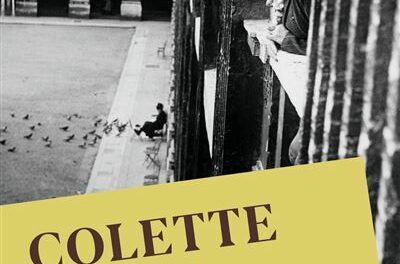Fondées en 1981 par l’école d’architecture Paris-La Villette, les éditions de la Villette ont vocation à publier des « réflexions, recherches et travaux menés dans les écoles d’architecture. Elles mènent également une activité en direction du monde professionnel et des amateurs avertis en éditant des ouvrages relevant, outre la ville et l’architecture, de problématiques sociales, techniques et esthétiques ». Cette présentation officielle aurait plutôt tendance à faire s’éloigner les historiens. Ce serait bien à tort si l’on en juge par quelques-uns des titres parus récemment. On pense notamment à La Question du logement et le mouvement ouvrier (J.-P. Flamand), à la publication de textes fondamentaux d’architectes modernes comme Ledoux ou Le Corbusier (E. Kaufmann), etc. Les géographes y trouveront aussi matière à réfléchir avec La Mouvance, 50 mots pour le paysage, résultat du travail de plusieurs auteurs parmi lesquels on ne s’étonnera pas de trouver Augustin Berque.
Dès lors, on ne sera pas surpris de trouver dans le catalogue de ces éditions plusieurs publications traitant du Familistère de GuiseGuy Delabre et Jean-Marie Gautier, Vers une République du travail. J.B.A. Godin (1817-1888), 1ère éd., 1988, rééd. revue et augmentée, 2000 ; Thierry Paquot, Le Familistère Godin à Guise, coll. « Penser l’espace », éd. La Villette. Rappelons enfin que les éditions de la Villette diffusent la réédition d’écrits de Godin, comme La Richesse au service du peuple : le Familistère de Guise, publié par Guy Durier (1979).
_ C’est aussi le cas de l’ouvrage collectif dirigé par Th. Paquot et M. Bédarida, Habiter l’utopie. Le Familistère Godin à Guise, sorti en 1982, qui vient d’être réédité cette année, revu et augmenté, et dont l’un des intérêts est de proposer des contributions d’auteurs venus bien sûr de l’architecture (M. Bédarida), de l’histoire (J.-L. Pinol), de la philosophie (Th. Paquot) ou de la sociologie…
Pour des raisons commerciales, notamment, il arrive souvent que le titre de l’ouvrage ne soit pas bien adapté au contenu. Or, ici, il correspond exactement à la problématique développée par les auteurs. Pour éclairer ce qu’est le Familistère, un portrait du concepteur du Familistère, Jean-Baptiste-André Godin, est d’abord proposé, avant que d’en venir à ceux qui « habitent l’utopie » : les familistériens. Les textes sont aussi entrecoupés de reproductions diverses : des photographies, assez souvent, des gravures, etc. Les mots prennent ainsi un relief particulier : les choses, les hommes peuvent être appréhendés plus facilement. Le cahier iconographique final très riche offre en une soixantaine de pages un panorama particulièrement intéressant au lecteur, puisqu’il peut ainsi embrasser le siècle et demi d’existence du Familistère (jusqu’à aujourd’hui) et de l’usine, en incluant non seulement les bâtiments mais aussi ses acteurs. Les reproductions sont classées en cinq parties : le travail ; l’habitation ; les équivalents de la richesse ; les fêtes ; aujourd’hui. On regrette seulement que manquent les indications archivistiques : de quels fonds proviennent les clichés proposés ? Il n’en reste pas moins que cette collection constitue une source documentaire importante pour les enseignants.
_ Entre les contributions scientifiques et cet album (c’est d’ailleurs comme cela qu’il est signalé), on peut trouver des témoignages d’observateurs extérieurs rassemblés par Marc Bédarida, à la fois des articles de visiteurs venus à Guise dans la seconde moitié du XIXe s. (Tito Pagliardini, l’architecte Henry Roberts, le journaliste saint-quentinois Jules Moureau, ou Jean Roseyro, reporter à L’Illustration) et des récits (E. Zola, venu puiser des éléments pour son roman Travail paru en 1901 ; le familistérien René Rabaux, administrateur-gérant de l’Association du Familistère entre 1933 et 1954).
_ Nous sommes donc au-delà d’une étude exclusivement scientifique du problème, puisque le parti-pris a été de favoriser la meilleure approche de l’expérience familistérienne en croisant les analyses et les témoignages et en les associant à l’image. Reconnaissons en cela ce qui fait le grand intérêt du présent ouvrage, qui permet ainsi de replacer le Familistère dans une large perspective historique, sans oublier ceux qui y ont participé.
Une synthèse des différentes contributions s’avère assez difficile, en raison de la diversité des points de vue adoptés que par leur richesse. Comme il a été dit, les directeurs de l’ouvrage ont choisi d’évoquer la figure de Godin. Du fils d’artisan-serrurier d’Esquéhéries, né en 1817, compagnon du tour de France, autodidacte fondateur d’une fabrique d’appareils de chauffage qui prospère rapidement grâce à l’ingéniosité de son initiateur, comment est-on passé au concepteur d’une expérience originale qu’il met lui-même en œuvre ? La légende, bien relayée par les familistériens, a contribué à grandir l’homme, ce dont il faut s’affranchir. Les auteurs nous montrent un être avide de lecture, d’étude, à la recherche de la Loi qui doit permettre d’arracher les ouvriers à la misère. Jean-François Rey le dépeint soucieux de respecter l’engagement qu’il se fixe très jeune : « si un jour je m’élève au-dessus de la condition de l’ouvrier, je chercherai les moyens de lui rendre la vie plus supportable et plus douce, et de relever le travail de son abaissement ». Pour définir une voie personnelle qu’il développe dans son principal ouvrage, Solutions sociales (1871), Godin soupèse les idées des uns et des autres. Les théories de Fourier, dont il rencontre des disciples, le marquent beaucoup au point de s’engager financièrement dans un projet de construction d’un phalanstère au Texas qui échoue (1848). Il s’intéresse aussi aux colonies icariennes imaginées par Etienne Cabet. L’insuccès de ces utopies mises en oeuvre convainc Godin de définir lui-même son projet. Il dresse les plans du Familistère, dans un contexte où l’on considère que l’habitat est l’une des clés de la question ouvrière. Mais son projet va à l’encontre des initiatives en matière de logement ouvrier, sous couvert philanthropique ou franchement paternaliste, que ce soit la cité Napoléon à Paris, à Mulhouse (avec un système de services), ou les corons des pays miniers. Jean-Luc Pinol rappelle que Godin opte pour un habitat collectif, dont la construction s’étend principalement de 1859 à 1877 (on salue la description des lieux faite par Alexis Épron), parce qu’il l’envisage comme une « solution au problème de l’espace et comme possibilité de services communautaires ». C’est qu’au logement, il compte adjoindre des établissements commerciaux (économat, mercerie, café, restaurant…), mais aussi des espaces de loisirs (salle d’escrime…), de culture (écoles, théâtre, bibliothèque…), et des services sociaux (nourricerie, protection sociale, pompes funèbres…). Les familistériens ont accès à un confort peu commun : des appartements bien éclairés, des points d’eau, un lavoir, etc. Ce sont ces « équivalents de la richesse » qui doivent permettre de donner leur dignité aux ouvriers : à eux le Palais social, « le palais des travailleurs dans lequel chaque individu trouvera les avantages de la richesse , réunis au profit de la collectivité ».
Mais la mission que s’assigne Godin n’est pas seulement matérielle : elle est d’abord morale. Jean-Paul Thomas montre bien qu’il considère que la révolution n’est plus à faire depuis 1789. Mais si les servitudes féodales ont disparu, celles qui pèsent dans le travail moderne demeurent. Il sait que les ouvriers ressentent ces pesanteurs : il faut donc agir avant qu’une nouvelle révolution détruise la société et ouvre la voie à tous les errements possibles. Godin estime que des réformes doivent être faites, de manière préventive. Elles passent par la satisfaction de besoins matériels mais aussi et surtout par l’éducationOn retrouve ici la même préoccupation que Robert Owen, quand il fonde New Lanark en Ecosse (1800) et New Harmony (1826) (ce qui le distingue du fouriérisme, au moins sur le principe d’une harmonie sociale obtenue par association de « passions »), qui doit permettre de « sauver les âmes des familistériens », comme l’indique J.-L. Pinol. Il s’agit de « se préparer à la vie après la mort », rappelant le côté mystique du personnage, adepte du spiritisme, ce qui l’éloigne de l’image du socialiste matérialiste que l’on garde encore. Godin pense que l’homme est perfectible, que cette amélioration n’a pas de limite ; il pense qu’ainsi régénéré, le familistérien deviendra un exemple pour les autres, à commencer par les Guisards. Le système du Familistère n’a donc pas un objectif égalitaire. Si Godin et les « associés » habitent ensemble, quel que soit le statut professionnel, si le tutoiement est de mise, le Familistère doit permettre de dégager une élite sur la base du mérite, de la compétence, mieux payée et ayant accès aux travaux les moins pénibles. Juste après les associés viennent les « sociétaires », puis les « participants », et enfin les « auxiliaires » qui sont hors de l’association. L’Association du Familistère (qui désigne la structure juridique chargée de la gestion du Familistère proprement dit mais aussi de l’usine de production, que Godin remet entre les mains de son personnel) ne peut donc se résumer à une coopérative : elle est une société en commandite simple chapeautée par un administrateur-gérant, élu par le conseil de gestion. Cela correspond à l’idée que le travail, qui révèle les capacités, ne doit pas être asservi par le capital financier. On perçoit le rôle important de l’éducation, non seulement comme source et instrument de moralisation et d’émancipation, mais également envisagée comme le moyen devant permettre d’associer efficacement les ouvriers à la gestion de l’entreprise, par le biais des multiples conseils qui existent.
Après la mort de Godin en 1888, le système se grippe lentement, révélant ses limites. Le Familistère fonctionne comme un monde cohérent (le statut de familistérien devient rapidement héréditaire, la volonté de préserver des avantages acquis l’emportant alors sur celle de dégager une élite distinguée par ses talents), mais relativement clos, à part de la ville de Guise. La population du « tas eud’briques » se caractérise par son faible renouvellement, entraînant son vieillissement ainsi qu’une sur-féminité, mais aussi par sa faible mobilité. L’exiguïté et la rareté des appartements peut expliquer les premiers traits, tandis que l’accès à des avantages matériels (notamment aux bénéfices de l’entreprise) peut être avancé pour les seconds.
La décrépitude de l’entreprise et la sclérose du Familistère conduisent peu à peu à la disparition de l’association en 1968 : l’héritage de Godin est alors consommé, jusqu’à l’abandon de la Fête du Travail et celle de l’Enfance. Les bâtiments passent sous le régime de la copropriété privée, tandis qu’ont déjà disparu les services collectifs. L’usine Godin demeure, isolément, et continue à produire des appareils de chauffage. Les écoles sont devenues municipales, ainsi que le théâtre, qui a rouvert ses portes.
_ Les dernières pages du volume mettent l’accent sur Utopia, projet actuel de nature culturelle (voire touristique) sujet à polémique, conduit par un syndicat mixte réunissant la ville de Guise et le Conseil général de l’Aisne.
_ On se gardera bien d’oublier l’Association pour la fondation GodinAssociation pour la fondation Godin, 265, Familistère aile droite, 02120 Guise. Familistere.godin@wanadoo.fr. Site Internet ; http://perso.wanadoo.fr/familistere.godin qui œuvre beaucoup dans un cadre scientifique et contribue à renouveler le regard porté sur cette expérience sociale originale, cette « utopie socialiste pratiquée en pays picard »Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Guy Delabre et Jean-Michel Gautier, Le Familistère de Guise. Une utopie pratiquée en pays picard, éd. Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache (S.A.H.V.T.), 1983, 332 p., en lui donnant du sens. Le présent ouvrage se place délibérément et de belle façon dans ce sillonEn complément, on recommandera la lecture de Vers une République du travail. J.B.A. Godin (1817-1888), op. cit., des mêmes auteurs, qui présentent une sélection commentée d’extraits des écrits de Godin.