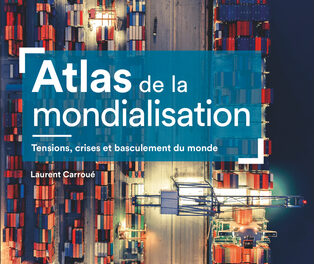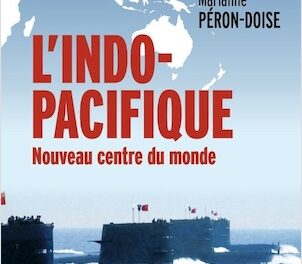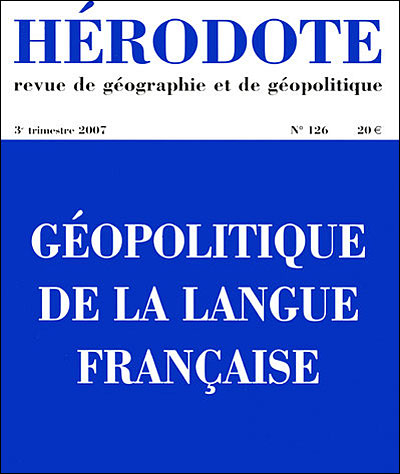
L’introduction donne une bonne vue d’ensemble : accroissement du nombre de locuteurs francophones mais recul dans des domaines stratégiques comme l’Union Européenne, rappel de l’indéniable domination de l’anglais et du rôle de l’hyperpuissance américaine. Bref le français est une langue internationale menacée.
Voici maintenant un bref aperçu des principales contributions ; j’ai mis mes propres rajouts entre parenthèses.
Le français au Maghreb
Après une introduction de Xavier North, délégué général à la Langue Française et aux Langues de France qui nous rappelle que plus que le nombre, ce sont nos œuvres qui comptent et que le rôle de la France ne justifie ni supériorité ni centralisation, trois contributions traitent du Maghreb.
Yves Lacoste décrit pour l’Algérie « une histoire coloniale plus complexe que celle répandue par la vulgate de gauche ». En particulier, il souligne l’aspect infondé de l’accusation de « génocide culturel » lancée par le président Bouteflika : les « Européens » ont refusé l’enseignement du français aux musulmans demandé par Jules Ferry. La Kabylie, d’où ils étaient absents, a échappé partiellement à cette non scolarisation, ce qui explique la relative francophonie actuelle de cette région.
Après les indépendances, l’enseignement est presque totalement généralisé et arabisé dans les trois pays et c’est une catastrophe (le français est enseigné à tous, mais peu et mal et le véhicule est l’arabe littéraire qui est alors une langue étrangère pour les dialectophones et les berbérophones qu’il laisse semi-illettrés ; toutefois, avant l’arabisation, une coopération poussée avec la France a permis de former beaucoup de cadres francophones qui jouent un rôle clé aujourd’hui).
La division des Algériens quant à l’attitude envers le français demeure profonde et virulente. Au Maroc (Fouzia Benzakour) et en Tunisie (Samir Marzouki), la situation est plus sereine. Dans les trois pays, le statut scolaire du français vient d’être renforcé (à cela s’ajoute l’important enseignement professionnel public et privé largement ou entièrement en français), car la libéralisation économique a multiplié les liens avec les entreprises françaises (où l’on travaille en français, ainsi que dans la plupart des entreprises « européennes » et locales « modernes »). Les universités nationales sont largement francophones, et l’enseignement supérieur de France, Suisse, Belgique et des filières francophones des PECO est largement fréquenté. Cela renforce le côté élitaire du français, élite qui s’élargit à de nouveaux entrepreneurs, plus « populaires ». La presse, les chaînes de radio et de télévision publiques et privées font une large place au français.
Ces articles sur le Maghreb sont remarquables par leur absence de préjugés, de jargon et de « langue de bois »
Cameroun, Côte d’Ivoire et Liban
La géographie du français hors Maghreb se limite à cet échantillon de trois pays. Dans les deux premiers, le français est largement et parfois exclusivement pratiqué en famille et dans la rue, ce qui « francise » les non ou mal scolarisés. Cela certes sous une forme populaire ou argotique (le « nouchi » ivoirien). Le français devient ainsi une langue africaine, mais est-ce toujours du français ? La réponse n’est pas claire (pour certains ethnologues ou linguistes, c’est « non » ; mais « l’encadrement » linguistique par le français des élites, des médias ou de l’écrit m’amène à penser qu’ils peuvent se tromper).
Au Liban, Mona Makki nous rappelle qu’un réseau scolaire francophone existait avant « le mandat » (1920). En 1996, 70 % des écoles primaires sont franco-arabes (chiffre en décroissance lente face aux anglo-arabes, le choix se faisant localement). Elles sont présentes dans toutes les communautés, y compris les Chiites autrefois peu scolarisés mais aujourd’hui les plus nombreux.
« Couleurs » de la langue et nation
Trois contributions sont moins classiquement géopolitiques. Barbara Loyer remarque que la « Francophonie » (avec un « F majuscule, donc l’institution) est passé du français « grande langue » au français « langue partenaire » (des langues locales, de l’anglais …). Elle applique cette idée à la France, avec ses langues régionales et ses « niveaux de langue » dont celui du « rap », étant précisé qu’en France « il n’y a pas de rap en arabe ». A l’échelle mondiale, Louis Jean Calvet s’attache aux « couleurs de la langue » (comprendre : sa fragmentation) pour conclure que l’intercompréhension entre « les » français ne sera pas assurée. Joseph Yvan Thériault traite des rapports entre « langue de culture » (comprenez Kultur) et « langue de civilisation » au Québec. C’est un rappel intéressant, mais théorique et qui ne fait que confirmer le lien évident entre les deux dans le cas de nos cousins.
L’inter-national
Quatre contributions sont du domaine de la « politique étrangère du français ».
Robert Chaudenson lave la Francophonie de tout soupçon de néocolonialisme. Comme beaucoup, il déplore que l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) s’occupe si peu et si mal de notre langue, étant devenue une sorte de mini-ONU se préoccupant surtout de proclamations politiques n’ayant rien à voir avec son objet initial. Il estime par ailleurs que ce n’est pas une école subsaharienne en coma dépassé qui pourra véritablement implanter notre langue, mais l’audiovisuel, pour le développement duquel il fait allusion (malheureusement sans plus) à ses propres propositions.
Anna Krasteva décrit l’attachement à la langue et à la culture française dans les PECO, presque tous membres de l’OIF. Le français y est identifié à la démocratie et jugé plus porteur d’identité que l’anglais, plus instrumental. Cet attachement culturel en déclin est relayé par l’usage professionnel, notamment via l’implantation d’entreprises françaises.
Sophie Lany-Laszlo nous présente l’action de son ministère (les Affaires Étrangères), celle de Bruxelles et la collaboration de ces deux institutions en faveur de la diversité linguistique, donc directement ou indirectement en faveur du français. Cela est agrémenté d’une vigoureuse illustration des qualités du français, langue d’une certaine idée de l’homme, d’une certaine vision du monde … la culture, les « valeurs ». (Ce discours sympathique reste très parlant pour beaucoup de francophones « volontaires », mais, en dehors de ce milieu, on nous rappelle que l’anglais et bien d’autres langues ont aussi leurs « grands textes » universalistes.)
Dans un article très concret, Olivier Archambeau insiste sur la priorité à donner en Afrique aux « formations courtes » : infirmiers, techniciens, instituteurs, praticiens de l’informatique. D’où le projet UNFM (université numérique francophone mondiale), lancé par la Fondation Pathfinder (Mali) et la Fondation pour l’Innovation Politique (Paris), rejoints par l’hôpital Georges Pompidou et le CNES. Il s’agit d’un enseignement à distance « reconstituant la salle de classe », l’enseignant faisant face aux élèves sur l’écran.
Vue d’ensemble et critique
Finalement ce très intéressant numéro est une banque de données et d’analyses un peu disparates, plus qu’une « géopolitique du français ». Sa lecture est très utile alors que l’importance de cette question est négligée en France.
Il manque toutefois les analyses mondiale, régionales (Amérique latine, Afrique, Asie, …) et celles des batailles stratégiques (Bruxelles, les entreprises, la RD Congo …). Comme on ne peut parler de tout, cela aurait pu remplacer les développements théoriques et les analyses linguistiques.
A ce propos, si l’on peut comprendre l’intérêt intellectuel et professionnel des linguistes pour l’éventuel éclatement du français, il ne faut pas pour autant les suivre dans leur militantisme pour des mesures à mon avis catastrophiques tant pour le français que pour les locuteurs concernés. Je pense à l’officialisation du « créole phonétique » haïtien et à la tentation de faire de même pour le nouchi et autres variantes. Le Québec a su sagement éviter l’officialisation du « joual » sans que cela porte préjudice à ses locuteurs, bien au contraire. Il faut laisser œuvrer les forces d’unification, notamment les médias internationaux et le prestige de ce vecteur de promotion sociale qu’est le « bon français ».
Ce refus de la fragmentation est une raison de plus de se prêter au « métissage » de la langue, souhaitable pour que tous les peuples concernés se sentent « chez eux » en français et en enrichissent le vocabulaire, les thèmes, le style , les images … comme l’ont fait Senghor et bien d’autres.
Enfin, j’aurais souhaité une réflexion sur le point suivant : si l’emploi local et l’implantation d’entreprises francophones sont un renfort puissant, peut-être le principal, pour l’usage du français, le danger corrélatif est de le voir enseigner « comme l’anglais », c’est à dire comme un simple outil, ce qui lui ferait perdre son attrait culturel. Certains diront alors : pourquoi le préférer à l’anglais ? Cette question se pose partout, même et surtout en France, et la réponse est entre les mains des enseignants.
Copyright Les Clionautes