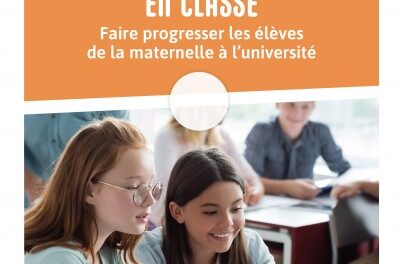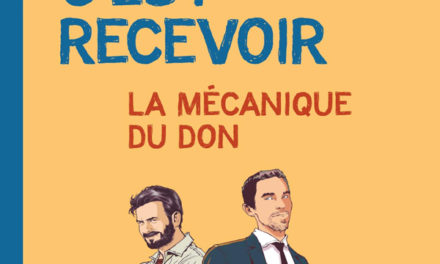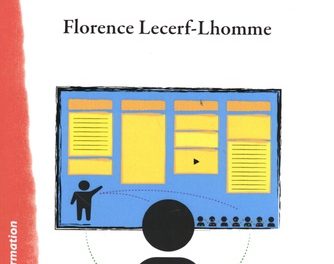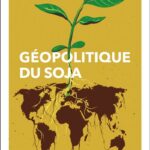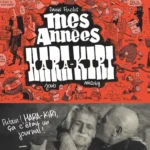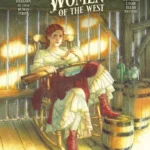De nombreux pédagogues, de Jean-Jacques Rousseau à Charlotte Masson, recommandaient de « mettre les enfants au vert ». Depuis quelques années, on assiste à un regain d’intérêt pour les dispositifs et pratiques éducatives orientés vers les espaces naturels. La crise de la Covid-19 a, semble-t-il, redonné un élan aux arguments hygiéniques et sanitaires sur les vertus de l’éducation en plein air, suscitant un intérêt croissant pour les pratiques scolaires orientées vers l’extérieur et les espaces naturels. Dans cet ouvrage, tiré de sa thèse en sociologie soutenue à Toulouse 2 en 2023, Julien Vitores met en évidence les conditions sociales dans les possibilités d’une appropriation éducative des espaces naturels. La découverte de la nature par les enfants ne se fait pas de manière parfaitement spontanée, mais engage une éducation de l’attention et du regard, subtilement étayée par les agents socialisateurs (parents, enseignants, éducateurs…).
Entre 2019 et 2021, Vitores a mené une enquête ethnographique dans trois écoles maternelles : une école publique du nord de Paris, une école privée située dans les beaux quartiers parisiens et une école rurale du sud de la France. Observations, entretiens avec les élèves, les parents, les enseignants ont constitué le matériau d’analyse du chercheur. Ainsi le propos de Vitores est de comprendre en quoi consistent les apprentissages de « socialisation écologique[1] » et leurs effets sociaux dans leur pluralité. Le travail de Vitores est extrêmement motivant car il met en avant certaines conclusions importantes pour l’enseignement, sur les enseignants et sur l’éducation au développement durable telle qu’elle est traitée dans les classes. Pour ce compte-rendu, nous avons décidé s’en développer xx.
l’intérêt pour la nature est différent en fonction des classes sociales
Première conclusion : l’intérêt pour la nature est différent en fonction des classes sociales dont sont issus les enfants et le rôle des parents est en cela déterminant. Ainsi, les parents résidant dans les beaux quartiers parisiens soulignent de manière unanime l’importance pour leurs enfants d’avoir accès à des « aménités naturelles » près de leur logement, c’est-à-dire à des espaces verts préservés. Vitores observe que pour certains de ces parents, il existe une nature « malsaine » (les espaces verts parisiens réputés sales ou souillés) et la nature « saine » (la campagne idéalisée). Les parents des classes sociales aisées ont tendance à valoriser pour leurs enfants des expériences dans des espaces naturels peu fréquentés leur permettant la contemplation et la mise du corps à l’épreuve. Les entretiens avec ces parents mettent en lumière le rôle du patrimoine détenu par ces familles à la campagne. L’accès facilité et constant à des espaces naturels diversifiés constitue ainsi un privilège de classe. Cette nature « offerte » est en réalité culturalisée, c’est-à-dire appréhendée au prisme d’un capital culturel, mobilisé et transmis dès le plus jeune âge.
Dans le cas des parents de classes populaires urbaines, c’est le « dehors » qui compte. Pareillement, pour les familles de classes populaires rurales, les avantages de la vie à la campagne sont associés au fait de posséder une maison avec jardin permettant aux enfants de jouer librement « dehors ». Vitores en vient à la conclusion suivante : la socialisation écologique des enfants reste largement tributaire d’expériences contraintes par les conditions matérielles des familles. Les enfants des classes populaires rurales ont plus facilement accès à des espaces naturels, à moindre coût. Cependant, cette accessibilité ne se traduit pas nécessairement par une conversion en une série de biens éducatifs. La valorisation pédagogique et l’appréhension de la nature résultent bien souvent de l’imposition d’un regard scolaire ou intellectuel sur le monde.
l’action scolaire et le rôle des enseignants
Deuxièmement : l’action scolaire et le rôle des enseignants est alors important dans la socialisation écologique. Reprenant des conclusions de Pierre Bourdieu, Vitores affirme que l’action scolaire balise l’espace culturel lié la nature en indiquant ce qui mérite d’y être vu, admiré, retenu. Ainsi, par des moments de monstration, les enseignants valorisent comme « exceptionnels » des objets naturels. Mais, comme on a déjà pu le voir précédemment, à l’école, les enfants ne partent pas sur un pied d’égalité en matière de nature. Les aptitudes naturalistes constituent cependant une forme de protocapital culturel, dans la mesure où « il s’agit d’atouts et de compétences que l’école valorise et récompense sans nécessairement compenser les disparités de dotation » (p.130). Ainsi, cette écologie des petits gestes distingue les « bons » des « mauvais » gestes, et, par extension, les « bonnes » des « mauvaises » personnes. Plus gênant encore, la violence symbolique de la disqualification des modes de vie de certaines familles populaires est sans doute d’autant plus forte qu’elle passe par les enfants qui, en se faisant le relais de normes écologiques diffusées par l’école, renvoient aux parents une image de « mauvais élèves » en la matière voire de « mauvais parents ».
la nature n’est pas un espace neutre
Troisièmement : la nature n’est pas un espace neutre. Contrairement à ce que les pédagogies alternatives, et malgré le fait que les enfants sont éloignés de leurs jouets et de leurs productions culturelles standardisées, la socialisation écologique peut promouvoir aussi une éducation genrée. Ainsi, les rapports genrés aux éléments naturels sont particulièrement visibles lorsque l’on demande aux enfants de « dessiner la nature », les filles représentent des fleurs, le soleil, des arbres en pleine floraison alors que les garçons dessinent des montagnes, des volcans, des insectes. Par ailleurs, les garçons sont souvent disposés à engager des rapports conflictuels et destructifs avec les non-humains. De leur côté, les filles manifestent le plus souvent un enthousiasme marqué pour des activités conduisant à « caresser » les animaux ou à « s’occuper » des plantes.
Pour conclure, le travail de Julien Vitores est stimulant et ouvre les yeux sur des pratiques et un discours tout fait et répété à l’envi. L’auteur met en garde, en matière de socialisation écologique, sur ce que l’on peut ou doit attendre des enfants. Les jeunes générations ne sont pas naturellement plus sensibles aux questions environnementales que leurs parents et elles n’ont pas vocation à « sauver la planète ». Nous terminerons ce compte-rendu en laissant le dernier mot à l’auteur lui-même :
« L’avenir de la planète ne se joue pas dans les appels individualistes aux petits gestes du quotidien, ni dans la bonté enfantine ou dans les espoirs de vois les prochaines générations mieux sensibilisées aux questions écologiques. Des choix politiques raisonnés s’imposent pour lutter à la fois contre la reproduction sociale et contre les injustices environnementales. À défaut, on risque de repeindre en vert un monde toujours plus inégalitaire » (p.210).
[1] Julien Vitores entend par « socialisation écologique » la fabrique des rapports différenciés à l’environnement.