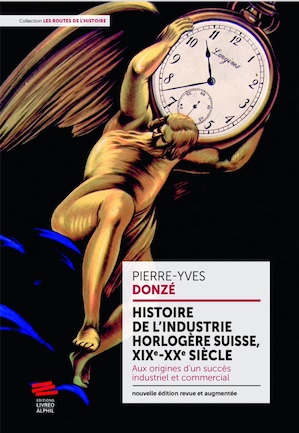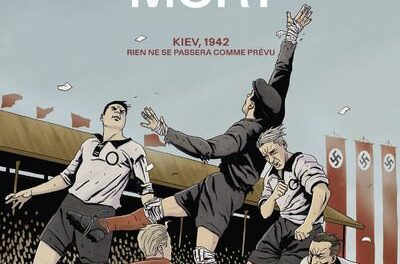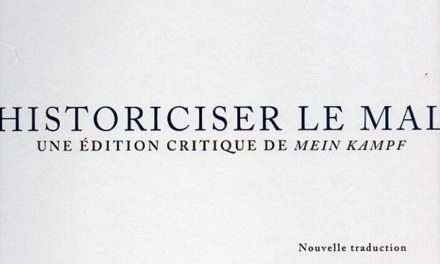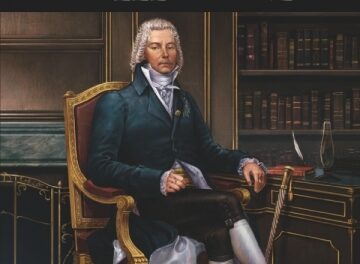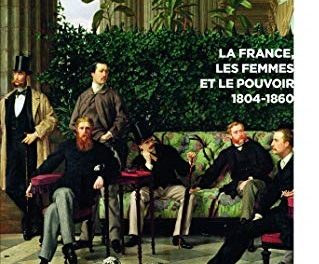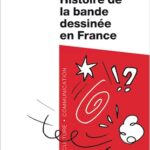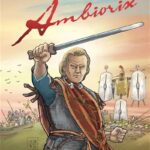Comment expliquer l’incroyable succès de l’industrie horlogère suisse ? L’objectif de ce livre est de répondre à cette question en proposant une analyse historique de l’industrie horlogère suisse replacée dans un contexte mondial. Depuis 1850, deux défis se posent à elle : l’industrialisation, le marketing.
L’horlogerie suisse dans la première partie du XIXe siècle (1800-1870)
La diffusion de l’horlogerie dans l’Arc jurassien est expliquée comme une conséquence de son essor genevois. Il faut y ajouter en réalité un développement endogène. Le système de l’établissage triomphe. Il consiste en une division de la fabrication entre de multiples ateliers et travailleurs à domicile. L’auteur propose un exemple concret à travers le suivi d’une famille du Locle. Le niveau élevé d’éducation et la maitrise d’un savoir technique ancien apparaissent comme des éléments qui permettent, sous l’Ancien-Régime, à de nombreux ressortissants de l’Arc jurassien de se lancer dans la production de montres et de diriger leur propre atelier. En Suisse, l’innovation porte plutôt sur la qualité des produits et non sur les modes de production. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la Suisse s’impose comme le principal producteur mondial de montres et exerce bientôt un véritable monopole.
Le défi de l’industrialisation 1870-1918
Le système de l’établissage est à son apogée au début des années 1870. L’horlogerie suisse entre dans une phase de modernisation de ses structures qui se caractérise par l’affirmation du mode de production industrialisé. Cependant on n’assiste pas à l’émergence de grosses usines. La-Chaux-de-Fonds est une véritable fabrique collective : on dénombre dans les indicateurs suisses d’horlogerie 1299 fabricants en 1887 et 2697 en 1900. Créées en majorité dans les années 1860-70 dans le but de revaloriser les savoir-faire horlogers, les écoles d’horlogerie voient leur mission transformée à la fin du siècle. Elles deviennent des lieux essentiels dans la transmission de nouvelles connaissances techniques aux jeunes générations formées pour la prise en charge de la modernisation des entreprises d’horlogerie. Le manque de capitaux disponibles et de grandes banques d’affaires est un trait caractéristique de l’Arc jurassien et retarde le processus d’industrialisation. La formidable croissance des exportations horlogères suisses à la fin du XIX ème siècle s’accompagne d’une nouvelle forme de communication qui illustre une évolution patente des canaux de commercialisation.
Le cartel horloger (1920-1960)
Les Etats-Unis et le Japon deviennent les principaux concurrents de la Suisse. La création de l’ASUAG ( une super holding) est une étape essentielle dans la réorganisation de l’industrie horlogère suisse. Elle caractérise la volonté de rationaliser et de contrôler le fonctionnement du district industriel. Il ne s’agit pas de mettre en cause la flexibilité du système de production. Parce qu’elle nécessite des investissements financiers massifs, la politique de concentration de l’ASUAG correspond à l’intervention des banques dans les affaires horlogères. Le tryptique Etat, horlogerie et banque est la base sur laquelle fonctionne le cartel horloger durant près de trois décennies. Cela a pour conséquence de maintenir en place la structure décentralisée du tissu industriel horloger. Cela n’empêche toutefois pas l’émergence de nouveaux concurrents industriels sur le marché mondial. L’entre deux guerres voit la création d’un second groupe industriel qui aux côtés de l’ASUAG s’affirme comme un acteur essentiel de l’horlogerie suisse. Il s’agit de la SSIH. Dans les années 1920 à 1960, la production horlogère suisse s’oriente vers une production en masse de montres bon marché. Les exportations horlogères suisses diversifient leurs débouchés.
Libéralisation et globalisation (1960-2000)
Les années 60 se caractérisent par une triple mutation commerciale, organisationnelle et technologique. Le quartz transforme aussi en profondeur le métier d’horloger. C’est une révolution autant commerciale que technologique. Le mouvement de concentration industrielle dans l’horlogerie suisse est marqué dans les années 1966-1971. Trois principaux groupes horlogers s’imposent en Suisse. L’auteur évoque évidemment l’épopée Swatch avec sa première apparition en 1983.
Vers l’horlogerie de luxe
La nouvelle tendance qui émerge autour de l’an 2000 est le repositionnement de l’ensemble de l’industrie horlogère suisse sur le luxe. Trois étapes sont à distinguer : l’émergence et la croissance de start-up, les investissements de grandes entreprises de l’industrie française du luxe et la mise en oeuvre de nouvelles stratégies par des entreprises indépendantes. La montre devient un accessoire de mode. C’est une horlogerie de luxe basée sur des produits qui incarnent des récits. Rolex connait une forte demande mondiale ce qui entraine une augmentation spectaculaire de la production de 635 000 pièces en 2000 à plus de 1,2 million en 2023. L’auteur cite d’autres exemples de marques en expliquant leur stratégie comme Patek Philippe ou Audemars Piguet.
Yves Donzé retrace donc de façon efficace cette histoire de l’industrie horlogère suisse. Dans toute l’histoire économique mondiale, l’horlogerie présente un cas rare, voire unique, d’une industrie dominée par une seule nation malgré les changements considérables de l’économie mondiale au cours des deux derniers siècles.