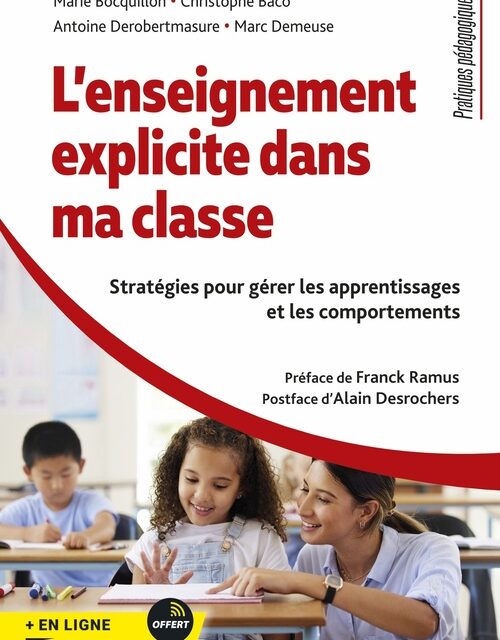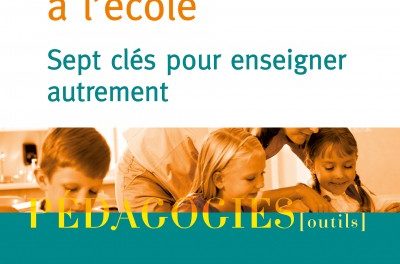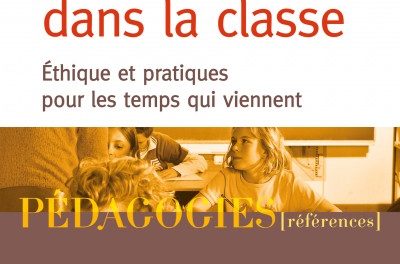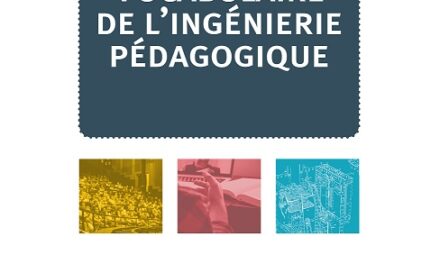Lorsqu’ils sont sondés, les enseignants français font état de deux sujets majeurs : les élèves à besoin éducatifs particuliers et la gestion de classe. Ce livre veut montrer que l’enseignement explicite peut répondre à ces deux besoins. Néanmoins, celui-ci ne doit être vu que comme un outil de plus dans la palette de l’enseignant.
L’enseignement explicite en bref
Dans l’enseignement explicite, l’élève se forge une première idée des compétences à développer grâce au partage à voix haute par l’enseignant de son raisonnement et à la démonstration par celui-ci de la manière dont il met en oeuvre la compétence attendue. C’est aussi fondé sur une forte mise en activité des élèves et un dialogue pédagogique. Les auteurs développent ensuite plusieurs raisons pour justifier la mise en oeuvre de l’enseignement explicite en classe. Cette méthode est particulièrement attentive à la question de la charge cognitive des apprenants. La quantité d’étayage requise doit être déterminée en fonction de ce qui est enseigné.
Les étapes de l’enseignement explicite de A à Z
Ce chapitre présente les cinq grandes étapes d’une leçon d’enseignement explicite : l’ouverture, le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome et la clôture de la leçon. Lors de l’étape un, l’enseignant doit présenter et justifier l’objectif. Il ne faut pas négliger alors, quand c’est possible, d’insister sur l’importance de la leçon dans la « vraie vie ». De façon intéressante, les auteurs proposent plusieurs exemples concrets à l’appui de chacune des étapes. Lors du modelage, il faut aller du plus simple au plus complexe et ne pas oublier d’introduire à la fin quelques contre exemples. Lors de la pratique, l’enseignant peut interroger plusieurs élèves en même temps, et cela peut se faire au moyen d’outils numériques. Les auteurs précisent ensuite l’idée d’étais qui peuvent être visuels ou encore verbaux. Pour aider le professeur, l’ouvrage propose un canevas de planification de leçon.
Enseignement explicite et gestion de classe
Il faut distinguer deux types de stratégies : des préventives et des correctives. Dans le premier cas, les auteurs mentionnent notamment l’importance des renforcements positifs. C’est plus constructif qu’une liste de comportements interdits. De nombreux cas et fiches concrètes sont là aussi proposées. Lorsqu’il faut passer à une étape de correction, on peut d’abord s’appuyer sur la palette d’interventions pour gérer les écarts de conduite mineurs. Parfois, le simple fait de poser une main sur le bureau de l’élève peut indiquer à l’élève qu’il y a quelque chose à corriger dans son comportement. Les auteurs s’arrêtent ensuite sur des cas plus graves.
Regards réflexifs
Il s’agit dans ce chapitre d’aider les enseignants à porter un regard réflexif sur leurs pratiques.
Là encore on trouve des outils concrets à utiliser. Ils correspondent aux différents temps de l’enseignement explicite. Il faut s’arrêter aussi sur le positif lors de ces autoévaluations. L’observation est importante pour nourrir la pratique réflexive car les enseignants ne sont pas toujours conscients des stratégies de gestion des apprentissages et de gestion de classe qu’ils mettent en oeuvre.
L’ouvrage propose un certain nombre de compléments à télécharger ainsi que des résumés à la fin de chacune des parties. Il faut mesurer aussi qu’en visant à soutenir le développement des apprenants, l’enseignement explicite propose surtout une école qui aide plutôt qu’elle ne sélectionne.