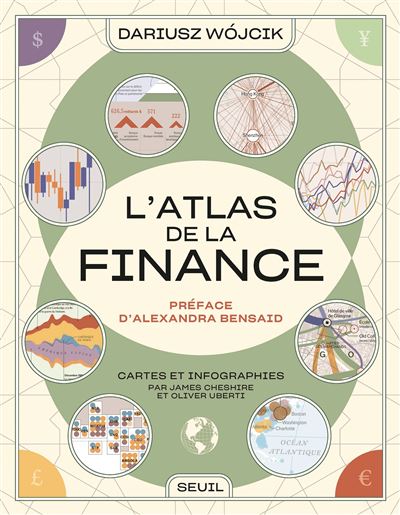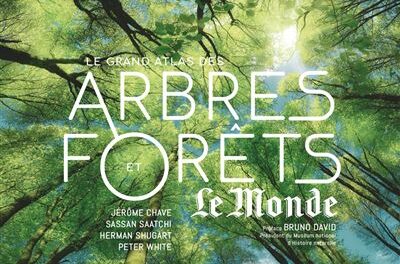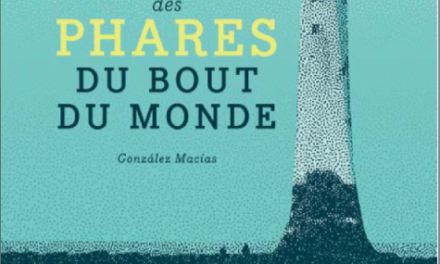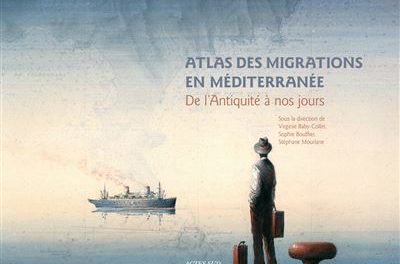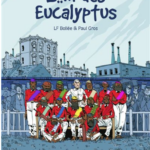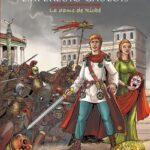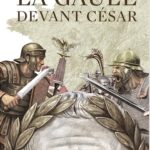Système d’échange où les interactions se font avec de l’argent, la finance apparait, dans les mentalités, comme une thématique obscure réservée à des experts en la matière. Un ouvrage vulgarisé sous la forme d’un atlas ne pouvait donc qu’être le bienvenu pour tâcher de cerner le rôle de l’argent dans l’organisation mondialisée de nos sociétés.
Dirigé par Dariusz Wójcik (professeur de géographie financière à l’université nationale de Singapour et chercheur honoraire associé à l’École de géographie et d’environnement de St Peter’s College à l’université d’Oxford) avec le concours de Panagiotis (Takis) Iliopoulos, Stefanos Ioannou, Julien Migozzi, Timothy Monteath, Vladimír Pažitka, Morag Torrance et Michael Urban, cet opus est illustré par les cartographies et infographies de James Cheshire et Oliver Uberti.
Structuré en huit parties (histoire et géographie, actifs et marchés, investisseurs et investissements, intermédiations et technologies, villes et centres, bulles et crises, réglementation et gouvernance, société et environnement), l’ouvrage a représenté 12000 heures de travail et a pu voir le jour grâce à une subvention de l’Union Européenne.
L’histoire et à la géographie de la finance
On apprend que les Sumériens qui, produisant plus que nécessaire, ont ouvert la voie au calcul de la valeur et à la planification. La diffusion du monnayage se fera d’abord aux abords de la Méditerranée puis plus loin, du fait des colonisateurs. La Chine a joué son rôle avec le développement du papier monnaie. La première forme de mondialisation aurait vu le jour à Potosi (dans l’actuelle Bolivie) à partir d’un prolifique gisement d’argent qui attira des populations des quatre coins du Monde. Les grands économistes sont évoqués : Adam Smith, un géographe de la finance lorsque Amsterdam était une place forte au niveau financier ; Karl Marx qui mit en lumière les contradictions du capitalisme et les effets négatifs de la monnaie ; John Maynard Keynes en tant que témoin de la chute du capitalisme qui proposa de le sauver en créant la Banque Centrale Mondiale. On apprend ici aussi que la production scientifique sur la finance est très masculine et très étatsunienne.
Actifs et marchés
On saisit qu’en cas de crise, les marchés développés (Europe, Etats-Unis, Australie, Japon…) se remettent mieux et plus vite que les marchés « émergents » ou « naissants ». Sont évoqués dans cette partie l’importance de l’assurance, la spéculation immobilière (notamment étrangère qui nuit aux populations locales), la privatisation des infrastructures, les transferts d’argent des immigrés « au pays » avec une direction dominante vers le Sud, le décalage culturel pouvant expliquer la vente à perte.
Un peu de technique de la finance
Les parties 3 et 4 apparaissent plus techniques. On note ici que les investissements sont naturellement locaux, régionaux sauf pour quelques paradis que sont le Luxembourg, les îles Caïman ou encore l’Irlande réputés pour leur souplesse en termes de lois et de taxes. Les inégalités entre riches et pauvres ne cessent de s’accroitre et le risque de ploutocratie est réel. On parle ici des retraites, des fonds souverains, du numérique, des Bitcoins.
Villes et centres
La partie 5 sur les « villes et centres » débute sur la cartographie de l’évolution des places financières fortes : l’Italie et Bruges entre 1200 et 1500, Anvers vers 1500/1600, Amsterdam et Londres de 1600 à 1900. On parle aussi du renversement des « binômes » entre la capitale d’un pays et la seconde ville pour des raisons politiques ou d’avancées technologiques sur les transports. Sur des durées très courtes à l’échelle de l’histoire, on constate des changements majeurs : en 1993, Londres et New-York dominaient la planète mais depuis 2006, la Chine les a rejoints avec Shenzhen, Shanghai et Pékin. Un focus est porté également sur la finance islamique qui rejette les intérêts, les opérations risquées et jeux de hasard ainsi que l’investissement dans le porc et l’alcool. La zone musulmane, déjà développée avec le pétrole se renforce en Moyen-Orient mais aussi en Asie.
Bulles et crises
Personne n’est à l’abri des crises, qu’elles soient monétaires, bancaires ou « de la dette »). Le Sud est plus exposé que le Nord. Les journaux influencent la tournure des crises en fonction de leurs propres penchants politiques. Parfois, on préfèrera sauver les banques plutôt que le reste du pays (cas de la Grèce en 2010). Les problèmes peuvent aussi venir d’une attaque extérieure ciblée : cas de la Banque du Bangladesh visée sur un jour férié.
Gestion des risques
La 7ème partie montre que la gestion des risques est pour le moins archaïque : au FMI, les Etats-Unis possèdent 16 % du droit de vote alors que leur population représente à peine 5 % de la démographie mondiale. A l’inverse, la Chine n’a que 6 % du droit de vote alors qu’elle représente 19 % de la population mondiale. Cette dissymétrie handicape le Sud. Le blanchiment d’argent est évoqué et représente 2 à 5 % du PIB mondial. Les lois anti-blanchiment sont plus ou moins respectées et efficaces selon les régions du Monde. Les agences de notation n’apparaissent pas fiables étant juge et partie. A nouveau, la domination masculine est évoquée ici au sujet des directions des sociétés de services financiers même si les choses commencent légèrement à évoluer.
Enfin, la dernière partie évoque des thèmes comme la microfinance (des prêts sans intérêts aux populations les plus marginalisées – cas de l’Inde) ou les sanctions qui sont devenues monnaies courantes. D’avenir, les questions environnementales sont traitées ici : géographie de la production/exploitation des minerais avec, lors des exclusivités, des attaques humaines et environnementales fortes (cobalt du Congo, lithium du Chili) ; obligations bleues pour financer la protection des océans ; plantation d’arbres ; action des entreprises sur la baisse de l’empreinte carbone et colonisation de l’espace par les satellites.
A la fin de la lecture de l’ouvrage, on notera que la page 170 retient l’attention tout particulièrement : elle se nomme « apprendre l’argent » et montre que les connaissances de base en finance sont très disparates d’un pays à l’autre. Les pays à fort IDH s’en sortent globalement mieux même si des variations infracontinentales sont visibles. Il est très pertinent de la part des auteurs d’interpeler le lecteur avec les quatre questions qui avaient été posées aux enquêtés pour justement déterminer leur maîtrise des connaissances financières élémentaires. Pour ma part, j’ai réussi à satisfaire aux quatre questions (diversification des risques, inflation, intérêts simples, intérêts composés), faciles à mon sens, mais ce n’est pas pour autant que j’ai réussi à rentrer dans l’ensemble des pages de cet ouvrage comme en témoigne le déséquilibre des parties de cette recension. Mais il s’agissait là réellement d’une première immersion dans un ouvrage sur la finance depuis un début de cursus dans les sciences économiques et sociales avant de partir vers la géographie, qui plus est celle de l’école primaire où la dimension économique est quasiment absente (l’aspect « consommer » est évoqué dans les programmes actuels de cycle 3, le thème « produire » l’avait été dans les programmes précédents).
Qu’on ne se méprenne pas sur les lignes qui précédent, cet atlas est une véritable mine d’or et une réussite sur le sujet. Certains thèmes demeurent complexes (pour moi) mais les efforts de vulgarisation ont été poussé au maximum : justement avec des thèmes populaires (le marché de l’art, celui du football, l’usage des smartphones…) mais surtout avec des cartographies et infographies d’une originalité et qualité irréprochables (plateau de Monopoly pour évoquer la privatisation des infrastructures, tableau périodique des éléments pour évoquer le marché des minerais, jetons de casino pour évoquer les paris les plus risqués…). L’ensemble prend corps dans une mise en page ambitieuse et soignée. Un livre précieux pour tout géographe !