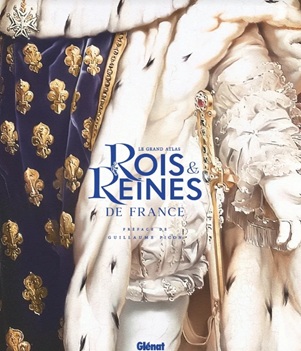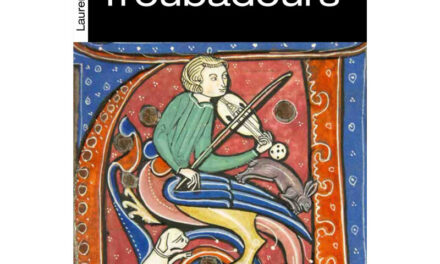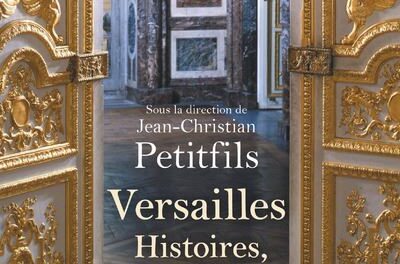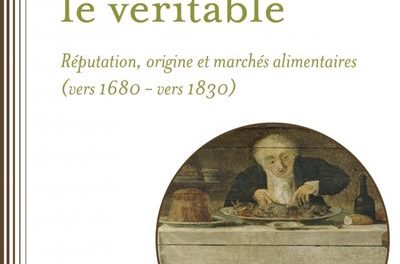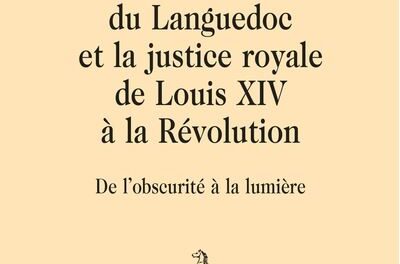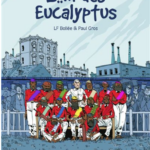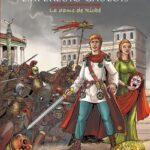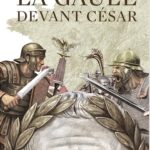A l’aide d’images, de frises chronologiques et d’arbres généalogiques, cet ouvrage présente les actions des grands personnages issus de la succession des dynasties royales et relate ainsi les étapes de la fondation du royaume en lien avec l’affermissement de la royauté elle-même. Les rois de Childéric Ier à Louis Philippe sont présentés mais aussi les nombreuses reines trop souvent méconnues et oubliées. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de ce livre de les re-mettre en lumière sous la forme d’une quinzaine de portraits.
On peut d’abord citer Clotilde, femme de Clovis Ier. Catholique convaincue, elle est à l’origine de la conversion de son époux. Celui-ci y gagne la sympathie des peuples gallo-romans et le soutien des évêques, facilitant ainsi ses conquêtes en le faisant passer pour un champion du catholicisme. Certaines sont affublées de surnoms peu amènes comme Berthe « aux grands pieds », épouse du premier roi carolingien Pépin de le Bref. D’autres ont vu leur postérité davantage valorisée comme Aliénor d’Aquitaine. Elle épouse Louis VII en 1137 mais la nullité du mariage est finalement prononcée en 1152. Elle choisit alors Henri II Plantagenêt, duc de Normandie et futur roi d’Angleterre, dont elle aura 8 enfants. Elle usera alors de son ascendant sur ses fils et organise même le mariage de la petite-fille Blanche de Castille avec le futur roi de France, Louis VIII. Devenue régente du royaume en attendant la majorité de son fils, elle lutte contre es féodaux, qui veulent récupérer leurs pouvoirs limités par la monarchie centralisée, ou affirme sa détermination lors de la crise des pastoureaux en 1251, marquée par des pillages et des jacqueries.
Certaines reines, comme Marguerite de Provence, s’occupent de politique extérieure. Elle œuvre par exemple pour établir une paix durable entre la France et l’Angleterre contre Charles d’Anjou, oncle de son mari Philippe III. Egalement indépendante et forte, Anne de Bretagne est deux fois reine de France avec Charles VIII puis Louis XII. Elle s’attache à regrouper autour d’elle des femmes de qualités en créant un véritable cours de dames. Son gynécée comptera 60 dames et près de 40 demoiselles.
Restée dans l’ombre de son mari Henri II, Catherine de Médicis est précipitée au devant de la scène politique à sa mort en 1559. Elle totalisera près de 30 ans de pouvoir, d’abord en tant que régente puis gouvernante de France, jouant même un véritable rôle de premier ministre sans en avoir le titre. Pour Richelieu, elle « a maintenu l’autorité royale dans des circonstances au milieu desquelles plus d’un grand prince aurait succombé ». La régence de Marie de Médecis, femme d’Henri IV, s’avère plus difficile, son fils œuvrant plusieurs fois pour l’écarter du pouvoir. Encore davantage détestée, Marie-Antoinette, femme de Louis XVI, est critiquée voir moquée à la fois par la Cour et par le peuple pour sa frivolité, son goût de la liberté comme son refus des conventions. Elle est guillotinée en 1793.
Ainsi, les reines ont régulièrement eu une influence sur les rois, maris ou fils, et par conséquent sur l’histoire de la France. C’est un des éléments mis en valeur par cet ouvrage qui se révèle davantage être une histoire des rois, des reines et de la France qu’un véritable atlas, si on le définit comme un recueil de cartes géographiques. Il montre surtout que la royauté s’est construite sur la longue durée, entre permanence (cérémonie du sacre à Reims) et mutation. Généalogies et portraits des rois (mais pas des reines !) de France complètent un récit chronologique en 5 temps (Mérovingiens – Carolingiens – Capétiens – Valois – Bourbons) dans un ouvrage qui fera bel effet dans une bibliothèque.