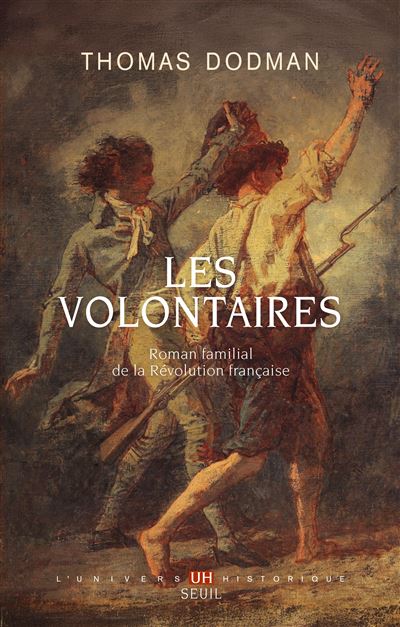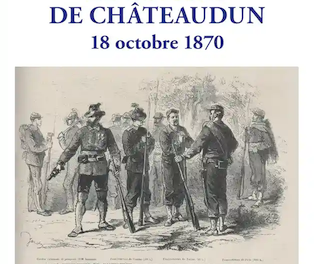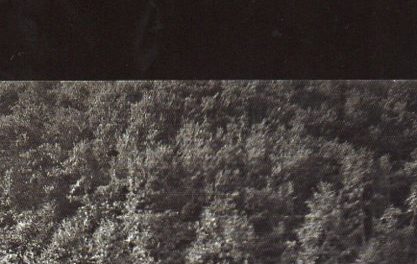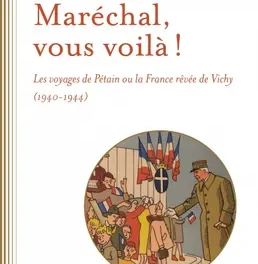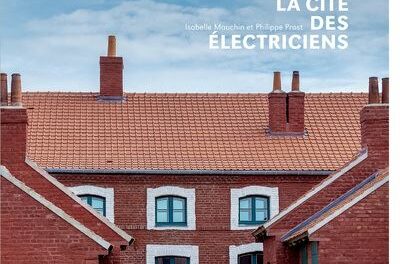Un petit village lorrain, Sommerviller, est le cadre du livre de Thomas Dodman : Les Volontaires, entre roman et histoire au raz du sol, des héros qui semblent échappés de la littérature romanesque du XVIIIe siècle. C’est une invitation à découvrir comment les personnages ont vécu la révolution, l’Empire, entre élite et peuple, ou comment trouver une place dans ce monde en évolution.
Les personnages
Une famille lorraine, ou plutôt un trio : Élisabeth Dufresne, épouse Durival, est une bourgeoise ouverte aux idées des Lumières. Femme de lettres, en matière d’éducation, elle a lu assidûment Jean-Jacques Rousseau et s’en inspire pour l’instruction de ses « enfants adoptifs », Gabriel et Charlotte. Son portrait par Jean Girardet, peint vers 1770, est celui d’une représentante de l’élite sociale de province eu XVIIIe siècle.
Charlotte de Visme, jeune fille recueillie par Élisabeth à la mort de sa mère, a fui un père, petit noble picard et autoritaire. Elle épouse Gabriel le 12 ventôse an V.
Gabriel Noël, filleul d’Élisabeth, petit paysan dont les parents apparaissent dans son acte de mariage, a été éduqué par Élisabeth. Il est le principal personnage puisqu’il est l’auteur de la correspondance qui constitue la principale source étudiée par Thomas Dodman. Engagé volontaire, on le suit dans sa vie de soldat, dans ses réflexions politiques : patriote, mais libéral. Il est donc l’époux de Charlotte et le maire du village en ce début du XIXe siècle
La forme
De courts chapitres, datés, proposent des instantanés de la vie des personnages, recomposés à partir de la correspondance incomplète que s’échangent Gabriel et les deux femmes.
Les sauts temporels d’un chapitre à l’autre évoquent plus une écriture de roman, qu’un travail d’historien. Les analyses psychologiques du jeune Gabriel en 1792 rapprochent plus de l’écriture romanesque, comme les évocations de Paul et Virginie ou la comparaison avec Fabrice del Dongo à Waterloo dans La Chartreuse de Parme.
La seconde partie qui porte sur les archives communales du village est plus historique.
Quel vécu de la Révolution ?
Si Élisabeth semble avoir été proche des auteurs des cahiers de doléances, les événements parisiens sont connus par la presse, attendue avec impatience, par Gabriel en 1789. On perçoit les hésitations idéologiques du jeune homme : tantôt partisan de la Révolution, mais regrettant la démesure de certains, une « radicalisation » modérée, ses hésitations à choisir un camp en 1792, et son soutien la Loi du Maximum, pendant la crise des assignats.
L’engagement de Gabriel dans l’armée révolutionnaire tient une grande place dans le récit : pourquoi ce jeune homme raisonnable, pétri de l’esprit des Lumières, s’est-il engagé lors de la Levée en masse ? L’auteur rappelle la création de la Garde nationale et son rôle dans les événements parisiens de l’été 1791. Gabriel s’est-il engagé par idéal, pour la solde ou pour renouer avec la lointaine tradition familiale d’une vieille noblesse déchue ? On le suit dans sa carrière militaire, peu de véritables faits d’armes, il est déçu au soir de Valmy, de n’avoir pas combattu. Les lettres informent sur l’état d’esprit des armées, le poids de la hiérarchie quand il devient dragon.
Les lettres évoquent la crise des assignats, l’évolution des conceptions du mariage quand Élisabeth évoque un mariage possible entre ses enfants adoptifs.
Les femmes ont, malgré la distance, une réelle adhésion aux idéaux révolutionnaires et participent pleinement aux manifestations patriotiques comme la fête de juin 1794, à la gloire de l’être suprême. Élisabeth écrit même une pièce de théâtre républicaine. Un an plus tard les réflexions de Gabriel sont plus négatives, il montre même une forme de mépris du peuple patriote, mais superstitieux et fanatique quand il évoque la Vendée. « Liberté de culte, certes ; mais seulement si l’on est bon patriote. » (p. 169)
Si Gabriel banalise la violence des guerres révolutionnaires, il reproche aussi à Charlotte sa défense des droits des femmes.
Monsieur le maire
Nommé maire en 1803, par le préfet, les écrits de Gabriel Noël sont désormais ceux de l’administration communale : état des permis de port d’armes à feu (oct 1803), contrat du berger communal… Ils disent la vie d’un petit « fonctionnaire public ». Ils informent sur la vie d’un village dans la première moitié du XIXe siècle.
« La biographie sociale se gonfle alors, déborde les corps des protagonistes principaux, verse vers la micro-histoire d’un village rural parmi tant d’autres. » (p. 40)
Déjà au moment de la Révolution la question scolaire tient une grande place dans les réflexion, puis le recrutement de l’instituteur, son salaire, l’aménagement d’une école sont un souci récurent de a famille et de l’équipe municipale. Élisabeth et Charlotte rêvent d’une école pour les filles.
Les écrits du maire sont moins personnels, la description de l’économie locale, l’évolution du droit de propriété et la défense des usages collectifs des communaux disent ce que fut ce début de XIXe siècle, quand la corvée seigneuriale perdure sous la forme de la contribution en nature pour la collectivité.
L’auteur aborde la question des finances communales, les élections, l’organisation de la conscription, la police rurale et les vicissitudes climatiques : l’année sans été 1816 et ses conséquences sociales.
Guillaume Mazeau écrivait dans la revue L’Histoire : « Original, le livre défatigue le récit habituel. ». Le projet est séduisant, l’écriture agréable, mais j’avoue avoir été gênée par cette tentation du roman comme si l’auteur avait été comme prisonnier de sa source : la correspondance de Gabriel.