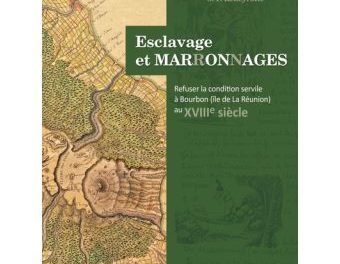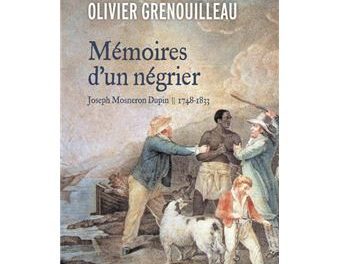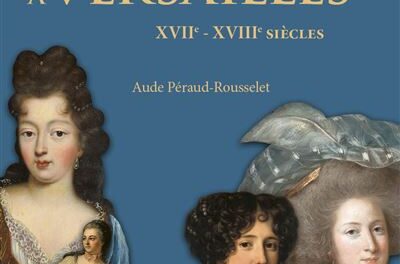Spécialiste de la mode, Sylvie Le Bras-Chauvot par son métier de journaliste a mené des recherches sur l’évolution du vêtement au XVIIIe siècle. Elle s’est particulièrement intéressée à l’impact de Marie-Antoinette sur la mode à la cour de Versailles, pourtant régie par l’étiquette louis-quatorzienne. Ce livre aborde l’évolution du goût vestimentaire impulsé par la reine en étudiant sa garde-robe. Au fil des pages, l’auteur présente aussi les personnalités racontées dans des encarts biographiques forts commodes, rappelant ainsi le rôle de chacun dans l’entourage de la souveraine. Au centre de l’ouvrage, sont regroupés des tableaux et des gravures de mode qui étayent le propos.
Les deux premiers chapitres présentent l’arrivée et l’installation de la jeune archiduchesse en France pour son mariage avec le dauphin. Avant-dernière et huitième fille de Marie-Thérèse d’Autriche qui a eu 16 enfants, Marie-Antoinette a reçu une éducation un peu lacunaire. Après les projets d’alliances confirmés avec la France, l’impératrice découvre catastrophée qu’il fallait corriger son français et son écriture très approximatifs, ainsi que son caractère versatile et son goût peu prononcé pour l’étude. Venu spécialement de France, l’abbé Vermond est chargé de combler les lacunes d’une fillette qui ne pensait qu’à s’amuser. Il sait si bien prendre l’enfant qu’il sera plus tard son secrétaire et son lecteur jusqu’en 1789. Subitement la jeune femme qui grandissait librement, est entourée de tant d’attentions que la tête a du lui tourner. Elle en a certainement conservé un impérieux besoin de plaire comme le montre le portrait complaisant de Joseph Ducreux peint en 1769 et envoyé à Louis XV qui se dit pleinement satisfait. Le port de tête altier interprété comme de l’arrogance à Versailles lui vient de son apprentissage de la danse préconisé par le danseur Noverre (le costume de scène influencera ses goûts vestimentaires) et prépare son image particulière dont « la Galerie des Glaces sera le podium ». Deux ans avant l’arrivée en France, Marie-Thérèse se préoccupe d’habiller la future dauphine en lui constituant un trousseau parisien avec l’aide de son allié, le comte de Choiseul sous la surveillance de l’ambassadeur autrichien Mercy-Argenteau. Elle prévoit une enveloppe de 400 000 livres pour les « commissions parisiennes ». Selon la tradition depuis le XVIIe siècle dans l’aristocratie, une poupée de mode appelée aussi Pandore (deux fois plus grandes qu’une Barbie actuelle) est envoyée à Vienne avec une panoplie de vêtements identiques à ceux prévus pour l’archiduchesse pour acceptation. Plus tard, Marie-Antoinette en enverra des quantités à ses sœurs pour les informer des nouveautés parisiennes. Malgré les préparatifs, cette jeune fille de 14 ans dont le destin tout tracé consiste à pérenniser une alliance et à donner une descendance, n’imagine pas ce qu’elle devra affronter : les coutumes de « ce temple des vanités » qu’est la cour de Versailles régie par une étiquette d’un autre âge, les rivalités, la jalousie, les médisances sur celle qu’on appelle rapidement l’Autrichienne. En mai 1770, après trois semaines de voyage, la future dauphine est reçue à la frontière dans un pavillon éphémère et une pièce dite de la remise. Dans l’intimité de ses dames autrichiennes, elle troque sa tenue blanche de voyage (contrairement à ce qu’a affirmé Mme Campan) contre « une robe à la Française » commandée par sa mère et non en « grand habit d’étiquette » selon les usages à la cour de France en présence du roi. Comme la suite y est assujettie, un premier scandale vestimentaire est déclenché, alimenté par la comtesse de Noailles, la dame d’honneur de la jeune femme qui la qualifiera de Mme Étiquette, prise bien vite en aversion. L’entourage de la feue reine, décédée à 65 ans en 1768 est affecté au service de la princesse dont les manières spontanées surprennent. Après un épuisant voyage, Marie-Antoinette rencontre le roi de France et son futur mari à Compiègne dans le grand habit d’étiquette requis. Accueillie à Versailles pour ses noces, Louis XV lui offre un luxueux cabinet garni de joyaux à son intention mais aussi des présents à remettre à d’heureux élus qui les recevraient de sa main le lendemain de ses noces. La jeune fille est éblouie, plongée dans « un songe », comme elle l’écrit à sa mère. Deux heures sont nécessaires pour habiller la future mariée. Pas de robe blanche, ni de voile mais une version grandiose du fameux grand habit, composé du grand corps ou bustier conique baleiné et lacé dans le dos modelant le buste en gorge de pigeon, une jupe coordonnée posée sur un panier pouvant mesuré jusqu’à 7 m où se placent les coudes et d’une queue ou bas de jupe fixée autour de la taille formant une traîne, dont l’étoffe somptueuse enrichie d’or et d’argent émerveille les contemporains. Le dauphin est vêtu du costume de l’Ordre du Saint-Esprit fondé par Henri III. Après le mariage, le cortège royal se rend en soirée à la nouvelle salle d’opéra toute illuminée, où une foule l’attendait pour assister au spectacle mettant en scène le souper public de la famille royale. Louis XV semble ravi par les atouts et le charme naturel de la blonde dauphine pourtant un objet de curiosité autant que de médisances. Cette belle cérémonie aura coûté 3 millions de livres. Marie-Antoinette déchante vite. Son jeune âge la rend vulnérable aux intrigues curiales. La favorite de Louis XV, Mme du Barry, « si femme et tant aimée », alimente des ragots sur les jeunes mariés ce qui provoque une haine implacable contre cette roturière. Louis XV devra attendre deux ans pour que la dauphine daigne lui adresser la parole. Cette dernière découvre les multiples obligations strictement minutées inhérentes à sa position et la tyrannie de sa nouvelle vie : lever en grande pompe, messe, diner, souper, sieste, bonsoir du roi et devoir conjugal que l’on sait difficile. La dauphine s’ennuie, même si elle trouve refuge chez ses tantes, les filles célibataires du roi, bien plus âgées et habiles au persiflage (Adélaïde, Victoire et Sophie). A Versailles, les garde-robes saisonnières des reines et des princesses sont renouvelées trois fois par an, le vestiaire d’été servant jusqu’à l’automne. Les anciennes tenues sont « réformées » et attribuées à la dame d’atours qui peut les revendre avec profit. Ainsi en a été du trousseau envoyé par Marie-Thérèse d’Autriche. Cet avantage appelé droit de réforme représente des revenus substantiels que madame « Étiquette » s’est empressée de s’emparer. Mme de Noailles refuse également d’admettre des robes plus modernes, des « déshabillés à la mode » plus décontractés pour l’intimité et adoptés par les tantes ou la Du Barry. Elle aurait exercé une pression vestimentaire qui aurait frustré l’adolescente dans sa féminité naissante. Son entourage aurait profité de l’ignorance de la princesse pour voler et détourner de l’argent, imputant les sommes à une dauphine dépensière. Louis XV désigne une nouvelle dame d’atours plus fiable qui a découvert le méfait. Pour les chaussures, le droit de réforme revient aux femmes de chambre. On en prévoit 4 par semaine ! Même si Marie-Antoinette a du subir de vives critiques et des concurrentes à la cour comme Marie-Joséphine de Savoie qui devient l’épouse du comte de Provence et qui reçoit un trousseau bien plus précieux, elle embellit de jour en jour et patiente jusqu’à occuper la première place.
Louis XV disparu, Marie-Antoinette entend se débarrasser des entraves qui ont brimé sa personnalité. Mme du Barry est rapidement écartée et les règles de l’étiquette sont modifiées alors que le roi offre à sa femme le domaine du Trianon et double le budget de sa cassette personnelle. Il faut dire que les nouveaux souverains n’ont à priori rien de commun, ce qui ne les empêche pas d’avoir une certaine complicité. Marie-Antoinette se passionne alors pour des artistes, notamment des femmes comme Élisabeth Vigée Le Brun ou Mademoiselle Bertin qu’elle rencontre par l’intermédiaire de sa cousine, la duchesse de Chartres. La marchande de modes (métier qui consiste à procéder à l’ornementation des robes sans intervenir sur les coupes, reconnu comme une activité officielle en 1776) s’avère une entrepreneuse hors pair qui bénéficie d’une intimité exceptionnelle avec une souveraine en recherche d’image. Elle sut inventer un vestiaire moderne en osmose parfaite avec la volonté royale de modifier « l’étiquette » de Versailles. La modiste sera d’ailleurs invitée à un spectacle au château, une abomination pour la noblesse conservatrice. Pourtant son succès est croissant. A Paris, toutes veulent du Bertin. Le Grand Mogol, magasin proche du Palais Royal, acheté par la jeune femme devient une étape obligée pour les gens fortunés. On y voit les dernières créations destinées au bal de la reine, des produits luxueux, exclusifs et forts chers. L’indissociable coéquipier de la modiste est le fameux Léonard ou plutôt les frères Léonard. Le grand Léonard, celui qu’on appelle « Le Marquis », ou Léonard le Jeune qui s’est formé à l’Académie de coiffure de son frère aîné. Ce dernier entre ensuite à Versailles comme valet coiffeur de la reine avec son cousin sans être attaché uniquement à la coiffure de la royale tête, Marie-Antoinette considérant que son intervention sur plusieurs personnes stimulait sa création. Le fameux coiffeur invente des folies capillaires. Les têtes sont ornées « d’un espèce d’arbre d’une hauteur extravagante » agrémenté de plumages, de rubans, de gaze, de perles… Ainsi la coiffure devient un élément essentiel à la mode. La reine ne portant pas de perruque, l’artiste se rend à Versailles, tous les dimanches, pour coiffer la souveraine « à fond ». Après sa première grossesse, Marie-Antoinette perd des cheveux dans la zone frontale et Léonard invente « la coiffure dite à l’enfant » qui consiste à travailler les cheveux longs à l’arrière avec des parures de tête ou des chapeaux, autant d’éléments de mode à diversifier qui seront copiés dans toute l’Europe. Le fidèle « merlan » (nom donné à l’époque pour les coiffeurs qui poudrent les têtes comme la cuisinière le fait sur le poisson du même nom) suit sa reine jusqu’à Varennes et ne la quitte plus jusqu’au 10 août 1792.
Indéniablement, la reine révolutionne la garde-robe des femmes de son temps. Déjà, elle démode les étoffes chamarrées à motifs, les fastueux brocarts, damas, lampas à ramages sophistiqués pour les remplacer par des soieries épurées (de la florence, du taffetas, du satin ou du velours) ou des cotonnades (du bazin, et de la mousseline). Marie-Antoinette aime les tissus unis ou rayés avec des demi-teintes composant une palette de lilas, vieux rose, prune ; des bleus variés, une gamme de beiges et de bruns. Les robes épurées disparaissent sous une profusion de garnitures et d’ornementations « inventées par Mlle Bertin, en témoigne le premier portrait officiel daté de 1775, peint par Gautier-Dagoty, avec un incroyable grand habit bleu ciel couvert de bouillons de gaze piqué de lys blancs. Afin de libérer les contraintes corporelles, une robe à la française revisitée fait son retour : plus de pièce d’estomac mais une poitrine retrouvant sa courbe naturelle, des manches collantes. La Galerie des Modes tire « une édition spéciale » qui présente les nouvelles robes d’étiquette qui suppriment des codes ancestraux et bouleversent l’artisanat local. Contrairement à une idée reçue, la souveraine ne porte pas ses robes qu’une seule fois. Sachant qu’elle change de tenue trois fois par jour, elle aurait consommé plus de 1000 tenues. En réalité, les robes sont régulièrement rafraîchies par de nouvelles ornementations, celles de Mlle Bertin ou celles de Madame Pompey, une autre marchande dont le coût des garnitures dépasse celui du tissu utilisé pour la robe. Recomposer un vêtement en fonction des circonstances n’est pas toujours économique. Selon Mme Campan, la garde-robe royale se résume à 108 pièces annuelles avec une répartition variable selon les sources : des grands habits d’étiquette, des robes à la Polonaise, des robes fourreaux à l’anglaise, des robes à la turque, ou des chemises à la reine constituées d’une seule pièce de mousseline ou de linon portées sur un léger corset baleiné laissant le corps au naturel (une création de loin la plus originale du XVIIIe siècle qui donnera de nombreuses déclinaisons jusqu’à la période révolutionnaire). S’y ajoutent les nombreux accessoires comme les souliers (ne comportant ni pied droit ni pied gauche, ils sont très inconfortables et peu adaptés à la marche, en escarpins ou en mules aux talons en bois recouverts de cuir), les fichus, les ombrelles, les éventails. Les différents documents permettent d’évaluer le coût exorbitant de ce « dressing » : les dépenses vestimentaires de Marie-Antoinette représentent un montant jamais atteint de 258 000 livres, avec un dépassement de 138 000 livres par rapport au budget qui lui est alloué. Mais elle ne fait que suivre les dépenses de la famille royale, sachant que la même année, les dettes du comte d’Artois s’élèvent à 21 millions de livres. Le système versaillais de la réforme qui consiste à céder les vêtements de la saison aux membres de la cour qui les revendent à leur tour, engendre des abus et des difficultés à réduire les coûts. Les divers marchands profitent de gains substantiels en gonflant les factures. Louis XV ne l’ignorait pas en affirmant à son ministre Choiseul : « Les voleries dans ma maison sont énormes : mais il est impossible de les faire cesser… » Tous les services sont concernés, les écuries, le vénerie, l’éclairage, la bouche…, même les plus humbles serviteurs perçoivent des avantages en nature. Par exemple, les préposés à l’éclairage de la reine dont le budget annuel est presque égal à celui des vêtements peuvent couler « le droit de bougies blanches et jaunes » pour un commerce particulièrement lucratif car la cire d’abeille s’avère un luxe inabordable pour les plus modestes. Même le linge de chaise (équivalent du papier hygiénique) est écoulé après blanchissage par le « chargé d’affaire de sa Majesté »
Sylvie Le Bras-Chauvot clôt son ouvrage sur une période plus sombre pour le couple royal. Après avoir perdu leur dernière fille Sophie en 1787, les parents déplorent le 4 juin 1789, le décès du dauphin Louis-Joseph, pendant les événements révolutionnaires bien connus. Alors que les amis et les membres de la famille royale fuient la France sur la demande de Louis XVI, la reine subit des chocs émotionnels qui ont entraîné une blancheur prématurée de sa chevelure. Désormais « emprisonnée » aux Tuileries après les journées d’octobre, Marie-Antoinette se montre néanmoins coquette se sachant observée. Certains l’appellent « la poule d’Autriche ». Il s’agit de se montrer mère et reine en restant digne pour elle-même et pour la monarchie. Rapatrié à Paris, le vestiaire de la souveraine n’évolue plus. En 1790, Mlle Bertin envoie une facture à moitié moins élevée. Entre deux deuils, la souveraine n’a pas perdu le goût des fleurs et ses grands habits évoluent en fonction des garnitures conseillées par la modiste. Après Varennes en juin 1791 et la mort de son frère Léopold en janvier 1792, les commandes cessent, excepté des ajustements de deuil. Transférée au couvent des Feuillants puis à la prison du Temple, la famille royale attend la vindicte politique. Il n’est plus question que de survie et pourtant les apparences vestimentaires connaissent un engouement parisien sans précédent puisque l’habit témoigne alors de ses idées politiques et de son rang social. Les coquettes d’alors se parent de panaches de plumes, de rubans et de garnitures florales copiées sur les tenues de la reine et de la coiffure à l’enfant. Depuis le 10 août 1792, les services de la garde-robe n’étant plus actifs, la famille royale a du être « rhabillée ». Le trousseau est constitué grâce à des « anciens fournisseurs » de Versailles. Un vestiaire assez fourni s’avère digne de la bourgeoisie, mais beaucoup trop fragile pour l’endroit, et des raccommodages sont vite nécessaires. Après la mort de son mari, Marie-Antoinette reçoit son dernier vestiaire entièrement noir composé notamment d’une robe de grand deuil avec des ajustements sobres de Mlle Bertin conformes à l’ancienne étiquette. La modiste réussit à s’enfuir en Angleterre où son commerce a perduré.
Sylvie Le Bras-Chauvot nous propose un ouvrage bien documenté que l’on parcourt avec plaisir. Elle donne notamment une description très détaillée et sourcée des vêtements portés par la famille royale sur les différents tableaux officiels de la fin du XVIIIe siècle, ce qui sera très utile pour qui s’intéresse à de telles représentations.