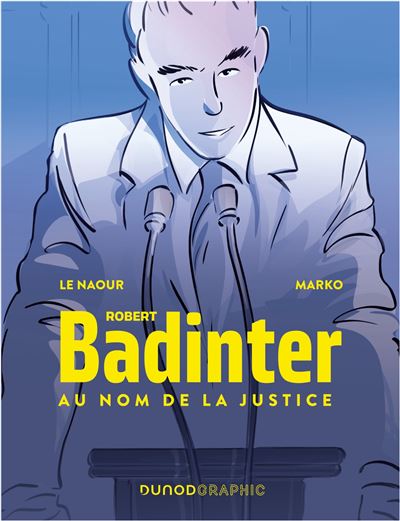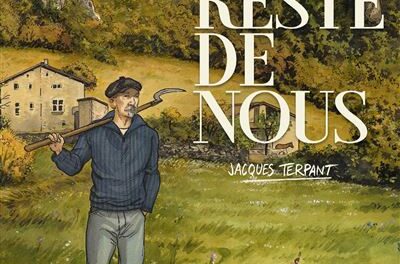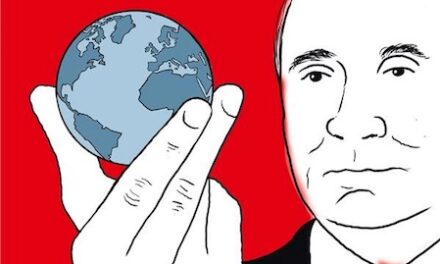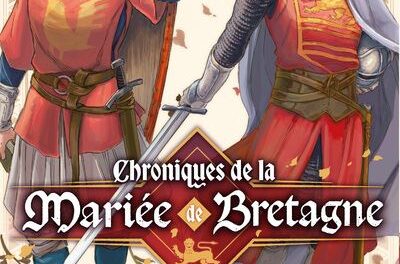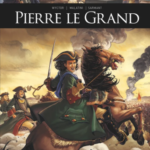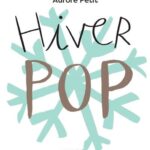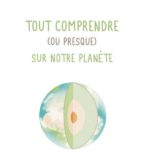Ce roman graphique est le fruit de la collaboration de Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste du XXe siècle, bien connu des Clionautes, et de Marko, dessinateur prolixe dans des séries à succès. Après la mise en lumière de Gisèle Halimi, recensée sur la Cliothèque, ces deux auteurs se penchent sur la biographie de Robert Badinter dont la panthéonisation est annoncée par Emmanuel Macron.
Un récit poignant sous forme de témoignage
L’orphelin de la République
Né à Paris en 1928, d’une famille juive récemment naturalisée française, Robert est élevé dans le respect d’un pays de liberté et d’égalité qu’il se doit de servir. Les valeurs défendues sont l’assimilation et le travail.
A 12 ans, Robert dit « quitter l’enfance » pour connaître les douleurs de l’occupation allemande et les persécutions des juifs. Quand il comprend qu’il ne reverrait jamais son père exterminé dans les camps, le jeune homme se considère comme l’éternel orphelin. « Si l’on cherche les raisons de mon engagement pour la Justice, pour le droit, il faut remonter à cette époque. Je suis le fils de l’homme traqué, dépossédé de ses droits, persécuté, assassiné, dont il ne reste rien sinon le souvenir enfoui en moi ».
Le temps de l’insouciance
Après des diplômes de droit et de lettres et un séjour aux États-Unis, Badinter devient sans véritable conviction avocat et travaille pour Henry Torrès, un ténor du barreau grâce à qui il se forge un beau carnet d’adresses.
En 1954, sa rencontre avec Pierre Mendès France le pousse à l’engagement politique : contre la colonisation, en opposition avec la Ve République, pour la défense de Maurice Audin. Il se rapproche alors de François Mitterrand.
Après son agrégation en droit, Badinter rencontre la jeune intellectuelle Élisabeth qu’il épouse en 1966. La même année, il ouvre un grand cabinet d’affaire avec son confrère Jean-Denis Bredin. Tant de succès devraient le combler, cependant il avoue son insatisfaction.
L’épreuve
Robert Badinter trouve une cause à défendre. En 1972, Roger Bontems et Claude Buffet, coupables d’une prise d’otages à la prison de Clairvaux, commettent un double assassinat. Malgré l’issue du procès montrant l’unique responsabilité de Buffet, les jurés condamnent à mort les deux complices. Révolté par la mort d’un homme qui n’a pas réellement tué, et qui ne sera pas gracié par le président Georges Pompidou, l’avocat devient un inconditionnel de l’abolition : « celui qui n’a pas tué ne peut être tué ».
Contre la peine de mort
S’en suivent des mois où se multiplient des conférences militantes afin de convaincre de l’inutilité du sang versé.
Son combat le pousse à co-défendre Patrick Henry qui a séquestré et tué un enfant de sept ans de sang-froid. L’attitude du meurtrier pendant l’instruction, choque la France entière. Relâché dans un premier temps faute de preuves, il provoque la Justice en affirmant sa position en faveur de la peine de mort pour les tueurs d’enfant. Une flambée de haine s’empare du pays. Le présentateur télé, Roger Gicquel, résume la situation : La France a peur !
L’avocat pénaliste oriente son réquisitoire sur la responsabilité des jurés « participant à un assassinat programmé par l’État », et qui ne se prononce pas sur la culpabilité déjà établie, mais sur le droit de vie ou de mort d’un homme. La peine prononcée à l’encontre de Patrick Henri sera la réclusion à perpétuité.
L’abolition de la peine de mort devient un sujet politique et des pressions, jusqu’à celle du conseil de l’Europe s’exercent sur la France. Mais seule la volonté d’un président a permis la fin de la peine capitale.
Malgré l’opinion majoritaire des Français en faveur de la peine de mort, François Mitterrand, élu président de la République, gracie « l’enfant », Philippe Maurice condamné à mort à tout juste 24 ans. Robert Badinter est alors nommé garde des Sceaux. Le 17 septembre 1981, l’abolition de la peine de mort est votée par 363 députés sur 486 votants à l’Assemblée nationale et le 30 septembre 1981 le texte est adopté par le sénat
Au service de la République et de l’humanité
L’état de grâce est terminé. Une série de mesures est prise par le ministère comme la réforme de la magistrature trop dépendante du gouvernement ou la dépénalisation de l’homosexualité. Cependant, un des grands combats de Robert Badinter est d’humaniser la détention carcérale (des parloirs libres pour les familles, des TIG pour les délinquants condamnés à des peines de moins de 6 mois…). Le ministre de la Justice est vivement critiqué, jugé trop permissif à droite et trop modéré à gauche.
La fin de l’ouvrage évoque le procès du boucher de Lyon, Klaus Barbie, condamné à la perpétuité le 4 juillet 1987. Les caméras entrent alors dans les tribunaux. Plus tard, Robert Badinter apprend le passé vichyste de François Mitterrand et son amitié avec René Bousquet… Il assiste à la montée de l’extrême droite. Il soutient la création de la cour internationale de la Haye, chargée de juger les criminels de guerre.
« Vous verrez, un jour on y jugera Poutine. »
« Un jour, il y aura l’abolition universelle de la peine de mort. Mais je suis trop vieux pour voir cela ».
Une simplification du dessin au service des idées
La lecture de ce roman graphique s’avère agréable et passionnante. Le graphisme et surtout la mise en couleur, par petites touches de Marko, valorisent le récit. Le parti pris d’une simplification des formes jusqu’à l’ellipse permet de recentrer le lecteur sur le propos. La narration intimiste et réflexive de Robert Badinter, qui s’adresse directement au lecteur, est sublimée par la mise en page très étudiée.
L’ouvrage est sans nul doute une réussite. Il est destiné à un large public, notamment aux lycéens qui pourront se familiariser avec le parcours d’un homme hors du commun porteur de valeurs humanistes universelles. Il contribuera à former les jeunes générations sur les principes de notre République.