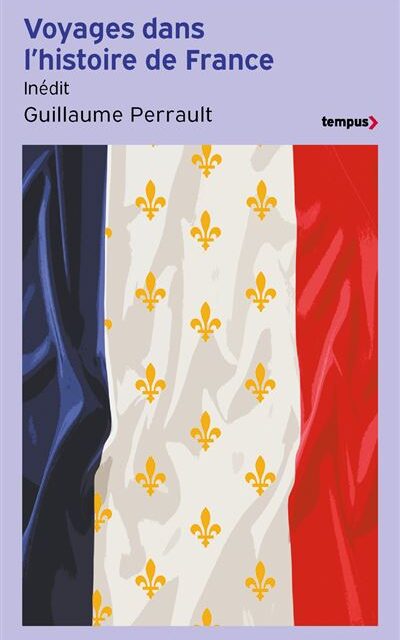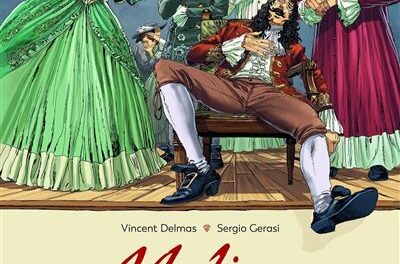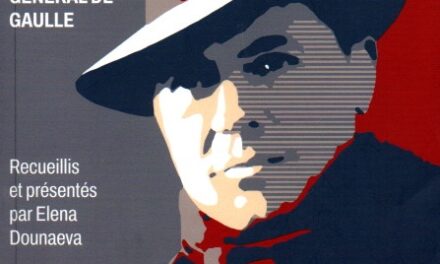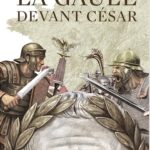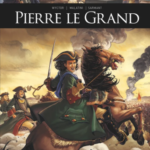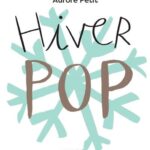Maître de conférences à Sciences-Po, rédacteur en chef au Figaro en charge de l’histoire, Guillaume Perrault publie régulièrement dans ce quotidien des grands récits qui éclairent le présent à la lumière de l’histoire. Ce sont quinze de ces grands récits, allant de Louis XIV à nos jours, qui sont publiés. L’auteur cherche à renouer avec une histoire-récit qui concilie exactitude et plaisir de lecture. Son modèle est Alain Decaux dont il regardait les émissions télévisées dans sa jeunesse. Il rend hommage au sérieux du travail des historiens, mais son ouvrage est aussi une réponse à ceux qui, à l’extrême-gauche, font un usage militant et idéologique de l’ Histoire : une histoire uniquement repentante, occultant certaines questions dérangeantes pour la gauche ( la Vendée, l’antisémitisme de gauche), ne voyant aucun moment glorieux dans l’histoire de France. Il rend hommage à Raymond Aron et à la lucidité de ses analyses. Ses modèles nous paraissent être des historiens libéraux et tenants de l’histoire politique de la nation comme François Furet ou Patrice Gueniffey.
Ancien Régime et monarchie
Hier comme aujourd’hui l’état de santé des monarques et des dirigeants suscite l’intérêt. Louis XIV a été un roi qui a lutté contre la maladie toute sa vie. Dès l’âge de quatre ans, il a été atteint par la variole. Par la suite, il a été régulièrement atteint par la maladie. A 20 ans, en 1658, il manque de mourir de fièvre typhoïde. A partir des années 1680, Louis XIV souffre de graves problèmes dentaires ; de surcroit, un chirurgien perfore accidentellement la mâchoire, ce qui nécessite une opération difficile et douloureuse. Les derniers mois de Louis XIV sont très douloureux. Il meurt de la gangrène sans doute due au diabète le 1er septembre 1715.
Sous la Régence, les projets de Law ( 1671-1729) qui est autorisé à fonder une banque financée par une émission d’actions et à émettre des quantités très importantes de billets pour stimuler la croissance et pour réduire l’endettement de la monarchie suscitent l’intérêt. Law obtient le monopole des échanges commerciaux avec la Louisiane. Il prend le contrôle d’autres compagnies commerciales dont certaines pratiquent la traite des Noirs, et obtient l’intégralité de la Ferme générale. En janvier 1720 il devient contrôleur général des Finances. Au total, les bénéfices tirés du monopole commercial et de la collecte des impôts indirects servent à garantir la valeur des actions. Mais les achats d’actions provoquent une bulle spéculative car l’activité réelle de la compagnie du Mississipi demeure modeste. Pour tenter de sauver son système Law émet des quantités considérables de billets. D’abord séduit par le projet de Law, le Régent revend plusieurs milliers d’actions. Le 17 juillet une panique provoque un « krach de moyenne intensité » . Le bilan est ainsi nuancé. Certains estiment que la banqueroute de Law a contribué au développement de la méfiance face aux banques et au crédit Peut -être le projet de Law était-il trop ambitieux et trop fragile contrairement à la Banque d’Angleterre créée en 1694, banque d’ Etat aux intérêts liés à ceux du gouvernement. D’autres pensent que Law a permis de réduire la dette publique et a peut- être contribué à l’essor économique du XVIIIème siècle ; certains économistes comme Schumpeter louent la profondeur de sa pensée.
La très remarquable exposition des Archives nationales consacrée à la famille royale aux Tuileries (octobre1789-10 août 1792), ainsi que le décryptage fort complexe de leur correspondance permet à Guillaume Perrault d’évoquer les relations entre Marie-Antoinette et le comte suédois Hans-Axel de Fersen. Ces liens sont anciens et se renforcent dans les années 1780. Il est probable que cette passion amoureuse soit restée platonique. Au-delà de Fersen, Guillaume Perrault dresse un portrait intéressant de la manière dont l’aristocratie militaire européenne pouvait se mettre au service des monarchies. Il rappelle aussi que Fersen participa à la guerre d’ Amérique. Fersen joue un grand rôle dans la fuite de la famille royale le 20 juin 1791. Par la suite, Fersen, installé à Bruxelles, ne parvint pas à convaincre Louis XVI de fuir à nouveau. Il connut lui aussi une mort tragique. Devenu grand maréchal du royaume de Suède, il fut lynché par la foule le 20 juin1810
La période révolutionnaire
Guillaume Perrault consacre deux chapitres à la période révolutionnaire. Le premier est consacré aux guerres de Vendée. Guillaume Perrault évoque le soulèvement vendéen, ses premiers succès puis l’écrasement de la « Vendée militaire » à la fin de 1793. Mais en même temps se développe chez certains Conventionnels, en particulier Barère, une volonté exterminatrice. Des villages entiers sont passés au fil de l’épée. Les « colonnes infernales » du général Turreau massacrent la population avec l’approbation du Comité de salut public. Cependant en avril 1794, un conventionnel en mission, Lequinio, dénonce devant le Comité de salut public les violences commises par les soldats républicains. Il souligne que les massacres ne peuvent que renforcer la détermination des Vendéens et prône la prédication civique et l’indulgence. A partir du printemps de 1794, les massacres continuent mais sur une moindre échelle. La nomination de Hoche à la tête des armées de l’Ouest marque la fin des tueries de civils. Les pertes vendéennes sont évaluées à 170000 tués. Faut -il voir dans les massacres des Vendéens, un évènement précurseur des massacres de masse du XXème siècle à la fois par leur ampleur et par la bonne conscience de leurs auteurs ? La visite d’Alexandre Soljenitsyne aux Lucs- sur- Boulogne le 25 septembre 1993 pourrait le laisser penser.
Guillaume Perrault consacre un chapitre à la présence de Bonaparte à Gaza en 1799 dans le cadre de l’expédition d’ Egypte. Les savants qui accompagnent Bonaparte cartographient la région, cherchent des correspondances avec la Bible, ou contemplent l’église Saint – Porphyre bâtie par les Croisés. Les projets du Directoire – couper la route terrestre des Indes- rejoignent les rêves de gloire de Bonaparte : » Il faut aller en Orient, toutes les grandes gloires viennent de là ». Après la victoire des Pyramides et le désastre naval d’Aboukir (les Anglais détruisent la flotte française), le Sultan déclare la guerre au Directoire. Pour Bonaparte, les batailles décisives doivent se dérouler en Palestine et il envisage de s’emparer de Damas. La traversée du Sinaï est difficile. Puis l’armée quitte l’Afrique pour l’ Asie et s’engage dans la vallée de Gaza, une oasis côtière. Les troupes françaises s’emparent de Gaza le 25 février 1799. Gaza est le débouché maritime des caravanes venues de Pétra. Plusieurs centaines de chrétiens et de Juifs y vivent. La proclamation annonçant la prise de Gaza mêle respect de l’Islam et affirmation des principes révolutionnaires : « Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! Mort aux tyrans ! ». Les troupes françaises quittent Gaza, se dirigent vers le nord et assiègent Jaffa entre mars et mai1799 . Après la prise de Jaffa , de nombreux civils sont massacrés. La peste se propage. L’armée française a fait 2500 prisonniers. Bonaparte estime qu’il a trop peu d’hommes pour les garder et trop peu de nourriture. Après avoir réuni ses officiers, très réticents (seul Berthier proteste ouvertement), Bonaparte décide de les faire exécuter. Puis l’armée quitte Jaffa, s’empare de Haïfa, mais ne parvient pas à s’emparer de Saint -Jean d’ Acre. L’armée française parvient jusqu’au lac de Tibériade et Nazareth, mais n’entre pas dans Jérusalem. Saint-Jean d’Acre se révélant imprenable, l’armée française lève le siège le 17 mai. Le retour vers ll’Egypte est difficile. L’expédition d’Egypte a donné lieu à d’importants travaux scientifiques. Elle marque aussi l’affaiblissement de l’empire ottoman au profit de souverains comme Méhémet Ali.
Fin du XIXe -XXe siècle
Sciences-Po d’hier à aujourd’hui
Guillaume Perrault consacre un chapitre à la fondation de l’Ecole libre des sciences politiques par Emile Boutmy ( 1836- 1906) à l’automne de 1871. La création de l’école répond à un double objectif qui reflète bien le climat de l’époque. Le premier est de pouvoir rivaliser avec l’Université allemande ; beaucoup de contemporains attribuent la défaite de 1870 à la faiblesse de la formation des élites françaises. La seconde préoccupation de Boutmy est sociale : le suffrage universel remet en cause les privilèges de la naissance et de la fortune. Les « élites » ne peuvent donc continuer à diriger que si elles apparaissent comme les plus capables de gouverner. A l’origine l’Ecole est une école privée ; elle a la forme d’une société par actions. Elle est soutenue par les élites économiques et administratives de l’époque. Boutmy est lui-même dreyfusard. Au début du XXème siècle, l’Ecole accueille environ 700 élèves (les frais de scolarité sont élevés) dont un certain nombre d’étudiants étrangers. Les femmes ne peuvent devenir élèves jusqu’en 1919. Elle compte plusieurs sections : administrative, diplomatique, puis économique et financière. De nombreux élèves sont devenus célèbres : Marcel Proust, puis dans les années 1930, Léo Ferré (qui l’eût cru ?) , L’empereur du Tonkin et d’ Annam Bao Dai le futur président tunisien Habib Bourguiba, François Mitterrand. En 1945 Sciences- Po, devenue l’ Institut d’études politiques (IEP), chargé de l’enseignement est nationalisée On lui adjoint la Fondation nationale des Sciences politiques régie par le droit privé est chargée de la gestion de l’ IEP . C’est elle qui choisit les directeurs. Sept autres IEP sont progressivement créés à Strasbourg , Grenoble , Bordeaux , Aix-en – Provence. Dans les années 1960, l’IEP comte environ 4 000 élèves dont 25% de femmes. Directeur de 1947 à 1979, Jacques Chapsal mène une politique assez classique . Il recrute de nombreux historiens comme René Rémond, Pierre Milza Serge Berstein ou Michel Winock Le successeur de Jacques Chapsal, Alain Lancelot , y intègre des historiens comme Marc Lazar ou Jean- François Sirinelli. Guillaume Perrault dresse un bilan nuancé de l’action de Richard Descoings, de sa nomination en 1996, jusqu’à son décès en 2012. La scolarité passe de trois à cinq ans pour s’aligner sur les normes de l’UE. Des accords avec certains lycées, appelés conventions d’éducation prioritaire constituent une nouvelle voie d’admission, non sur concours, mais sur dossier et lors d’un entretien oral. Descoings noue des liens avec les universités américaines Les effectifs atteignent 15000 étudiants dont la moitié d’étudiants étrangers. Certains critiquent sa gestion autocratique et son goût pour la célébrité médiatique.
L’antisémitisme de gauche
Au XIXe siècle, l’entrée des Juifs dans le monde moderne et la réussite de certains banquiers juifs provoque le développement de l’antisémitisme de gauche. Un certain nombre de théoriciens socialistes français (Leroux, Proudhon ) dénoncent les liens supposés entre les juifs et l’argent. Karl Marx, dans un ouvrage de jeunesse ( 1843) A propos de la question juive, accuse les Etats allemands, d’avoir par une législation discriminatoir emprisonné les Juifs dans des métiers d’argent ; il en déduit que la représentation du Juif est indéfectiblement lié à la propriété et à l’argent et il conclut que l’émancipation des Juifs passe par la sortie du judaisme. Au moment de l’Affaire Dreyfus, un socialiste proche de Jules Guesde, Maurice Charnay, comprend que le procès de 1894 est peut-être une machination ,mais de nombreux socialistes croient dans la culpabilité de Dreyfus. De nombreux écrits de Jaurès jusqu’en 1898 sont accablants. Le fait que Dreyfus ait été condamné au bagne et non à la peine de mort est pour lui le signe du « déploiement de la puissance juive » Il voit les juifs d’Algérie comme des accapareurs. Le Figaro ayant publié un article de Zola « Pour les juifs » et ayant adopté une attitude dreyfusarde, au moins jusqu’ à la fin de 1897, Jaurès y voit la preuve de l’influence du « syndicat » juif. Le 20 janvier 1898, après la publication de J’accuse il signe avec Guesde et Vaillant un Manifeste qui appelle le prolétariat à ne pas prendre parti dans une guerre civile bourgeoise et renvoie dos à dos « cléricaux bourgeois » et « capitalistes juifs ». Le manifeste conclut cependant que le prolétariat « ne doit pas être insensible à l’ injustice ». Cependant, à partir du deuxième semestre de 1898, Jaurès est convaincu de l’erreur judiciaire et devient un défenseur ardent du capitaine. Il publie « Les preuves » et écrit cette phrase célèbre à propos du capitaine : « Il n’est plus ni un officier, ni un bourgeois : il est dépouillé, par l’excès même du malheur de tout caractère de classe «. Dans les années 1920 l’antisémitisme recule, mais ressurgit dans les années 1930 Certains socialistes pacifistes soupçonnent les Français juifs de pousser à la guerre avec l’Allemagne. Après la signature du pacte germano-soviétique et la déclaration de guerre, le dirigeant communiste Maurice Thorez attaque violemment Léon Blum. Après la guerre, sans disparaître entièrement, l’antisémitisme de gauche est peu important . Il ressurgit brutalement au moment de la guerre des Six- jours (1967) Le secrétaire général de la CGT, Benoît Frachon, voit dans la guerre une guerre dont les Rothschild seraient les bénéficiaires.
Un portrait de Georges Pompidou
Guillaume Perrault dresse un portrait très empathique de Georges Pompidou. Un certain nombre de traits sont bien connus : le symbole éclatant de la méritocratie républicaine, la rencontre avec le général de Gaulle, le contraste entre le conservatisme politique et le goût pour la modernité, la volonté de développer l’industrialisation du pays, le courage face à la maladie. D’autres aspects peuvent être soulignés. En 1962, il obtient la grâce du général Jouhaud, l’un des putschistes d’avril 1961 que de Gaulle voulait faire fusiller. En 1962, après des mois de massacres des harkis, il prend sur lui de demander le transfert des survivants en métropole. En mai 1968, il fait preuve d’un grand sang- froid, cherche à nouer des contacts avec la CGT, contacts qui conduiront à la signature des accords de Grenelle. On mesure aussi à quel point la crainte d’une insurrection communiste, à laquelle cependant Pompidou ne croyait pas vraiment, était importante dans les milieux dirigeants. Le 14 mai 1968 il déclare à l’Assemblée que ceux qui se disent révolutionnaires « ne devraient pas s’étonner que la société et l’Etat qu’ils prétendent détruire cherchent à se défendre ». Une fois élu à la Présidence de la République en 1969, il poursuit la politique d’industrialisation et de modernisation du pays. Très discutable en revanche, la grâce partielle accordée à l’ancien milicien Paul Touvier au nom de l’unité du pays. En même temps Pompidou pense que l’ Etat, la société sont menacés par ce que l’on pourrait appeler le « gauchisme sociétal » : affaiblissement de l’autorité de l’ Etat, crise de la famille, individualisme . Il y voit une profonde crise de civilisation qui ne serait comparable selon lui qu’à la crise de la fin du Moyen-Age. Un contraste donc entre la politique de modernisation et le pessimisme et le conservatisme en matière politique et sociale.