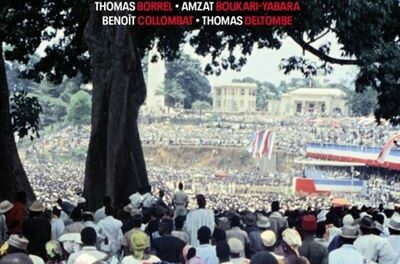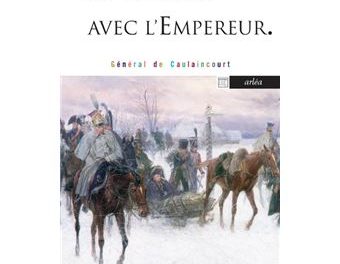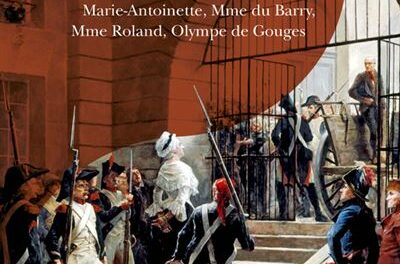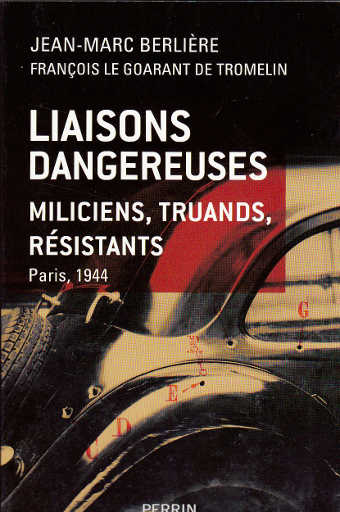
Jean-Marc Berlière, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne, est un spécialiste de la France sous l’Occupation et de l’histoire de la police. Parmi ses principales publications : La naissance de la police moderne (Perrin, coll. « Tempus », 2011), Policiers français sous l’Occupation (Perrin, coll. « Tempus », 2009, édition revue, corrigée et augmentée de Les policiers français sous l’Occupation Perrin, 2001.), Liquider les traîtres. La face cachée du PCF clandestin, 1941-1943 (avec Frank Liaigre), Robert Laffont, 2007, Le sang des communistes. Les bataillons de la jeunesse dans la lutte armée, automne 1941 (avec Frank Liaigre), Fayard, 2004. Et, plus récemment, Ainsi finissent les salauds. Séquestrations et exécutions clandestines dans Paris libéré (avec Franck Liaigre), Robert Laffont, 2012.
François Le Goarant de Tromelin consacre ses recherches à la Milice et aux mouvements collaborationnistes.
Approcher la vérité, même si elle dérange, par la recherche dans les archives et la critique des documents
Jean Marc Berlière a fréquemment critiqué ce qu’il estime être une véritable « désertion des archives publiques ou autres par des historiens professionnels qui préfèrent travailler sur des concepts plutôt que sur des sources alors qu’elles se multiplient ». Il a la conviction forte que « la recherche obstinée et sans concession de la vérité doit être la première des tâches des historiens » et que l’histoire « est une quête -toujours remise en cause- incessante, obstinée, sans a priori, de la vérité ». Mais l’histoire « est d’abord une éthique » et la quête de la vérité aboutit presque toujours à « remettre en cause des légendes bien établies, des certitudes forgées sur des preuves des témoignages jamais remis en doute parce qu’ils participent à un degré ou un autre du « sacré » et de la foi. » L’histoire est enfin, c’est le troisième élément de la définition qu’il propose dans sa conclusion, « une technique, une « science humaine » fondée sur une méthode éprouvée -critique interne, critique externe, croisement systématique de toutes les sources, documents, témoignages -… au risque, dès lors que les vérités mises au jour ne correspondent pas à la vulgate, aux romans familiaux et nationaux, aux pieuses légendes répétées depuis des lustres, de susciter ire et incompréhension, insultes, voire menaces. » En nous livrant ici une leçon de méthode, Jean Marc Berlière fait allusion aux critiques dont il est souvent l’objet. Il reproche aux historiens professionnels les plus réputés, en particulier ceux qui ont dirigé le Dictionnaire historique de la Résistance, de rester soumis à leurs a priori idéologiques, de ne pas vouloir voir ou même de ne pas vouloir chercher des vérités qui dérangent, de reprendre de livre en livre des versions consensuelles et compatibles avec une vision sacralisée et mythifiée de la résistance. Silence ou complaisance seraient ainsi les obstacles aux progrès historiographiques.
Un ouvrage dense, étonnant, dérangeant
Forts de cette éthique, adeptes d’une méthode rigoureuse de critique des documents qu’ils exercent souvent explicitement pour le lecteur, Jean Marc Berlière et son collègue mettent en évidence dans cet ouvrage des vérités qui sont effectivement troublantes et dérangeantes. Au fil des pages se « dessine une réalité où toutes les frontières sont brouillées, où apparaissent de surprenantes compromissions, d’impudents retournements de veste et de choquantes complicités » entre miliciens, truands et quelques résistants. La construction de l’ouvrage est astucieuse, plus proche en apparence du roman policier que de la thèse universitaire. Les chapitres s’imbriquent et se complètent, éclairant progressivement une réalité de plus en plus complexe, dévoilant des personnages qui jouent souvent un double ou triple jeu. Il s’agit cependant d’un ouvrage des plus sérieux, au contenu très dense, qui exige du lecteur une réelle et constante concentration s’il veut intégrer l’ensemble des situations, des acteurs et des données. Les auteurs ont appuyé en permanence leur démonstration sur les sources primaires, ce qui les conduit à multiplier les notes de bas de page souvent très longues et complexes qui conduisent le lecteur sur des chemins adjacents. Au texte principal, qui inclut ces nombreuses et longues notes (275 pages), s’ajoutent 60 pages de notices biographiques d’une extrême précision, 20 pages de notes de fin d’ouvrage, une liste des sources, des références filmographiques et bibliographique, ainsi qu’un index.
Le point de départ (chapitre 1) est le récit de l’arrestation d’un homme alors connu sous son pseudonyme de Mansuy dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, le 25 août 1944, alors qu’y arrive le général de Gaulle. Cet homme est arrêté par des résistants du 2e Bureau FFI qui croient avoir reconnu en lui un milicien. Il est venu à l’Hôtel de Ville avec un groupe de FFI récemment constitué et il est porteur d’une lettre émanant d’un commandant FFI, affirmant qu’il fait partie de la résistance et lui a rendu de nombreux services, par exemple en entrant sur ordre à la Milice. Les responsables FFI qui l’arrêtent l’exécutent rapidement et font disparaître le corps, puis donnent une version mensongère de l’affaire. Qui était-il réellement et que venait-il faire à l’Hôtel de Ville ? Que craignait-on qu’il révéla ? Le chapitre 2 dresse le portrait de cet homme qui est un truand, un tueur, un milicien, un agent allemand, l’assassin de Georges Mandel, mais aussi un FFI qui prétend avoir été un agent du 2e Bureau infiltré dans la Milice. On apprendra par la suite qu’il est aussi l’un des assassins de l’un des membres du commando de résistants qui a exécuté Philippe Henriot. À partir de là les auteurs nous conduisent dans une triple direction : l’assassinat de Georges Mandel (chapitres 3 et 4), l’exécution de Philippe Henriot (chapitre 5) et enfin l’étude des composantes et des activités troubles de curieux groupes de résistants FFI (chapitres 6 et 7). À mesure qu’il met en évidence la complexité des personnages (truands et miliciens, truands et résistants, miliciens, truands et résistants se connaissant et fréquentant les mêmes bars et hôtels louches) et des activités (truands devenus miliciens pratiquant l’escroquerie, le vol, le chantage, le recel mais aussi truands devenus résistants ayant gardé leurs habitudes, mais encore authentiques résistants ayant adopté des méthodes de truands), les auteurs démontent les étapes de la fabrication des héros et des légendes, en opposant rigoureusement les réalités dévoilées par la critique des documents et les versions inscrites sur les attestations de résistance, ou aujourd’hui sur certains sites Internet souvent créés par la famille de ces « résistants ».
L’assassinat de Georges Mandel : le tueur
Ce « Mansuy » s’appelait en réalité Maurice Solnlen. Il a fait dès ses 20 ans « des débuts modestes dans la délinquance : escroc médiocre, proxénète bas de gamme ». L’Occupation venue, il « comprend vite les opportunités qu’offre la situation à des voyous entreprenants et sans scrupules ». Il se lance dans divers trafics favorisés par la pénurie et le marché noir, entre en relation avec des groupuscules collaborationnistes et les services allemands, et se spécialise dans les affaires de « faux policiers », « s’emparant, sous la menace d’arrestation, de torture, de déportation, de butins parfois considérables sous la forme de bijoux, valeurs, lingots et pièces d’or, pierres précieuses, tableaux, objets d’art, tapis, mobilier, vins et liqueurs, chez des proies choisies pour leur aisance et leur fragilité, chez lesquelles ils débarquent à l’improviste, de façon spectaculaire et violente ». Il devient riche, multiplie les relations, et se fait aussi une réputation de tueur discret et compétent, ainsi que de tortionnaire. Il intègre la Milice révolutionnaire française, organisation collaborationniste de Pierre Costantini et travaille, au moins occasionnellement, pour le SD allemand. Il franchit encore un pas en intégrant le Deuxième service de la Milice de Darnand, service qui travaille avec des brigades de police française spécialisées et aussi avec des services allemands. On y trouve des policiers révoqués, des délinquants, mais aussi d’anciens adhérents des classes moyennes à des formations d’extrême droite, avant-guerre. Ils ont tous étés attirés à la Milice pour des raisons moins idéologiques qu’intéressées : voiture, laissez-passer, armes, impunité, bénéfices, les Juifs constituant des proies rêvées et sans risque. Il est resté cinq à six mois dans ce service de la Milice et y a été mêlé à plusieurs assassinats. Au printemps 1944, il prépare sa reconversion et recherche des contacts avec la résistance et se donne désormais le rôle d’un résistant qui aurait sur ordre du 2e Bureau (lequel ?) pénétré la Milice. Dans cette nouvelle fonction il exécute ou fait exécuter quelques miliciens et informateurs, sauve quelques Juifs et résistants et fournit des armes à la veille de l’insurrection parisienne. Il prétendra aussi avoir sciemment favorisé l’action du commando résistant chargé d’exécuter Philippe Henriot.
L’assassinat de Georges Mandel : les faits
Le 3 juillet 1944, Knochen a reçu, en l’absence d’Oberg un télégramme du RSHA de Berlin annonçant la prochaine livraison aux autorités françaises de MM. Mandel, Blum et Reynaud, internés en Allemagne. Il en informe Knipping, délégué en zone nord de Darnand, et laisse entendre que le gouvernement français pourrait ainsi exercer à leur encontre des représailles en réponse aux attentats commis par la résistance, notamment contre Philippe Henriot. Knipping se met alors en rapport avec Darnand et Laval qui ont déjà été informés par Abetz, l’ambassadeur allemand, et ont vivement protesté contre une remise qu’ils ne souhaitent pas et une politique d’otages qu’ils réprouvent. En début d’après-midi Mandel arrive à la prison de la Santé et Knipping prend la décision de le transférer à Vichy dans un centre de séjour surveillé et géré par la Milice qui assurera le transfert. Quelques inspecteurs du Deuxième service et du service de sécurité de la Milice sont désignés pour cette mission, parmi eux Mansuy.
À plusieurs reprises les auteurs insistent sur le respect scrupuleux de la méthode historique : « Le récit des événements que nous livrons ci-dessous a été établi à partir du dépouillement scrupuleux et méthodique de toutes les sources d’archives disponibles- dont beaucoup sont inédites ou ont été négligées- qui ont été systématiquement analysées, critiquées, croisées, comparées, pour en extraire des bribes de vérité disséminées parmi d’innombrables contradictions, oublis, élisions, mensonges, imprécisions, affabulations… » Vers 18h, le 7 juillet 1944, deux voitures de miliciens quittent Paris, avec Georges Mandel à bord de l’une d’elles, conduite par Mansuy. Peu après Fontainebleau, des à-coups amènent Mansuy à s’arrêter pour « vérifier la carburation ». « À l’évidence, Mansuy à simulé un problème de carburation ». La seconde voiture s’arrête également. « Mansuy soulève le capot du côté gauche du moteur, les passagers profitent de cet arrêt improvisé pour se dégourdir les jambes (…) Prenant vraisemblablement appui sur le toit de l’automobile, Mansuy tire à l’aide d’un 9 mm « Parabellum » sur Mandel qui lui présente alors son profil droit à une distance de huit-neuf mètres, 10 m au maximum (…) Mandel mort, allongé sur le ventre, est alors rejoint par Mansuy, qui, ayant fait le tour de la voiture, enjambe le corps et vide le reste de son chargeur en lui tirant (…) cinq balles dans le dos (…) Mansuy place un nouveau chargeur dans son automatique et tire sur l’arrière droit de la voiture. » L’auteur démontre la totale surprise des membres du groupe qui n’étaient donc pas informés de la mission de Mansuy, pas plus que ne l’était Knipping, chef de la Milice en zone nord. Ce qui pose la question de l’origine de l’ordre de tuer Mandel.
L’assassinat de Georges Mandel : les responsables
Ce ne sont pas les responsables du gouvernement de Vichy qui ont donné l’ordre. Lorsque les autorités françaises sont mises devant le fait accompli du retour en France de Mandel, Laval, qui a compris la manœuvre, est furieux, et réussit en partie à parer cette manipulation en faisant prévenir le comité d’Alger. Dès qu’il apprit la nouvelle de la mort, il ne fut pas dupe de la version officielle qui prétendait qu’elle était la conséquence d’une attaque de « terroristes », et il ordonna une enquête.
« La thèse couramment admise par les juges de la Libération, les historiens, la mémoire sociale et les auteurs de tous les livres abordant la question concluent à la culpabilité de la Milice et notamment à celle de Knipping. » La Milice souhaitait la mort de Mandel et c’est un milicien qui l’a assassiné. Mais Darnand n’avait pas été mis au courant. Les auteurs réfutent l’hypothèse d’une décision prise au sein de l’état-major de la Milice par des proches de Darnand, miliciens et responsables de partis collaborationnistes, qui auraient été en accord avec des membres du Sipo-SD et qui auraient doublé Darnand. S’appuyant entre autres sur la relecture et l’exégèse hypercritique d’un document connu, ils proposent une autre hypothèse : les vrais commanditaires seraient les hommes du Sipo-SD parisien obéissant aux instructions directes du RSHA et des plus hautes autorités du Reich, qui auraient manipulé et guidé le bras de l’assassin, qui était l’un des leurs introduit dans la Milice.
L’exécution de Philippe Henriot
Ses talents d’orateur et l’audience de ses éditoriaux radiophoniques quotidiens faisaient de Philippe Henriot un véritable danger pour la résistance. Son exécution fut décidée au plus haut niveau et confiée à un groupe de résistants dirigés par Charles Gonard dont le pseudonyme était Morlot, un authentique résistant. Un indicateur signala que Philippe Henriot allait passer la nuit du 27 au 28 juin 1944 dans un appartement qu’il avait aménagé à l’intérieur du ministère de l’information dont il était le titulaire. Le commando s’y introduisit, l’exécuta, puis disparut. Le soir même, à l’heure habituelle de l’éditorial de Philippe Henriot sur les postes français, les auditeurs entendirent Pierre Laval annoncer la nouvelle de la mort du tribun. La protection du ministre incombait non à la préfecture de police mais à la Milice. L’enquête s’intéressa donc à l’emploi du temps de la victime pour essayer de déterminer les possibles informateurs qui avaient pu prévenir le commando de la présence du ministre. Une énorme récompense de 20 millions de francs fut promise, ce qui donna très vite des résultats : la Milice apprit le nom et l’adresse du plus proche collaborateur de Charles Gonard.
C’est ici que l’histoire prend un tour nouveau et dérangeant. Il s’avère en effet que cet authentique résistant, ainsi que d’autres membres du groupe de Charles Gonard avait des activités de voyou et de truand. Il pratiquait le vol et divers trafics qui le mettaient en contact avec des miliciens aux mêmes activités, ce qui permit à ces derniers de lui tendre un piège à la faveur d’un rendez-vous où devait se monter une affaire de trafic d’or. Le résistant fut abattu par le milicien Mansuy. Les auteurs consacrent alors un paragraphe intitulé « la fabrique des héros » à la construction des mythes de la geste résistante. Ils opposent la réalité de ce personnage : trafiquant d’or et meurtrier en même temps qu’adjoint d’un important responsable de la résistance, avec le portrait qui en est fait dans la presse et dans les attestations qui composent son dossier pour l’attribution des titres de résistant. Ils font ensuite une étude du groupe constitué autour de Charles Gonard. Elle démontre « les liens et les collusions, existant entre truands, souteneurs, trafiquants du marché noir naviguant entre résistance et collaboration ». Ce qui les conduit dans un dernier chapitre à présenter d’autres curieux groupes de FFI constitués dans les jours qui précèdent la libération de Paris.
« Malfrats, aigrefins, carambouilleurs, trafiquants notoires, paradant avec des galons FFI après avoir servi l’occupant sans état d’âme. »
Dans le contexte du mois d’août 1944 il est facile de changer de camp et de monter des groupes de résistance. Collaborationnistes et truands se transforment en FFI et changent de cibles : après avoir volé les Juifs et autres clandestins, ils s’en prennent aux trafiquants du marché noir et autres « collabos », qu’il sera facile de soumettre car ils n’oseront jamais porter plainte. Les auteurs présentent ainsi avec une grande précision et force documents « ce groupement FFI improbable de la rue Alphonse-de-Neuville », vers le 15 août 1944. Le chef en est Toussaint Sinibaldi, « le commandant Toussaint ». Petit truand avant-guerre, « sans le sou en 1940, il est multimillionnaire en 1944 (…) C’est un arriviste forcené, un escroc-né, d’un aplomb déconcertant ». Sa résistance et un « énorme bluff » et sa demande de certificat d’appartenance à la résistance sera refusée en 1946. Il prétendra que son enrichissement était patriotique car il volait les Allemands pour financer la résistance ! L’étude des membres du groupe qu’il a rassemblé et qui se prétend FFI montre qu’il comprenait des miliciens (dont l’assassin de Mandel), des agents allemands du SD (convertis en « Alsaciens»), « de gros trafiquants du marché noir qui ont constitué des fortunes en revendant à peu près n’importe quoi aux Allemands », des proxénètes, quelques petits notables et militaires retraités qui décidèrent vers le 15 août « de sortir d’un attentisme prudent » et auxquels le « commandant Toussaint » accorda immédiatement des grades de lieutenant, de capitaine et même de commandant (avec lesquels ils paradaient à l’Hôtel de Ville le 25 août), enfin quelques « vrais naïfs abusés, mais de bonne foi, en quête d’engagement patriotique tardif », qui crurent avoir trouvé dans le « commandant Toussaint » un résistant de la première heure.
Quand de vrais résistants perdent leurs repères moraux
Après les « vrais malfrats jouant aux résistants », les auteurs s’intéressent à quelques authentiques résistants qui n’eurent « apparemment ni difficulté ni complexe à se transformer en vrais truands pratiquant avec talent le vol, l’escroquerie, le chantage, le racket », durant une période qui se prolongea longtemps après la Libération. L’étude porte sur « le 2e Bureau FFI », en août 1944 et dans les mois suivants. Son chef, le lieutenant-colonel Aron alias « Brunetière » est entré dans la résistance en 1941 et à exercé de hautes responsabilités et réalisé d’importantes actions. Son adjoint, le « commandant Pagès » est entré plus tard dans la résistance mais a exercé de hautes responsabilités au sein des MUR (Mouvements unis de Résistance) puis du MLN (Mouvement de libération nationale). Il était aussi très vraisemblablement un agent soviétique. Les deux hommes et leur groupe sont impliqués dans des affaires de vol, pillage, recel, extorsion de fonds, séquestration, rançon. Au prétexte de confiscation de profits illicites, ils s’appropriaient une partie importante des saisies et pratiquaient violence et torture.
« Les années troubles de l’Occupation et plus particulièrement les semaines de l’été 1944 qui précèdent la Libération mettent à jour une complexité des êtres et des faits, des paradoxes bien éloignés de la saga héroïque qu’on a longtemps, trop longtemps, servie aux Français (…) Dans l’ambiguïté et l’ambivalence qui régnèrent jusqu’à la fin, les lignes ne furent jamais figées et restèrent d’une porosité qui permit des reconversions inattendues, sinon surprenantes (…) Comme il n’était pas question de jeter l’opprobre sur des « résistants », de discréditer et de salir « la Résistance », on expliqua toutes ces dérives, tous ces crimes par la nécessité et les inévitables dérives de l’épuration, du retour à la normalité, et on les a ensevelis sous l’épaisse couverture de la légende dorée d’un pays qui s’était libéré par lui-même et avait gardé dignité et honneur dans les années noires (…) La révolution documentaire que constitue l’ouverture des archives, et notamment celle de « la répression » (polices et justice), permet des études scientifiques qui nuancent largement les mythes entretenus par le silence et l’élision, parfois aussi le mensonge et la complaisance (…) Il est (largement) temps de regarder la vérité en face. »