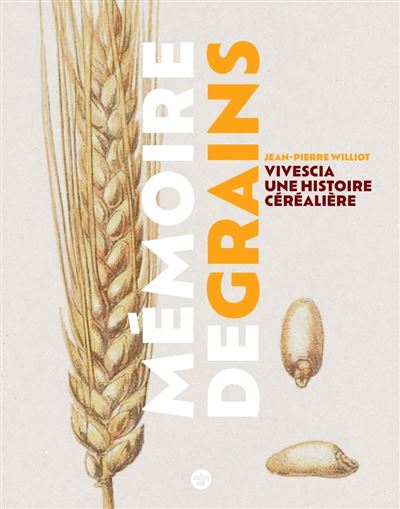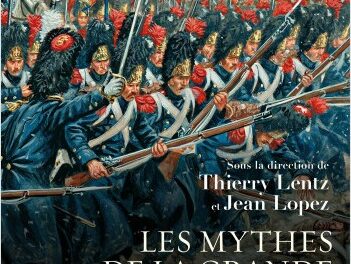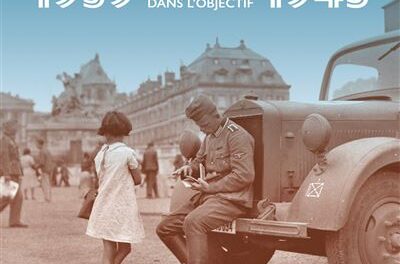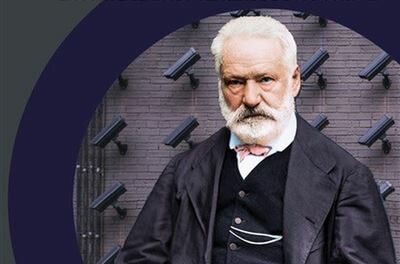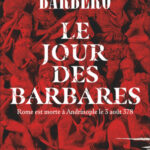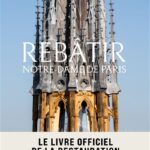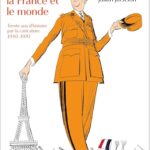Cet ouvrage n’est pas à proprement parler, un ouvrage d’histoire. C’est plus un beau livre en direction des coopérateurs et actionnaires de Vivescia, qui présente l’histoire du groupement coopératif agricole et agroalimentaire. C’est un ouvrage documenté (statistiques, documents iconographiques nombreux) qui retrace une aventure agro-industrielle qui illustre son slogan : Nous prenons soin du grain, du champ à l’assiette.
Produire et transformer les céréales 1890-1938
À la fin du XIXe siècle, la filière agro-industrielle commence à se mettre en place au moment même où les campagnes se vident et qu’on connaît une crise de prix du blé en 1887Il vaut le tiers de la valeur de 1879.L’auteur, Jean-Pierre Williot dresse un rapide tableau de l’agriculture de cette fin du siècle. À la même période, la minoterie évolue. En 1886 c’est la création de l’Association nationale de la meunerie française. On assiste à une concentration de l’activité. L’environ 37 000 moulins en 1896, 7 000 ont déjà fermé au début du XXe siècle du fait des évolutions techniques (meules métalliques, mouture par cylindres) et le développement des moyens de transport entre régions. On voit aussi se développer les recherches sur la valeur industrielle des blés.
L’auteur présente quelques grandes entreprises minotières, les grands moulins et surtout l’entreprise Vilgrain en Champagne dont il retrace l’activité.
L’entre-deux-guerres est marqué par l’essor de la coopération agricole, en Champagne. La période du premier conflit mondial a fortement touché la question de l’approvisionnement et plus encore dans cette région où le mouvement mutualiste et le catholicisme social étaient très présent avant même 1914. C’est ainsi qu’émerge la Providence agricole de la Champagne, dans le contexte de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricole.
Les débuts de la Providence sont marqués par l’influence cléricale. Si le syndicalisme agricole connaît un essor réel, il reste fragile.
Durant la période 1914-1938 la filière blé, farine, pain se réorganise. La coopérative de producteurs de grains entreprend des relations avec les minoteries. Les grands moulins se développent dans toute la France, comme en témoigne l’architecture des nouveaux moulins. Les petits moulins résistent dans certaines régions (Gironde, Nord…)
La création des Grands moulins de Paris consacre l’apparition d’un capitalisme minotier. En Champagne, les moulins Vilgrain se rapprochent du meunier Boussac. Le mouvement de concentration est décrit en détail. L’auteur aborde la question de la qualité très diverse des grains et l’achat en culture, avant récolte, des meilleures variétés, complétés par des importations.
L’articulation entre le prix, la qualité, le marché demeure instable à la fin des années 1920. L’intervention de l’État s’accroît jusqu’à la création en 1936 de l’ONIB, Office national interprofessionnel du blé.
À l’autre bout de la filière il est question de l’évolution de la boulangerie : pétrin mécanique, formation des boulangers, interventions de la meunerie.
La revendication de la modernité agro-alimentaire 1939-1988
Après-guerre, il faut à la fois nourrir les Français, renouer avec la croissance économique et garantir la sécurité alimentaire, voilà un contexte favorable à la modernité, de la moissonneuse-batteuse au laboratoire de panification.
1939-1949, un court chapitre traite des bouleversements en temps de guerre : aléas de l’occupation pour les coopératives champenoises, rationnement et économie administrée, recul de la qualité des farines livrées aux boulangers.
L’immédiat après-guerre est à l’injonction au productivisme agricole entraînant une professionnalisation du mouvement coopératif. La création de la FNSEA et le développement de la JAC (Jeunesse agricole catholique) marquent cette période. Dans le même temps, la population française réclame la fin du rationnement. La réponse vient en partie du développement de la production de produits transformés : pâtes alimentaires, biscuits, un débouché pour la meunerie.
La modernisation est forte entre 1950 et 1969, notamment dans la Champagne « pouilleuse » qui voit à la fois une progression des rendements et des surfaces emblavées. C’est aussi un élan lié à la PAC.
En Champagne, on assiste à des rapprochements au sein du mouvement coopératif avec une évolution vers un contrôle aval de la filière. : la Providence envisage en 1958 la création d’une malterie dans un contexte de progression de la consommation de bière.
Un paragraphe est consacré aux Grands Moulins Vilgrain.
1970-1989, c’est une période de fusion, d’expansion et d’innovations dans les coopératives. Des débouchés non-alimentaires apparaissent (agro-carburants). La croissance de l’agro-industrie est présentée avec la brasserie Malteurop.
L’auteur fait une place au développement des Grands Moulins de Paris avec leur accompagnement croissant des boulangers (concept banette) et les farines grands publics (Francine).
1989-2024 : De la Champagne au monde
Cette fin de XXe siècle commence par la recherche de nouveaux équilibres. Entre 1989 et 2001, c’est d’abord la mise en chantier d’un nouvel équipement des Grands Moulins de Paris, sous la houlette de leur nouveau patron, Martin Bouygues qui a pris le contrôle de l’entreprise grâce aux querelles de la famille Vilgrain, dans un contexte difficile entre mondialisation, mise en avant du développement durable et attente des consommateurs. La production de pâte à pain surgelée, prête à cuire, se poursuit parallèlement au développement de la boulangerie industrielle.
Dans le domaine agricole, la refonte de la PAC en 1992 vise à résorber les surplus. On assiste à une intensification des recherches sur les semences, en coopération avec la meunerie. La pression des consommateurs limite la possibilité des OGM.
En matière de boulangerie, la réglementation évolue pour une différenciation marquée entre les boulangerie artisanale et industrielle.
La grande meunerie est soumise à une financiarisation croissante qui pèse sur le mouvement coopératif. Entre 2002 et 2012, on assiste à des fusions (Champagne Céréales et Nouricia) pour répondre aux évolutions du monde agricole et à la nécessaire prose en compte de l’environnement.
L’auteur montre la stratégie toujours plus marquée de développement à l’international (Malteurop, Delifrance), tant pour le commerce des grains que pour la transformation, resserrant les liens entre céréaliers et meuniers.
La concentration se poursuit après 2012, avec la création du groupement coopératif agricole et agroalimentaire Vivescia dans un contexte difficile : annonce de réduction des primes PAC/ha et de turbulences géopolitiques qui affectent fortement le cours des céréales.
Cet ouvrage qui, en particulier dans sa dernière partie, est un texte promotionnel, clairement assumé dans la postface de Christoph Büren, PDG de Vivescia, peut néanmoins intéresser les enseignants, car il offre de nombreuses données statistiques, des exemples précis et de très nombreux documents iconographiques.