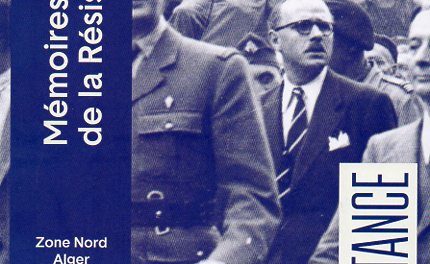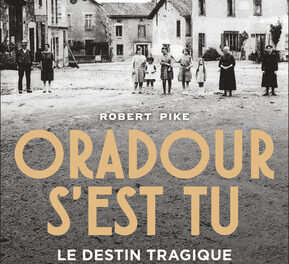L’enseignement scolaire de l’histoire ne s’intéresse qu’à des objets relatifs à un passé souvent très éloignés dans le temps. Aborder les événements liés aux entreprises terroristes comme le 11 septembre 2001 apparaît déjà un exploit, alors que la plupart des élèves à qui nous nous adressons n’étaient même pas nés à ce moment-là. Il n’empêche que les professeurs de notre discipline ont à s’imprégner de l’actualité, ne serait-ce que parce que ses racines tiennent précisément à l’histoire : par nature, il n’y a pas de phénomène surgissant ex abrupto.
Pour ignorer ce principe de base, faute de culture historique, par manque d’intérêt ou tout simplement de tempsOn n’ignore pas les conditions déplorables de travail de l’immense majorité des journalistes et des pigistes, masqués par la poignée d’éditorialistes omniprésents et omniscients (ce qu’ils croient)., trop de journalistes développent une analyse trop superficielle sur les faits qu’ils rapportent. La « crise » dite des « gilets jaunes » (avec ou sans les guillemets, avec ou sans majuscules initiales) en est l’illustration la plus révélatrice du moment. Sa complexité mérite mieux que les amalgames et raccourcis que les médias dominants n’ont cessé de colporter, faute d’avoir les moyens de la saisir. Pour autant, le phénomène n’est pas encore achevé que la recherche scientifique s’y intéresse déjà, avec les infinies réserves que la faible distance chronologique à l’objet étudié imposent en pareil cas, et parce qu’il n’a fini de se transformer et de produire toutes ses conséquences. C’est précisément le but que s’est assigné AOC, depuis un an, en soumettant l’actualité à des chercheurs sans attendre : « il n’y a pas un temps pour le journalisme et un temps pour la recherche », comme le rappelle Sylvain Bourmeau (p. 9).
Ici, ce sont vingt-quatre scientifiques qui ont été sollicités pour délivrer leur analyseChacune de ces analyses est à chaque fois datée, ce qui prévient l’étonnement de ne pas voir tel ou tel fait, qui, s’étant produit ultérieurement, n’aura donc pas pu être pris en compte. On regrette cependant l’absence de sources qui permettraient d’aller plus loin. On se référera toutefois aux principaux travaux des auteurs que l’on jugera les plus intéressants., qu’ils soient sociologues, philosophes, etc., et bien sûr historiens ou géographes. La richesse de leur production ne peut être restituée en quelques lignes : on ne peut qu’engager à lire les articles, d’autant qu’ils sont assez courts (six à huit pages, en général), mais très bien informés et très accessibles. On se contentera de donner quelques éléments très (trop) synthétiques qui viennent en contrepoint de ce que la presse a cru voirLire en particulier Yves Citton, « Abécédaire de quelques idées reçues sur les « gilets jaunes » » (p. 37 et suiv.)..
On oppose souvent les espaces ruraux, supposés pauvres, aux espaces urbains, qui concentrent population et richesses. Or, les deux -tiers des ménages les plus pauvres vivent dans les aires urbaines. De plus, les nombreuses interdépendances territoriales ont été révélées par le mouvement qui s’est développé depuis novembre, grâce à la voiture rendue nécessaire pour pouvoir accéder aux différents espaces. À ce compte, on estime généralement que ce sont les habitants des couronnes périurbains qui ont fourni les premiers contingents des « gilets jaunes ». De fait, la périurbanisationVoir la contribution de Michel Lussault, « La condition périurbaine » (p.171 et suiv.). a entraîné un allongement des distances entre résidence et lieux de travail et de consommation, restés en ville, encouragée par des municipalités soucieuses de développement (démographique et économique). Or, ce schéma simpliste ignore le fait que les dynamiques qui sont à l’origine des emplois est plus important dans les espaces périurbains que les centres des villes. Au contraire, ces espaces sont perçus négativement : on met en avant les contraintesOn lira notamment la contribution du géographe Samuel Dupraz, « La France contrainte des « gilets jaunes » » (p. 75 et suiv.). (qui concernent notamment les transports), l’inadéquation avec les impératifs environnementaux, sans parler de l’uniformisation des paysages, rongés par des lotissements de pavillons individuelsMichel Lussault rappelle la couverture du magazine Télérama avait consacré à « La France moche » en février 2010 (p. 178).. Cette perception conduit au sentiment d’espaces périurbains qui seraient abandonnés, par rapport aux centres des villes, bien mieux pourvus en transports en commun modernes (tramways…) et en services de toute nature.
La relation médiatique fait apparaître que le mouvement est porté par les couches inférieures des classes moyennes et les classes populaires. Il s’agit plus précisément de membres de professions intermédiaires, dont, pourtant, le revenu et le pouvoir d’achat sont relativement stables, sans atteindre une marge de confort suffisante pour les protéger en cas de difficultés conjoncturelles. Mais cette sensibilité crée un sentiment d’injustice au regard des efforts exigés par les politiques néo-libérales, que ces catégories sociales supporteraient essentiellement, et celui d’une érosion du pouvoir d’achat, révélé par les hausses ponctuelles du prix des carburants (en oubliant les baisses). Pour autant, les « gilets jaunes » tendent à se distinguer des « assistés », bénéficiaires des aides sociales, tout en exigeant une meilleure distribution des richesses. On retrouve ici l’un des effets du discours libéral qui vise à un émiettement de la société en une somme d’individus, responsables de leur destin et de leurs conditions sociales : être pauvre serait ainsi le résultat d’une volonté personnelle (ou plutôt un manque de volonté), voire même d’un désir de vivre en parasite aux dépends des autres.
D’autres contributions s’attachent aux références historiques brandies par les « gilets jaunes », notamment la Révolution française (d’une façon indistincte)Guillaume Mazeau, « Les « gilets jaunes » et la Révolution française : quand le peuple reprend l’histoire » (p. 107).. Mais on lira avec autant d’intérêt les articles portant sur l’analyse politique du mouvement (abusivement assimilé à l’extrême droite ou à l’extrême gauche), sur la perception du pouvoir exécutif et des actions engagées, sur celle du pouvoir et des élites par les « gilets jaunes », etc. Une mention particulière doit cependant être accordée à la contribution de Bruno Latour, qui place ce mouvement dans une perspective dépassant le cadre national, à savoir celle de la nécessaire transition écologiqueBruno Latour, « Du bon usage de la consultation nationale » (p. 189).. Il montre en effet que le mouvement est l’occasion d’éclairer en quoi consiste cette transition : pour produire quelle civilisation ? À ses yeux, il révèle l’incohérence entre d’une part l’état réel de la planète et, d’autre part, les modes de vie et l’idée de progrès qui persistent à être promus. Or, qui s’en remettre ? L’État est impuissant, pris dans les logiques de développement territorial qu’il a construites. Pour Bruno Latour, il faut s’inspirer de l’exemple de ceux qui ont déjà opté pour un mode de vie tout à fait alternatif, reposant sur une autre vision du territoire, qui dépasse complètement le maillage administratif actuel, réellement utilisé par les citoyens. Ce sont eux seuls qui sont en mesure d’évaluer leurs propres besoins, d’estimer sur quelles ressources ils peuvent compter, et de faire le tri entre leurs souhaits et ce qui est possible. S’il doit y avoir une consultation nationale, elle ne doit pas être une injonction étatique. Elle doit reposer au contraire sur des groupements (militants, associations, scientifiques, etc.), dont la légitimité ne peut être mise en doute, dont le travail de réflexion doit être soutenu. Le but est de dresser une « cartographie des controverses ».
On n’oubliera pas, enfin, la nouvelle d’Éric Chauvier (« Bikini rouge sur fond jaune », p. 195) qui retrace la trajectoire d’une fille sur une trentaine d’années, jusqu’à un rond-point, en décembre 2018.

![AOC [Analyse Opinion Critique], cahier n° 1, « « Gilets jaunes » : hypothèses sur un mouvement »](https://clio-cr.clionautes.org/wp-content/uploads/cliotheque/2019/02/gilets-opt.jpg)