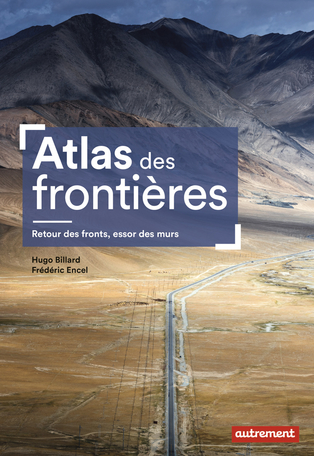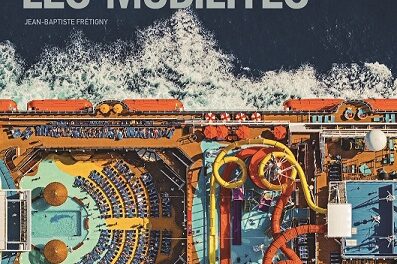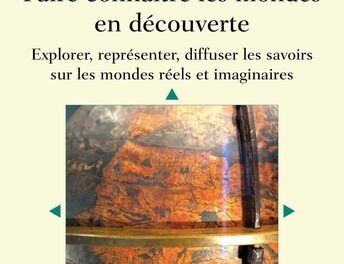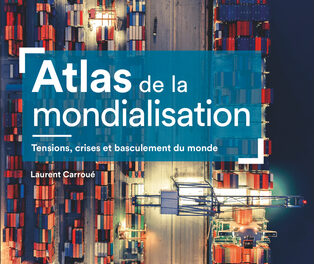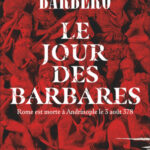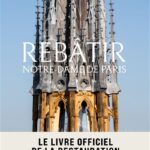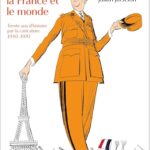Espaces maritimes, Chine ou encore Mexique-Etats-Unis : où que l’on se tourne sur la planète, la question des frontières apparait centrale. C’est donc un sujet aux multiples facettes pour lequel il est fondamental d’avoir des mises au point claires. Hugo Billard, directeur notamment de l’ouvrage « Dictionnaire des prépas », et Frédéric Encel, docteur en géopolitique et fondateur entre autres des Rencontres internationales géopolitiques de Trouville-sur-Mer, empoignent le sujet.
Le sujet des frontières
Les frontières « incarnent des limites spatiales établies par des pouvoirs politiques ou religieux en place ». Les frontières interétatiques connaissent deux grandes tendances récentes : leur multiplication et leur durcissement. Dès l’introduction, les auteurs insistent bien sur le fait qu’il s’agit de conventions et qu’elles peuvent être aussi socio-économiques. Dans ce domaine, le pragmatisme prévaut souvent dans les rapports de force entre puissances. L’ouvrage est composé de cinq entrées et, comme toujours dans la collection des Atlas Autrement, la qualité de la cartographie et la variété des exemples proposés sont une ressource précieuse pour l’enseignant pour la spécialité HGGSP, que ce soit en 1ère ou Terminale. Un rapide lexique et une bibliographie sont proposés en fin d’ouvrage.
Construire et hériter
Cette première partie est historique et envisage la frontière comme « expression paysagère d’un rapport de force et un reflet des soubresauts du monde ». Les auteurs abordent plusieurs exemples dont celui de l’empire romain et du limes, qui resta mouvant. La double page qui lui est consacrée fournit des documents à trois échelles et insiste aussi sur le grand nombre d’adaptations du procédé. Finalement, la frontière fut plus souvent symbolique que physique. On se dirige ensuite en Chine pour mesurer que la construction de la muraille fut une oeuvre de longue haleine puis on revient en Europe pour insister sur l’importance des traités de Westphalie en 1648 qui marquèrent la naissance des Etats modernes. De nombreux aspects pourront servir en cours, que ce soit la mise au point sur la conférence de Berlin, ou encore sur le conflit en Corée. Il faut aussi se souvenir que 30 % des frontières politiques du continent européen furent établies après 1989.
(Se) Représenter
« La représentation est une illusion : elle trompe par essence ». Cette phrase liminaire à cette partie montre bien une nouvelle facette des enjeux. Hugo Billard consacre une double page à la bataille des cartes, « des portulans aux fake maps ». Parmi les autres cas proposés, une approche sur le pré carré, Israël et ses voisins, avec un document sur les prétentions maximalistes d’Israël et de la Palestine. Le mur américano-mexicain, long de 3145 kilomètres, objet de tant de débats, est replacé dans son contexte avec notamment un schéma très éclairant sur « le système des maquiladoras ».
Gérer les discontinuités
Les frontières ne font pas que séparer, elles créent et transforment les territoires. Elles suscitent également un imaginaire politique et culturel. La partie commence par une approche des hyper-lieux de la frontière, comme les aéroports ou les ambassades. Atlanta reste l’aéroport le plus fréquenté au monde avec 110 millions de passagers devant Pékin. Au niveau des ambassades, chaque pays en entretient en moyenne 120, mais la Chine en affiche 276 juste devant les Etats-Unis et la France. Si on examine la question des villes, trois processus sont clairement à l’oeuvre : la ségrégation socio-spatiale, la gentrification et la centralisation par grappes. Les auteurs développent ensuite le cas des villes-frontières comme Jérusalem ou Nicosie, ou des îles-frontières comme le Timor. La frontière peut être également un sas comme à Ceuta ou Melilla.
Affirmer et réguler
« L’accélération des transports… et l’internationalisation des échanges commerciaux ont amené à une régulation des normes de transport. » Une gouvernance a défini en partie les frontières, qu’elles soient politiques, économiques, technologiques ou encore numériques ou cyberspatiales. Dans ce dernier cas, il faut savoir que ces frontières sont régies par la Convention sur la cybercriminalité ratifiée par 65 Etats en 2020 et dont les modèles juridiques étaient en cours d’adaptation dans 106 autres. Frédéric Encel revient sur les frontières maritimes et propose un tableau des pays qui disposent des vingt plus grandes ZEE. Pour le programme de Terminale d’HGGSP, plusieurs pages éclairent la question du contrôle des airs et de l’espace. En 2018, 1300 compagnies aériennes ont fait voler 4 milliards de passagers en chiffres cumulés. Cyberespace, darknet et darkweb font aussi l’objet d’une mise au point. En 2020, serveurs, ordinateurs et objets connectés consomment entre 8 et 20 % de l’énergie mondiale. La partie évoque enfin les eurorégions et pose la question des frontières de la Chine.
Vivre et avoir vécu
Dans cette dernière partie, les auteurs reviennent sur le fait que l’histoire et la mémoire s’incarnent dans les frontières. Une double page traite de la RDA où on constate que le mur économique est persistant et où on constate surtout une accentuation de la frontière politique. Die Linke puis l’AFD réalisent leurs meilleurs scores dans la partie la plus pauvre du pays réunifié. Parmi les autres situations abordées, il y a celle des fronts avec le cas du Sahara occidental ou du Golan. Sur les aspects d’identité, Hugo Billard revient sur le cas irlandais tandis que d’autres entrées se focalisent sur la question des migrants en Méditerranée et, évidemment, sur la pandémie. Sur un milliard de doses produites, 121 Etats ne bénéficient que de 54 millions de doses.
En conclusion, les auteurs, prenant appui sur une formule d’Hervé Le Bras sur un tout autre sujet, s’interrogent pour savoir s’il existe des « frontières-zombies ». Ils entendent par cette expression quelque chose qui serait « mort en tant que croyance mais vivant en tant que force sociale ». Il faut toujours se souvenir qu’aucune frontière n’est étanche et que les frontières, loin d’être un objet mort, sont toujours bien vivantes.
Cet atlas trouvera donc toute sa place dans la bibliothèque du professeur car il permet de faire un point actualisé sur une notion centrale et il l’éclaire sous de multiples angles.
CR de Jean-Pierre Costille
____________________________________
Cr d’Antoine Baronnet
« Retour des fronts, essor des murs »
Après l’excellent « Atlas des frontières » réédité par les Arènes au printemps dernier, les éditions Autrement nous proposent un atlas dédié à la même thématique. L’écriture a été confiée à un duo bien connu des professeurs du secondaire.
Hugo Billard est professeur d’histoire-géographie en classes préparatoires ECG à Paris et l’animateur de l’excellente émission « Planisphère » sur Radio-Notre Dame. Il a principalement écrit les chapitres dédiés aux frontières contemporaines (hyper-lieux, frontière américano-mexicaine, le tourisme, le cyberespace etc.). Son partenaire d’écriture est Frédéric Encel, maitre de conférences à Sciences Po-Paris et spécialiste du Proche-Orient. Il est principalement l’auteur des pages sur les frontières à travers l’histoire (Guerre froide, décolonisation) et au Proche-Orient (Plateau du Golan, Israël, Palestine, Eretz Israël).
Après un premier chapitre permettant d’inscrire les frontières dans le temps long à travers des sujets classiques (le limes romain, la Grande Muraille de Chine ou les conséquences des traités de Westphalie de 1648), la suite s’attache à étudier les frontières sur le plan matériel (chapitre sur les discontinuités et sur l’affirmation) et immatériel (les représentations, l’espace vécu). Fidèles à l’esprit de la collection, les textes sont courts et illustrés de deux ou trois documents.
L’intérêt de ce type d’atlas pour les enseignants est très fort. Plusieurs documents seront utiles aux professeurs de collège et de lycée afin d’enrichir et d’actualiser leurs cours. Parmi de nombreuses possibilités, citons la frise chronologique des différentes capitales chinoises des pages 14-15 (chapitre introductif d’histoire en classe de seconde), la division de Berlin durant la Guerre froide aux pages 44-45 (troisième, terminale), l’infographie présentant les 20 plus vastes ZEE de la page 61 (terminale spécialité, terminale tronc commun), la situation mondiale du cyberespace qui est à la fois un espace d’échange et de menaces des pages 66-67 (thème sur la connaissance en terminale spécialité) ou encore les migrations du Nord de l’Afrique en direction des pays européens via la mer Méditerranée des pages 84-85 (seconde).
Source : Sommaire tiré du livre « Atlas des frontières » publié par Autrement, Septembre 2021, pages 4-5
Lors de la lecture du livre afin de préparer ce compte-rendu, deux petites coquilles ont été repérées. La première est située sur l’une des cartes de la page 30 : la capitale du Burundi est Bujumbura (et non Bajumbura). La seconde concerne la capitale du Bhoutan, Thimphou (qui devient « Thimbu », une écriture inusitée), sur la carte des enjeux frontaliers en Chine via l’exemple du Tibet (page 71). Plus embêtant, la Guinée se retrouve en lieu et place du Sénégal sur la carte des migrations de la page 84 !
En conclusion, cet atlas réussit habilement à associer la présentation de situations classiques (les frontières entre Israël et la Palestine, la péninsule coréenne, les ZEE) avec d’autres moins connus qui permettront de renouveler les études de cas en classe (les républiques de la Louhansk et de Donetsk en Ukraine, le cyberespace, la zone de coopération entre le Timor-Oriental et l’Australie). Le choix de la photographie pour la couverture est également une invitation à la rêverie et au voyage : il s’agit d’une route goudronnée au Karakorum longeant la frontière sino-pakistanaise.
Un ouvrage qui ne surprendra pas les spécialistes, mais qui plaira à un large public par sa capacité à expliquer clairement les enjeux de nombreuses frontières à toutes les échelles.
Pour aller plus loin :
- Présentation de l’éditeur -> Lien