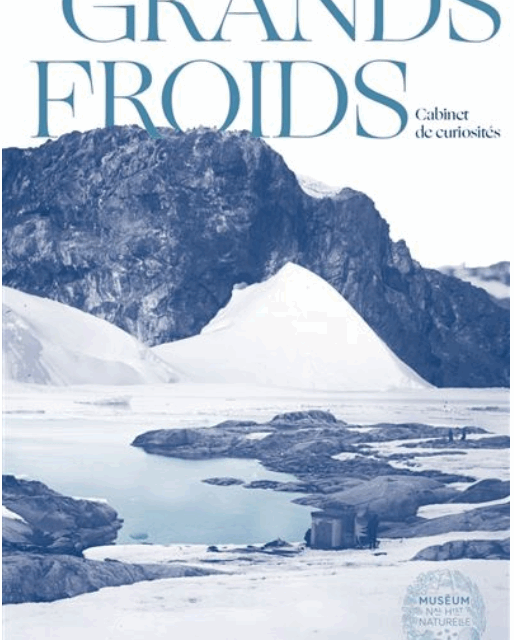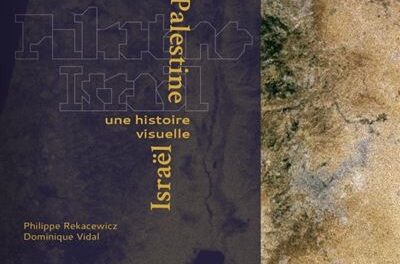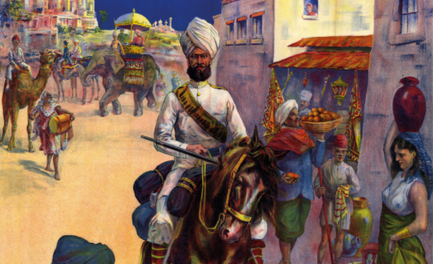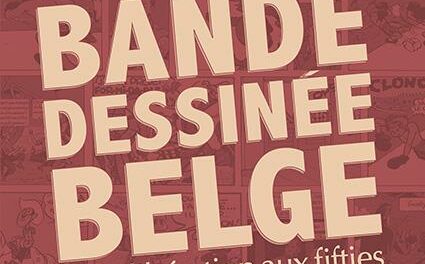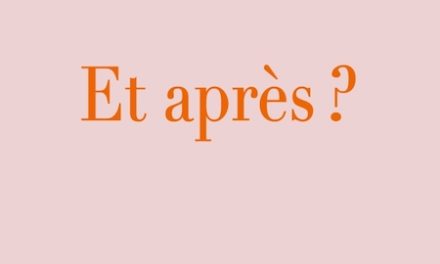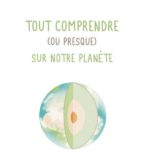Commencer la lecture de « Grands froids – Mémoire des pôles », c’est comme avoir reçu de la part des deux auteurs la permission d’ouvrir les vitrines et les réserves du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Cette très vieille et respectable institution, née en 1793, développe une politique de conservation, valorisation et diffusion d’un savoir qui n’est pas seulement destiné aux chercheurs. Marie-Béatrice Forel, responsable des collections de paléontologie et Pierre Sans-Joffre, responsable des collections de minéralogie et géologie, ouvrent les portes du milieu polaire, un des plus menacés en ce début de XXIe siècle.
Terrae incognitae
L’aventure commence au-delà des deux cercles polaires, dans des territoires hostiles où la température peut descendre jusqu’à -71,2 degrés comme en 1926 en Sibérie. Seuls 8 pays du globe sont dans cette limite géographique aujourd’hui.
L’astronome et explorateur grec Pythéas, parti de Massalia, atteint Thulé au IVe siècle avant J-C, une terre où le soleil ne se couche pas. Il décrit le premier le paysage polaire et les difficultés pour y naviguer. C’est en 983 que des hommes posent le pied au Groenland : les vikings grâce à leurs solides navires sont capables de se lancer dans de telles expéditions. Le XVe siècle marque une réelle rupture. Si le « passage du Nord-Ouest » est pensé dès 1497, il faut attendre 1906 pour qu’il soit franchi par l’explorateur norvégien Roald Amundsen. Le passage du Nord-Est a été emprunté quelques années auparavant, en 1879, par le géologue finlandais Adolf Nordenskiöld.
Dès l’Antiquité, les savants grecs théorisent l’existence d’une Terra Australis incognita. Des expéditions à partir du XIVe siècle recherchent un passage par le sud. En un peu plus d’un siècle seulement, les marins franchissent le Cap de Bonne-Espérance et le Cap Horn. Le 19 février 1819, William Smith est le premier à apercevoir l’Antarctique. Le début de l’exploration du Continent blanc peut commencer et permettre la multiplication des découvertes géographiques, des collectes scientifiques qui développent ainsi les savoirs scientifiques. Les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle se peuplent de riches témoignages de toute nature pour les générations futures.
Cap au Sud
Le 7 octobre 1837, lorsque l’expédition de Dumont d’Urville quitte Toulon, elle a une mission scientifique à remplir : explorer l’océan Pacifique, trouver le pôle Sud magnétique et » pour recueillir tout ce que cette terre ingrate pouvait offrir » comme l’écrit l’explorateur normand. Le 21 janvier 1840, un premier groupe pose le pied sur l’Antarctique, au nord-est de l’archipel de la Pointe-Géologie. Les prélèvements de roches qui y ont été réalisés permettent d’écrire l’histoire du continent. Une multitude d’échantillons, plus de 180 mollusques nouveaux vont être entreposés par la suite au Muséum offrant aux chercheurs deux siècles plus tard un matériau de travail exceptionnel.
1882-1883 est proclamée » Année polaire internationale « , c’est la première fois qu’une telle initiative est prise, elle témoigne de l’intérêt majeur porté dès le XIXe siècle pour ces contrées. 12 pays y participent conscients que les observations scientifiques de toute nature ne peuvent se faire qu’en se coordonnant. C’est la première de 4 années polaires, 1932-1933, 1957-1958 et la dernière en 2007-2009 consacrée aux deux pôles et aux effets du dérèglement climatique.
L’expédition sous commandement de Jean-Baptiste Charcot qui quitte le 15 août 1903 le port du Havre permet de mesurer l’engouement populaire pour le monde polaire. Si des subventions proviennent du ministère de l’Instruction publique, de la Société de Géographie et du Muséum lui-même, un financement participatif rencontre un franc succès. Le commandant baptise son navire » Le Français » avant d’appareiller pour d’hiverner dans la péninsule de l’Antarctique. À son retour, il a dans ses cales 75 caisses de spécimens à livrer au Muséum. L’expédition du » Pourquoi pas ? » en 1908 complète par la suite ces découvertes. De nouvelles espèces rapportées portent le nom des scientifiques qui la composent : Ripaster charcoti, Eteone gaini…
Cap vers l’Arctique
La » Terre de Blosseville » porte le nom du premier découvreur de la côte Est du Groenland. Parti d’Islande, où il est chargé de la police des marins français, en 1833, le lieutenant de vaisseau cartographie un littoral inconnu avant lui et ramène de nombreux échantillons prélevés sur place. C’est lors de sa seconde expédition la même année qu’il disparaît ainsi que les 75 hommes d’équipage de » La Lilloise « .
Les expéditions suivantes vont permettre d’explorer toute l’Islande, le Groenland, la Laponie, le Spitzberg …. Chacune ramène des sables et vases d’ancres qui aujourd’hui encore sont étudiées pour mesurer l’évolution de l’environnement marin de cette région des grands froids. Jean-Baptiste Charcot à son tour y multiplie les missions avant d’y faire naufrage en 1936. Les collectes sont exceptionnelles, les spécialistes nombreux dont Paul-Émile Victor qui effectue alors son premier voyage. Ethnologue, il photographie » Le commandant Charcot endormi sur le pont du Pourquoi-pas ? » dont le tirage de 1936 est reproduit dans les pages de » Grands Froids – mémoires des pôles « .
Les trésors du Muséum
Marie-Béatrice Forel et Pierre Sans-Joffre ont choisi d’offrir au lecteur des illustrations exceptionnelles, richesses parfois inaccessibles, en ouvrant leur « Cabinet de curiosités ».
Un fragile crinoïde ramené d’Antarctique lors de l’expédition Bauduin (1800-1804), le crin du mammouth laineux de Liakhov découvert en 1906 dont le squelette ne sera totalement remonté qu’en 1957 par Yves Coppens ou le sable ramené de l’île Hoseason par Charcot lors de sa mission de 1903-1905 sont, parmi bien d’autres, des témoignages puissants de ces expéditions. Des algues rouges ramenées des TAAF lors du programme PROTEKER en 2021 portent la mention « (non encore identifiée) « . À travers ces simples trois mots, le lecteur prend conscience que l’homme n’a pas encore percé tous les mystères que les Grands Froids recèlent en eux. Il reste encore des missions à monter, des recherches à mener et des collections comme celle du Muséum national d’Histoire naturelle à enrichir pour l’avenir.