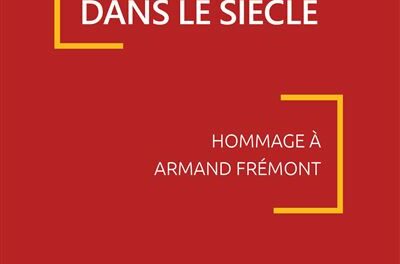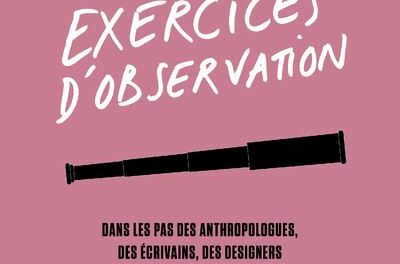Beaucoup d’élèves sont en échec en géographie et surtout n’en comprennent pas la portée du fait de nombreux implicites. Et dans un contexte de mode, voire d’injonction à l’explicitation, il était tentant de se pencher sur la question d’autant plus que la didactique de la discipline ne s’y était pas encore attelée. C’est au sein de cet ouvrage reprenant sa thèse sur les savoirs structurants en géographie soutenue en 2022 que Cédric Naudet, maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil, a souhaité exposer ses analyses sur le sujet.
Partie 1 –
La première partie souligne les enjeux de l’explicitation dans le domaine de la géographie en croisant les approches sociologique et didactique.
Le premier chapitre évoque les « malentendus », les « codes restreints » et « codes élaborés », la « secondarisation » et des élèves qui sont souvent centrés sur le « faire » et ne savent justement pas transposer. L’exemple d’Amidou, l’élève coloriant mal sa carte lors de l’évaluation, révélé par Stéphane Bonnery est devenu célèbre à ce sujet. On y parle aussi de « pédagogie invisible » ou de « curriculum invisible », des éléments qui viendraient s’ajouter au bloc « enseigné, assimilé ». Bourdieu et Passeron avaient, en leur temps, évoqué une reproduction des inégalités qui appelait une « pédagogie rationnelle ». Il est nécessaire de spécifier les registres d’apprentissage pour que cela fonctionne : le croisement de registres « culturel », « cognitif », « symbolique/identitaire » permet de structurer le « registre scolaire » autour d’un régime « majeur » et d’un régime « mineur », régime dans lequel les élèves en difficulté pourraient rester cantonnés.
Le second chapitre expose les finalités de l’explicitation. Le programme est assez flou avec des finalités assez « molle » teintées de transversalité d’où une contre-proposition : quelle construction(s) du rapport au monde, à sa spatialité, à sa géographicité ? Il faut faire comprendre les stratégies d’acteurs pour expliquer la dimension spatiale des inégalités éducatives. Et les élèves ont à dire et à construire un rapport au monde qui leur est propre. Les savoir sont aussi interrogés. Les savoirs de références se contredisent parfois, c’est un obstacle. Tout comme l’histoire de la discipline qui montre le passage d’une géographie concrète, vidalienne, à une géographie distanciée produisant un discours sur le monde. La géographie enseignée emprunte aux deux. Est souligné le problème de l’autoréférencement de la discipline, le flou existant entre notions et concepts, l’absence de montée en complexité dans la progression. Au niveau des démarches, la géographie se confond avec ses outils, il y a souvent de l’apprentissage et de la restitution de mots clés/notions sans réel raisonnement spatial.
Le chapitre trois se demande comment penser l’explicitation en didactique de la géographie. L’approche des contenus peut être socialisatrice avec les limites de la reconstruction inévitable de celle-ci plus ou moins influencée positivement par le milieu social. La forme disciplinaire montre une reconstruction permanente avec toujours des savoirs savants, des contenus, un appareillage d’exercices, de finalités…mais avec des implicites sur les savoirs savants. Le cadre de la problématisation se structure autour de l’identification, la construction et la résolution mais il y a des spécificités propres à la géographie comme le besoin de mettre à distance et de considérer les acteurs, d’où le recours à la géographicité et aux trames conceptuelles dans lesquelles il est possible de circuler.
Partie 2 –
La seconde partie vise à identifier l’implicite dans la chaine curriculaire de la géographie avec, pour démarrer un chapitre quatre exposant une méthodologie.
Les investigations se sont faites dans le cadre des programmes d’école et de collège de 2016 et de lycée de 2019. Y repérer les implicites était un préalable pour cerner les sources de malentendus. Deux concepts ont été passé au crible : la métropolisation (présente en 4ème et en 1ère), les ressources (présentes en 5ème et en 2nde). Ces deux concepts sont a priori distants dans le monde de la recherche. Les manuels ont été analysés ainsi que les cahiers. Des observations en classe et dans le dispositif « devoirs faits » dans 5 établissements variés ont été menées.
Le chapitre cinq évoque le prescrit des deux concepts étudiés. La métropolisation est apparue dans les années 1990, issue de l’approche nomothétique et de l’analyse spatiale. Son apparition dans les programmes est assez rapide suivant un schéma de transposition didactique : de 2002 à 2019 dans les programmes de collège et lycée avec une hausse du nombre d’apparition du terme. Malgré tout, il y a un flou apparent entre la « grande ville » et la « métropole ». De plus, avec l’ancrage sur l’habiter, on a tendance à négliger la fonction « commandement » au profit du triptyque densité/diversité/mobilité. De plus encore, le recours aux échelles nationale et mondiale est privilégié au détriment d’une lecture plus locale et risque de gommer la géographicité des élèves. En ajoutant le traditionnel « refus du politique », on crée de l’implicite.
Pour les ressources, le concept semble plus abordable. Peut-être dans sa dimension matérielle (l’eau, l’alimentation, l’énergie…) mais quid de l’immatériel ? L’ancrage classique, idiographique, a souvent amené la ressource a pu être lue sous son aspect « naturel » mais elle est surtout « relative ». Il faut raisonner en lien avec la « valeur ». L’usage est de plus en plus systémique, encore plus dans notre contexte où celles-ci se raréfient. L’’étude des BO est plus longue ici car les ressources sont apparues dans les programmes de 1985. L’approche biophysique disparait, l’axe culturel n’est pas présent.
Dans les deux cas, il n’y a pas de progressivité entre collège et lycée et les concepts sont pensés à distance des élèves.
Le chapitre six se penche sur les manuels. Ceux-ci révèlent peu de différences entre eux, ce qui confirme la structure du « système manuel » comme l’avait défini Daniel Niclot. Avec une grande offre de documents composites qui n’est pas sans générer des difficultés de repérage chez l’élève, d’appréciation de la logique globale sous-entendue. Sur l’élargissement et la mise en perspective des études de cas à l’’échelle mondiale, les manuels gèrent ça de façon très différente, certains en faisant même l’impasse. Sur la spatialité, on sent une centration sur les plus grandes villes amenant une confusion entre « métropolisation » et « métropole » omettant les marges et l’aspect « subi » de la métropolisation. On part donc vite dans quelque chose de consensuel. La vision est très occidentalo-centrée pour le cas des ressources. Sur les acteurs, il demeure un point de vue gestionnaire, économiste, surplombant. Il y a peu d’habitants et d’autres acteurs. Sur les attributs du concept, il y a une forte indistinction entre notion, concept et mots de vocabulaire associés qui sont nombreux et non hiérarchisés. Cela peut amener à un fouillis et à un apprentissage par cœur. Il n’y a pas de montée en complexité. Dans le registre « identitaire symbolique », on trouve des questions nommées « géographie autrement » autour des questions socialement vives ou, à défaut, des questions consacrées au quotidien. Mais les questions ainsi formulées (« faut-il arrêter de manger de la viande ? ») ne permettent pas forcément d’appréhender le problème en géographie et d’en saisir la dimension spatiale. Demeure également le problème des photos stéréotypées, Nord/Sud, celles des bonnes pratiques vs les autres.
Le chapitre sept évoque les cahiers, sur la métropolisation d’abord. Le corpus d’un premier lycée traduit une parole magistrale de l’enseignant (les écrits montrent une trop grande proximité pour avoir été produits de manière autonome). Quelques cas mixtes alternent le cours magistral et des mises en activités d’élèves. Un cas évoque une approche socio-constructiviste autour de mise en commun d’exposés. Dans un second lycée, on trouve davantage de mise en activités mais un appui sur les manuels qui n’évite pas les écueils précités (concept non manipulé, spatialités non interrogées, absence de recours aux représentations des élèves). En collège, les similarités sont très fortes entre les cahiers car les enseignants se spécialisent par niveau de classe. Les activités qui ressortent sont celles liées à la recherche et à l’élaboration de bilans. Sur les ressources, il y a une prédominance du modèle où les acteurs subissent, où l’état domine et surplombe et ne donne pas lieu à un élargissement multiscalaire. La forme scolaire apparait, à l’image de la figure 13, « déstructurée », « désincarnée », « décontextualisée », « déterritorialisée ».
Le chapitre huit revient sur les observations en classe qui s’accompagnent de 12 entretiens avec des professeurs et 9 avec des élèves. La synthèse et la mise en commun des travaux est difficile car précédée d’activités dites de « basse tension intellectuelle ». Les collègues sont tiraillés entre la quête de la conceptualisation qui est difficile à atteindre et l’injonction à devoir faire des études de cas. Dans une autre situation, de riches échanges oraux aboutissent à la définition du concept de « ressources ». La figure 14 p 201 est tout à fait bonne pour montre la « gradation de l’explicitation ». Des enseignants témoignent sur l’insertion du politique dans les discours car les prescriptions apparaissent trop « molles » pour faire saisir aux élèves les enjeux. Dans le cadre du dispositif « devoirs faits », les élèves interrogés voient la géographie comme une discipline « évidente » avec des définitions à apprendre mais sans nécessité de creuser vers les exercices qui exigent un raisonnement. Ils ont du mal à dépasser le stade du « ce document-là montre que… » pour généraliser.
Partie 3 –
La troisième partie présente une ingénierie didactique qui permettrait d’être plus explicite sur la maîtrise des savoirs structurants en géographie.
Le chapitre neuf présente la méthode visant à articuler géographie spontanée et géographie raisonnée notamment dans un contexte de fort développement des mobilités, surtout individuelles, et de l’habiter polytopique. Deux conditions sont nécessaires : se référer à des pratiques sociales, construire une métacognition des élèves sur leurs savoirs. Un bon encart 17 p 232 présente une grande variété d’expériences spatiales directes ou indirectes. On vise la secondarisation. Les outils mobilisables sont le débat, les tableaux et les productions graphiques. Le but, à l’image de la figure 19, est de développer les 4 « I » : immersion, interaction, institutionnalisation et implémentation.
Le chapitre dix applique cette démarche à la métropolisation. On démarre par un état des lieux des connaissances sur le sujet et les premières générale témoignent d’une meilleure maitrise que les premières STMG. La phase d’immersion voit l’interrogation des individus, in situ, sur le parvis de la Défense ainsi qu’une cartographie de leur lieu de provenance. La phase d’interaction classe ces interviewés dans les différentes catégories de la définition de la métropolisation qui donne les « pourquoi » de cette concentration. La phase d’institutionnalisation voit l’explicitation de l’enseignant via une carte heuristique qui va de l’observation à la conceptualisation. La phase d’implémentation, plus longue et multiphases, fait une comparaison via Londres, l’échelle Monde puis Lyon. Au final, la maîtrise, différenciée selon les élèves, va de l’ensemble des attributs à une absence de prise de hauteur en passant par le cas intermédiaire de la maîtrise d’un seul des attributs.
Le chapitre onze fait de même avec les ressources. L’état des lieux des connaissances montre un concept moins abstrait mais malgré tout souvent confondu avec celui d’énergie. L’immersion était ici indirecte via la réflexion sur le choix d’organiser la coupe du monde de football au Qatar avec la présentation de 5 acteurs. L’interaction part sur un débat permettant de confronter les points de vue. L’institutionnalisation est une mise à l’écrit en tableau des argumentaires des élèves. L’implémentation voit comme l’élargissement mondial peut se faire. Comme pour la métropolisation, trois groupes se dégagent, les élèves les moins favorisés en restent au stade « de l’exemple. »
Au terme de cette lecture, la conclusion générale nous invite à admettre que l’implicite met en échec certains élèves. Des investigations à plus large échelle sont à souhaiter ainsi que sur d’autres objets d’étude : les thèses d’Eliane Perrin sur le climat et de Pierre Colin sur les frontières vont déjà dans ce sens. Et comme toujours, on en revient à la nécessité de proposer une formation solide sur le sujet mais également de rédiger les programmes en tenant compte de ces éléments. Une nouvelle pierre, importante, à l’édifice de la didactique de la géographie, dans un ouvrage clairement rédigé et solidement documenté.