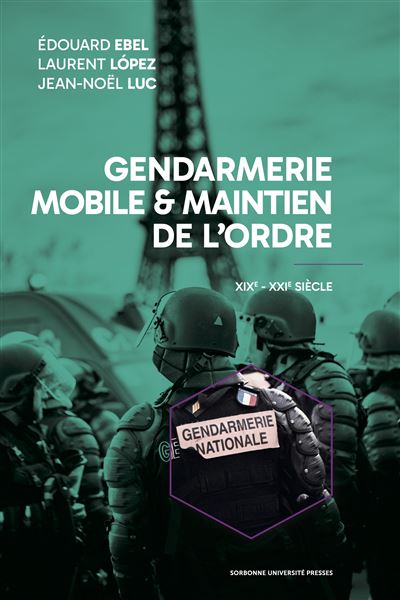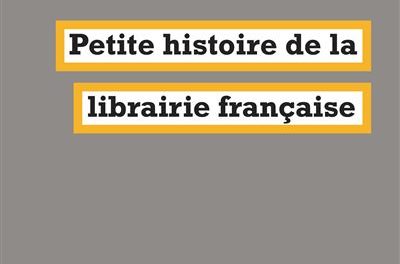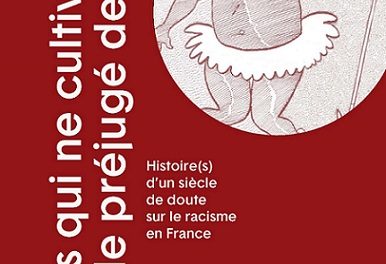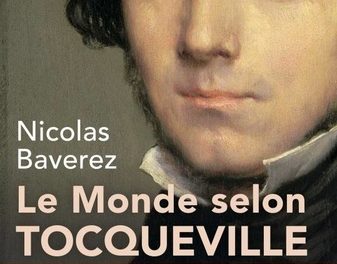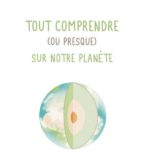Après avoir dirigé plusieurs travaux de référence sur l’histoire de la gendarmerie (Soldats de la loi, Les gendarmeries dans le monde), Jean-Noël Luc coordonne ici, avec Edouard Ebel et Laurent Lopez, un ouvrage pionnier consacré à la gendarmerie mobile (GM) et maintien de l’ordre (MO), au croisement de l’histoire sociale, du droit, de la science politique et de la sociologie. Il pose les jalons d’une réflexion collective sur l’usage de la force dans les régimes démocratiques et retrace les étapes de l’installation « d’un maintien républicain de l’ordre » (p.13). C’est une contribution originale à l’histoire du maintien de l’ordre et, plus largement, à l’histoire de l’Etat, de la violence légitime et des relations entre pouvoir et société. Le maintien de l’ordre y est pensé dans ses dimensions plurielles : conceptuelle, historique, institutionnelle, matérielle et symbolique.
Jean-Noël Luc rappelle ainsi que le maintien de l’ordre, loin de se réduire à l’affrontement spectaculaire, est un système d’intervention à « étagement multiple »: dissuasion, prévention, coercition. Il ancre la réflexion dans une histoire longue, de la fusillade du Champ-de-Mars en 1791 à des événements plus récents (mouvements des gilets jaunes) et propose une fine historicisation de la violence d’Etat. La vision téléologique et manichéenne de la violence policière et d’Etat est dépassée afin d’être replacée comme objet d’histoire propre. Ainsi sont mises en avant les continuités, les ruptures, les réformes, les retours en arrière d’une pacification du maintien de l’ordre « depuis la fin du XIXe siècle et la discontinuité d’un processus [qui n’est] ni inéluctable, ni linéaire ni général » (p. 14). La violence d’État reste bien un phénomène structurel, modulé par des contextes politiques et sociaux. L’ouvrage souligne les écarts entre doxa et praxis en identifiant les causes de ces décalages (formation, contexte, choix politiques etc.) : l’ouvrage met en lumière l’agency des gendarmes et leur marge d’action individuelle dans un cadre institutionnel donné. Enfin, un soin particulier est accordé à l’interdisciplinarité : les apports du droit, de la science politique, de la sociologie et de l’histoire se croisent et offrent une réponse sur l’usage légitime de la force publique. L’ouvrage n’élude pas non plus les questions sensibles et les « violences policières » sont replacées dans une approche des cultures policières: c’est à la fois une manière de penser la diversité des pratiques et une réflexion sur les normes implicites qui régissent le recours à la force.
L’analyse proposée offre des outils pour penser ces violences « admises, disproportionnées ou irrégulières » à chaque époque. Roseline Letteron apporte ensuite un éclairage précieux sur la montée d’un paradigme « de responsabilisation du maintien de l’ordre, désormais soumis à l’exigence de proportionnalité ». Cette judiciarisation croissante est pourtant ambivalente : elle peut masquer, sous l’apparence du droit, des pratiques d’exception. Le mot d’ordre est devenu un mot-écran. L’auteure met également en lumière une crise du modèle français du maintien de l’ordre, confronté depuis les années 2000 à des mouvements sociaux plus longs, plus imprévisibles, plus fragmentés (ZAD, Gilets jaunes par exemple). Ces transformations posent la question de l’adéquation entre doctrine et terrain, et de la capacité de la gendarmerie mobile à s’adapter. Corps militarisé, non syndiqué, longtemps à distance du débat public, elle est aujourd’hui au cœur des tensions contemporaines entre autorité de l’État et droit de contester.
Last but not least, les auteur.e.s nous invitent à déplacer notre regard sur l’histoire de la protestation collective. Ce retournement de perspective donne toute sa portée à l’ouvrage: comprendre la MO c’est comprendre comment un État traite la contestation, comment il négocie, encadre ou réprime les contestations. Le MO est ainsi envisagé comme un miroir (déformant ?) de la démocratie et analyser ses soubresauts, c’est rendre compte des tensions, des évolutions du régime démocratique lui-même et comment il construit sa propre légitimité.
La première partie, centrée sur le XIXe siècle, retrace la généalogie institutionnelle et engage une relecture critique des origines du MO moderne à travers des approches mêlant histoire politique, histoire sociale et histoire des idées. Laurent Lopez présente un éclairage sur l’émergence d’un concept de « maintien de l’ordre » loin d’être univoque ou figé, tant il est polysémique et parfois absent du vocabulaire des acteurs eux-mêmes. Il masque des pratiques hétérogènes et contradictoires et est insuffisamment théorisé jusqu’au tournant du XXe siècle, où des auteurs comme Max Weber commencent à l’associer à la légitimité de la violence étatique. En effet, il demeure « un agrégat de concepts juridiques établissant les règles et les comportements qui doivent réguler les relations sociales » (p 46). Et, si le concept est parfois nommé, son fond reste soumis à de multiples interprétations. Ensuite, Edouard Ebel remet en cause la linéarité d’un récit de professionnalisation qui ferait de la GM l’aboutissement d’une professionnalisation continue.
En effet, le XIXe siècle est traversé par des expérimentations fragiles, souvent temporaires et par une absence d’unification entre armée, police, et gendarmerie départementale. De plus, la création d’unités mobiles est perçue comme « une reconnaissance implicite de la conflictualité sociale permanente » (p. 69), ce qui en rend politiquement risquée l’institutionnalisation. En revenant sur les tentatives avortées de constitution de forces mobiles, cette partie brise un mythe d’origine fondatrice qui verrait naître plusieurs formes de gendarmeries mobiles, dont la GM créée en 1921 serait l’héritière. Cette partie met aussi en avant l’évolution du regard porté sur les foules et les conflits sociaux. En convoquant des références classiques (Le Bon, Elias), elle interroge la construction d’un imaginaire « de la foule violente ».
Chemin faisant, les auteurs montrent que la violence n’est pas qu’une réponse policière : elle est le produit d’une interaction entre manifestants, institutions et contexte politique. Ils s’appuient sur des exemples du second XIXe siècle : des travaux de Michelle Perrot (sur 1695 grèves entre 1871 et 1891 3.6% dégénèrent vers de la violence) aux attitudes favorables des gendarmes face aux revendications ouvrières, se dessine un portrait des gendarmes tout sauf monolithique. De plus, la judiciarisation (la grève n’est plus un délit pénal depuis 1864 et la loi Waldeck-Rousseau de 1884 légaliste les syndicats) et la pacification progressive du maintien de l’ordre ne doivent pas masquer des drames comme celui de Fourmies le 1er mai 1891 et dont la médiatisation marque une rupture. Aurélien Lignereux constate par ailleurs que la professionnalisation « n’est pas à l’ordre du jour » et que prédomine un « un idéal de concentration verticale du MO » (p.71 et 72).
La deuxième partie explique comment la garde républicaine mobile (GRM) s’est constituée entre 1907 et la 2e guerre mondiale. Il faut attendre la IIIe République pour que s’ébauche une réflexion sur la légalité et la pertinence d’une force militaire permanente de MO. La Grande guerre joue un rôle matriciel car pensée comme un laboratoire où les pelotons mobiles sont rapidement projetables en tout point du front. Puis, à l’orée des années trente, la formation des GM est conçue comme le « moyen de placer le MO en dehors des logiques locales de ressentiment » (p.83). L’objectif est bien de garantir une neutralité axiologique, renforçant la légitimité de la GM et in fine de la République. Cette prise de distance (géographique, sociale et symbolique), ce moment de l’entre-deux-guerres qui combine alors progressivement un savoir-faire technique spécifique et la structuration « d’une organisation hiérarchisée œuvrant à sa légitimation dans le paysage de la force publique et policier » (p 106) constitue une révolution dans la manière de concevoir le maintien de l’ordre : on passe d’un « modèle réactif et localisé » à un « modèle préventif et mobile ».
En outre, des précisions sont apportées sur la formation des gardes mobiles : la constitution d’un éthos professionnel spécifique et un esprit de corps singulier basé, notamment, sur la solidarité. La contribution de Marie-Charlotte James rend compte de ces fabriques associant rigueur morale, efficacité, discipline et condition physique. Cet éclairage sur les sociabilités, les pratiques corporelles, la participation à des compétitions équestres permet une histoire « au ras-du-sol » qui donne chair à une figure à part, à la frontière du soldat et du fonctionnaire, du professionnel et du citoyen. Enfin, les auteurs montrent que l’institutionnalisation de la GRM s’inscrit dans une dynamique plus large de civilisation des mœurs : l’usage de la force devient affaire de mesure, de proportionnalité et l’importance accordée à la retenue, à l’autocontrôle, à l’individualisation des réponses face à la foule manifeste une forme de domestication des pulsions violentes au sein de la force publique. La GRM est alors l’instrument d’un État qui cherche à se présenter comme rationnel, contrôlé et à distance de l’arbitraire. À l’image de l’épithète « mobile », la GRM incarne une institution hybride, en tension entre héritage militaire, exigence démocratique et impératifs de maintien de l’ordre. C’est cette ambivalence que souligne Laurent Lopez en parlant d’une « longue marche », hésitant entre passé et avenir.
La troisième partie revient sur le MO de la fin de la Troisième République à la Libération. Elle propose une histoire à facettes, à défaut de disco, où le MO devient un miroir des ambivalences de l’État et de ses agents. Elle présente des pistes de lectures suggestives sur les processus d’obéissance et de désobéissance des agents de l’ordre à l’Etat français : « selon l’époque, l’institution, les individus se positionnent, dans des proportions variables entre l’obéissance, l’empressement, la réticence et parfois la désertion » (p. 128). Sous Vichy, la création de la Garde et des Groupes Mobiles de Réserve (GMR) s’inscrit dans cette tension entre la volonté vichyste de contrôler le territoire, via un pouvoir central répressif, et la méfiance des Allemands, soucieux d’éviter tout réarmement français. La GMR incarne bien cette volonté réformatrice de Vichy d’un pouvoir fort et répressif et le recours « à une mystique maurassienne mettant en avant les vieilles identités locales » (p.146). Cette situation donne naissance à des forces, parfois sous-équipées, mal formées, souvent issues de bricolages institutionnels, mais qui n’en participent pas moins à la violence d’État, quelquefois extrême, contre les résistants ou civils. Ainsi, la garde oscille entre « une élite de l’armée nouvelle » et « troupe de police d’appoint » et participe à la spirale de violence prônée par J. Darnand.
L’obéissance des forces de l’ordre sous l’Occupation a suscité de nombreuses interrogations : la discipline est mise en avant, tout comme le serment au chef de l’État. Et, Benoît Babserbusch rappelle bien que les textes de l’époque insistent sur une obéissance « sans hésitation ni murmure » (p.141). Le légalisme, la culture militaire et/ ou l’anticommunisme apparaissent comme autant de facteurs explicatifs des comportements ; certains gardes distinguant alors « les bons des mauvais maquis ». Cette « mauvaise troupe de Vichy » incarne une volonté de réforme autoritaire, d’ancrage local et d’idéologie nationale mais échoue à se doter d’une efficacité réelle. Les GMR brillent par leur faible rendement répressif, ce que montre notamment une étude statistique proposée par Christian Chevandier : dans certaines régions, ils sont à l’origine de moins de 1% des arrestations de résistants. Chemine aussi des parcours d’entrée dans la résistance comme le capitaine Paul Vincent qui fournit de nombreuses informations à la résistance.
Dans la dernière séquence sur la Libération, Jean-Marc Berlière rappelle les défis posés par la nécessité de (re)constituer des forces de police et de MO tant la police et la gendarmerie sont perçues « comme des piliers de la révolution nationale, des acteurs essentiels de la politique d’exclusion et de répression de l’État français » (p. 158). La réorganisation passe par une épuration judiciaire (limitée), une recomposition idéologique et organisationnelle. C’est dans ce contexte que sont créées en 1945 les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) par un « amalgame original entre résistances ou maquisards (…) passés par les milices patriotiques ou les FRS à dominante communistes– policiers et anciens GMR », à des proportions différentes selon les régions.
Si choisir c’est renoncer, mon cœur balance pour cette quatrième partie qui apporte des éclairages stimulants sur le maintien de l’ordre en situation coloniale. Ce mouvement géographique s’accompagne d’un déplacement historiographique: penser le MO comme outil de domination impériale, de guerre asymétrique et d’expérimentation violente. Ce passage démontre dans quelles mesures les processus de décolonisation désorganisent les catégories classiques du MO en introduisant, notamment, des zones de brouillard entre répression intérieure et guerre extérieure (le soulèvement malgache de 1947-1948 est violement écrasé par l’armée « y compris en jetant des prisonniers depuis des avions pour terroriser des villageois » p. 177). L’action de la gendarmerie, en particulier en Indochine et en Algérie, doit être replacée dans une logique de guerre totale, où la distinction entre civil et militaire, entre ordre public et action de guerre, s’effacent progressivement. Les auteurs témoignent alors d’une matrice répressive et « d’un usage disproportionné de la force, en particulier militaire » (p.178) qui contrastent avec les interventions en métropole depuis la fin du XIXe siècle. Les colonies seraient alors un laboratoire de doctrines d’actions et d’innovations spécifiques ensuite réimportées en métropoles dans d’autres contextes de tension. La gestion de l’ordre public ultramarin resterait-il donc caractérisée par un « compartimentage de la violence régulée face aux colons, puis aux résidents allogènes et très rarement à l’égard des autochtones protestataires » ? L’ouvrage insiste sur la nécessité de poursuivre les investigations historiques pour identifier et préciser les tenants et aboutissants de violences parfois systémiques, aux polémiques mémorielles liées à ces violences (rapport de Benjamin Stora remis à la ministre des outre-mer en 2016).
L’autre apport réside dans une approche résolument sociale des acteurs du maintien de l’ordre : les hommes qui la composent sont sujets à la fatigue, au doute, à la violence psychique d’un ordre sans légitimité évidente. Cette lecture fine, qui prend en compte les affects et les trajectoires individuelles, restitue toute la complexité des missions de la force publique. Cette réalité indochinoise contée par Aurélien Hermellin donne à voir des gardes souvent jeunes, encadrés par des sous-officiers d’expérience, âgés de plus de 40 ans. Il existe des « creux générationnels » expliquant les différences de cultures et d’éthos professionnels. Ainsi jusqu’aux années cinquante, les demandes de démission des gendarmes fraîchement arrivés fleurissent. De ces expériences singulières, il faut retenir que de nouvelles valeurs irriguent la figure du gendarme idéal : sa capacité d’autonomie et une certaine latitude d’action. Et pour le MO, il s’agit davantage « de limiter ou d’encadrer une expression militante civile et politique » que de « combattre une insurrection militarisée et de rétablir des structures étatiques et administratives face à une autorité concurrente qui elle aussi met sur pied ses propres cadres et normes » (p. 193).
D’autres pistes suggestives sont abordées avec les expériences marocaine (Kaourintina Moigne) et algérienne (Emmanuel Jaulin). La gendarmerie mobile au Maroc lutte activement contre les indépendantistes marocains (recueil d’information, élaboration d’un calendrier des jours sensibles, contrôle de l’espace urbain etc.) et élabore une doctrine de « techniques pour appréhender des terroristes en milieu urbain » (p. 198). Nommer et identifier une altérité dangereuse n’est pas l’apanage de courants politiques (populistes ?) et il est intéressant d’observer que le prisme de la violence est retenue ici pour désigner (et essentialiser ?) une population. Le vocabulaire utilisé résonne intiment avec notre quotidien: « fanatisés, terroristes, dangereux, en supériorité numérique » et témoigne d’une vision obsidionale de l’environnement. À partir de 1955, les gendarmes participent à des exercices « de guérilla et contre-guérilla », à la défense des intérêts français en Afrique du nord (préparer les unités à d’éventuelles incursions de nationalistes algériens au Maroc). Et, il est révélateur qu’en 1957 le sujet d’examen des candidats au grade de maréchal des logis chef porte sur la « lutte contre des commandos ennemis agissant en territoire ami ». L’histoire faisant souvent fi des contradictions, il est savoureux de constater, que durant la période de transition vers l’indépendance, la gendarmerie est placée à la disposition de l’État chérifien ; elle intervient pour consolider, entre autre, le pouvoir des nouveaux dirigeants (et anciens adversaires!). Pour l’Algérie, la gendarmerie perd « progressivement son autonomie pour n’avoir plus qu’un rôle d’appui, sous le contrôle de l’armée » (p. 207). Son rôle se divise en deux périodes : de 1945 à 1959, les actions combattantes prennent le pas sur le MO (renseignement, patrouilles, participation à la bataille d’Alger, innovations via « des commandos de chasse destinés à exercer la pression d’une guérilla permanente sur le terraine même de l’adversaire » p. 209). Puis, de la semaine des barricades (janvier 1960) à l’indépendance en 1962, un recentrement progressif est réalisé autour des missions de MO, essentiellement en milieu urbain, et acte d’un retour sur le chemin du légalisme et de missions plus traditionnelles. La gendarmerie apparait ensuite comme l’instrument de la politique gaulliste de retrait de la France en Algérie et de la lutte contre l’OAS (dont les troubles culminent à Alger le 24 janvier 1960 et le 23 mars 1962 avec plusieurs morts et des dizaines de blessés chez les gendarmes mobiles). Cette période marque durablement la gendarmerie : 200 tués en opération, 100 morts de maladies et 900 blessés (contribution de Francis Mézières). Il est intéressant de souligner que la décolonisation participe « à une internationalisation du modèle gendarmique » : les nouveaux pouvoirs ont besoin d’affirmer leur autorité dans un contexte de transition politique. Or, les gendarmeries héritées de l’empire constituent souvent les seuls appareils policiers présents sur ces territoires et donc capables d’être efficients rapidement et d’être un outil de MO et de répression.
La 5e partie du livre rend compte des défis structurels, entre les années 1930 et 1970, de la gendarmerie mobile face à la réalité du terrain (formation, équipement, organisation), entre adaptation, réformes et violence légitime. Un point est aussi fait sur la manière dont certains échecs et événements ont nourri une réflexion doctrinale débouchant sur une modernisation progressive du MO. Edouard Ebel revient ainsi sur les questions de recours de la force dans les années 1950 à 1970 : l’importance des sommations par la voix ou des signaux sonores est rappelée, mais dans le même temps, la législation se durcit après les événements de mai 1968 et la loi de juin 1970, connue sous le nom de loi « anticasseurs », aggrave la responsabilité civile et pénale des manifestants. Cette responsabilité collective est critiquée et abrogée en décembre 1980 car « le principe d’une réponse proportionnée à la menace, le refoulement par la dispersion plutôt que l’affrontement et une modération (…) restent les principaux traits d’une ‘doctrine’ fondée sur l’équilibre entre sécurité (…) et exercice des libertés collectives et droits individuels démocratiques ». (p.233). Ces enjeux de professionnalisation, de doctrine équilibrée prennent sens suite à mai 68 (Thierry Forest). Ce moment amène à une remise en question des moyens et des méthodes de la GM vers un « vrai métier, avec ses techniques, du matériel et un entraînement adapté » (p. 275). Le constat est sans appel : les équipements et matériels sont inadaptés, les liaisons radio mauvaises (les commandants ne reçoivent parfois pas la fréquence de la préfecture de police) et les unités manquent « d’entraînement physique » (p. 279). L’une des réponses est alors la création d’un centre de perfectionnement qui amorce un mouvement de spécialisation et de professionnalisation de la gendarmerie mobile (demandée pourtant par ses membres dès les années 1930). L’un des enjeux est alors d’harmoniser des pratiques, de diffuser un nouveau modèle et de « conceptualiser des unités qui ont appris à réagir à différentes situations de MO ».
Ensuite, différents exemples de MO sont recontextualisés. Laurent Lopez revient sur un moment clé de l’histoire politique de l’entre-deux-guerres : l’émeute antiparlementaire de février 1934. Après voir replacé l’événement dans sa dimension médiatique, il insiste sur les défauts du dispositif policier, les équipements rudimentaires, des effectifs insuffisants en nombre, une impréparation des policiers face à la violence des émeutiers, le manque de coordination et de renseignement qui conduit à sous-estimer l’ampleur de la mobilisation. La comparaison avec d’autres exemples européens de MO ajoute une valeur heuristique à la démonstration et replace cette opération à une échelle plus vaste. Simon Fieschi propose une fresque avec les bandits d’honneur en Corse « vus comme [des] hors-la-loi menant une vie ascétique dans le maquis, réglant les conflits, protégeant la population » (p. 238). Son travail rend compte des difficultés de la gendarmerie à lutter contre ces bandits : « le soldat de la loi en cherchant à s’intégrer à une population hostile, ses membres se détournent de la dimension militaire et répressive de leur métier » (p. 247). Ici est proposée une réflexion sur l’échec du MO et le dévoilement d’une tension entre militarité et intégration locale : la bataille de l’opinion est alors (re)lancée avec la contribution de Stéphane Gautron sur l’épisode d’Algérie de 1975. Il constitue un « échec politique pour l’Etat et une défaite opérationnelle pour la gendarmerie » (p. 285) et se solde par la mort de deux gendarmes et la fuite du commando armée. L’épisode pose la question d’une adéquation entre la nature de la mission et les moyens engagés et rend compte d’enjeux contemporains : la gestion de nouvelles conflictualités liées aux violences terroristes (islamiste, d’extrême droite etc.) et au langage utilisée pour désigner ces altérités (on peut penser aux débats actuels sur le champ lexical « d’éco-terroristes »).
Erwan Navarre tisse ensuite un lien avec la partie précédente en étudiant les violences d’État dans l’Outre-mer avec l’exemple de l’émeute de mai 1967 à Pointe-à-Pitre. Une grève des ouvriers du bâtiment dégénère en violents affrontements avec les forces de l’ordre. L’auteur replace l’événement dans une temporalité finement plurielle: celui d’un temps long (accumulation de tensions depuis l’entre-deux-guerres), d’un temps court (un ouragan a aggravé des fragilités systémiques : chômage, faiblesse des salaires, insalubrité, insuffisance des services publics) qui renvoie à des réalités contemporaines de territoires d’outre-mer. Et celui de tensions communautaires entre une « majorité antillaise » et une « minorité européenne » qui exerce une domination sociale, économique et symbolique. Cette répression succède à d’autres rétablissements de l’ordre meurtriers hors de la métropole : le 20 mars 1967 à Djibouti (onze tués parmi les contestataires du référendum rejetant l’indépendance). Dans les deux cas, les autorités semblent mal renseignées et mal préparées : peu de moyens, pas d’échanges ou de dialogue avec les syndicats pour ajuster le plan de MO, non prise en compte des spécificités de l’environnement : les faubourgs offrent des interstices permettant une sorte de « guérilla urbaine » entre manifestants et force de l’ordre et « la propension des agents de l’ordre à élever le niveau de violence de leur intervention quand ils sont confrontés à des manifestants de souche dans l’espace colonial ou à des contestataires immigrés en métropole » (p. 268). Outre un racisme possible de certains gendarmes, l’auteur met en avant une autre hypothèse de « violence réparatrice » développée par Patrick Bruneteaux : l’expérience de vie est difficile (climat, logements délabrés, coût de la vie etc.) ; cette violence « réparatrice » devient ainsi un exutoire. Il rend compte des difficultés de l’enquête et de le nécessité pour l’historien.ne de naviguer entre le « mutisme des archives à propos des violences policières illégitimes » et les enjeux liés aux mémoires collectives. Cette contribution invite à dépasser une vision manichéenne des dénonciations des violences ne « s’appuyant pas sur des données chiffrées et vérifiables et le silence des institutions ».
La 6e partie du livre évoque les adaptations du MO dans de nouveaux contextes sociaux. Face à des protestations multiformes (mouvements étudiants, désobéissance civile, « zadistes, islamistes, blacks bocks »), les réalités du MO s’inscrivent dans de nouvelles logiques. Ils participent au plan VIGIPIRATE, au contrôle des flux migratoires, protègent les ambassades à l’étranger et peuvent être déployés lors d’OPEX (en Afghanistan entre 2009 et 2013). En replaçant dans le temps, la pratique de manifester comme « arrivée au terme d’un processus de routinisation et de pacification » et comme « une pratique conventionnelle de la participation politique » (p. 302), Olivier Fillieule enrichit le panorama. Par ailleurs pour Fabien Jobard (cité p. 305), « la construction des représentations et la circulation des images » sont devenues des enjeux majeurs de notre monde contemporain via l’usage des réseaux sociaux. Les forces de l’ordre doivent s’adapter à ces nouveautés et aux narrations médiatiques de certaines chaînes d’information en continu qui tendent à polariser la lecture des événements en proposant une vision réductrice et biaisée. Pourtant, ici devrait être dépassée le simple rapport entre population et force publique afin d’interroger « les formes fondamentales de la démocratie et ses finalités collectives » (p. 305).
Cédric Moreau de Bellaing éclaire les mutations de la protestation collective des années 1870 à nos jours. Il revient sur l’affaiblissement des mobilisations syndicales et politiques au profit de nouveaux mouvements sociaux aux répertoires d’action et modalités de communication avec les forces de l’ordre renouvelés. L’effet d’une radicalisation de la contestation « ayant fait le constat que seule la violence permet de faire advenir des victoires du mouvement social » : on assiste à une reconfiguration des formes de contestation et à une « division du travail militant ». (p.308). De 1930 à 1970, les mouvements sociaux et de contestation s’institutionnalisent par les manifestations et la grève. A partir des années 1980, la protestation sociale se colore de mouvements contestataires et les syndicats et partis perdent progressivement leur « centralité dans l’occupation revendicative de l’espace public » (p. 310) et se développent depuis mai 68 des nouvelles formes de contestations : occupations, blocages, sit-in. Dans les années 90, le mouvement altermondialiste popularise ces répertoires d’action et de nouvelles contestations fleurissent sur des thématiques nouvelles (chômage, racisme, « zones à défendre » etc.). De nouveaux espaces sont ainsi investis (occupation de territoires naturels, agricoles ou urbains dans le cadre de foyer de contestation dans les banlieues). On assiste donc à un renouvellement des « grammaires de la contestation » (Irène Pereira, citée p. 313) qui se manifeste par exemple dans le dynamisme de courant dit « insurrectionnaliste » (défendant une horizontalité antiautoritaire et luttant contre toute forme de domination). Ainsi, malgré un discours dominant sur la pacification, les pratiques policières peuvent être perçues comme violentes. L’auteur rend ainsi compte d’un paradoxe de nos sociétés contemporaines : la démocratisation a créé des attentes élevées de la population et quand les institutions (ici policières) ne sont pas « la hauteur », l’écart entre réalité et aspiration génère des tensions, des ruptures et peut nourrir la défiance et l’indignation.
Après ce regard sociologique, Patrick Bruneteaux évoque les ambivalences de l’Etat en matière de maintien de l’ordre en partant du rapport du défenseur des droits qui recommandait l’utilisation exceptionnelle ou l’interdiction de l’utilisation du flash-Ball (p. 319). Ce dernier se positionne ainsi en opposition avec cette réforme du maintien de l’ordre. L’auteur revient sur l’introduction du LBD et des GMD et leur « effet d’escalade » dans la gestion de la violence et qui rompt avec la culture de modération et de proportionnalité évoquée plus haut. Il revient aussi sur les ferments médiatiques et la perception de l’utilisation de ces armes pour justifier leur utilisation : « les discours actuels des élites convergent vers cette illusion – dénoncée à juste titre par les scientifiques – d’une époque plus violente : au printemps 2023, le chef de l’Etat lui-même souligne la « décivilisation » de la société française » (p. 320). Les thèses avancées par Patrick Brunetaux mettent en avant « le flou » des textes juridiques qui « façonnent un espace des possibles accueillant ces moyens d’action ». La gradualisation n’est plus de mise : avant à un « jet de pierre devait correspondre l’emploi des lacrymogènes ». La proportionnalité devient un concept à géométrie variable. L’auteur revient ensuite des « logiques de confusion » qui brouillent les repères du MO (« la qualification d’attroupement, les abstractions euphémisantes », le brouillage avec la guerre tant dans le champ lexical utilisé que dans certaines perceptions de la gestion du MO etc.). In fine, il insiste sur la nécessité de (re)codifier l’usage de l’emploi de la force dans notre société polarisée. Ensuite, Benoît Haberbusch dresse un panorama de l’emploi de la GM hors de la métropole avec les OPINT et OPEX : une forme d’engagement diversifié (judiciarisation dans les années 2000, interventions sensibles, maintien de l’ordre etc.), des déclinaisons originales avec les expériences en Nouvelle-Calédonie (1980), au Kosovo (1999) et en Côte d’Ivoire (années 2000), Afghanistan (redécouverte de l’expérience de guerre) etc. Cet état des lieux confirme la diversité de l’engagement de la GM et de sa capacité d’adaptation. La dernière partie de l’ouvrage éclaire les enjeux et pratiques du MA d’après ses acteurs et offre une plongée au cœur de leurs perceptions et rend compte au plus près des réalités du terrain.
En conclusion, l’ouvrage s’articule autour de trois axes : la genèse et l’évolution historique de la GM, ses doctrines, ses pratiques et ses évolutions organisationnelles ainsi que la perception de ces actions dans la société. Il s’appuie sur des archives souvent inédites et des témoignages et propose une analyse fine, ciselée et transversale (histoire sociale, sociologie des institutions, droit public etc.). Quelques limites sont abordées dans l’ouvrage sur les trajectoires des gendarmes mobiles, leur vie quotidienne, leur participation aux OPEX (notamment dans un cycle « paix-crise-guerre-retour à la paix ») et une ouverture plus aux dispositifs étrangers aurait renforcé l’intérêt comparatif (sûrement dû à des contraintes éditoriales).
A toutes fins utiles, je joins un tableau de synthèse sur les liens possibles avec le programme de lycée.
| Chapitre du livre | Thème traité | Programme | Utilité pédagogique possible |
| Introduction : Maintenir l’ordre en démocratie | Définition du maintien de l’ordre, tension entre liberté et autorité | Terminale EMC – Thème « Libertés publiques et libertés individuelles » | Lancer une réflexion sur l’équilibre liberté/sécurité dans les sociétés démocratiques. Débattre des principes démocratiques. |
| Chapitre 2 : La naissance de la gendarmerie mobile (1919–1921) | Construction de l’État républicain après la Première Guerre mondiale | Terminale Histoire – « Fragilités des démocraties » (1918-1939) | Illustrer comment l’État français adapte ses institutions pour stabiliser la République après-guerre face aux troubles sociaux. |
| Chapitre 4 : La gendarmerie mobile dans les années 1930 | Réponses institutionnelles à la crise économique et sociale | Terminale Histoire – « La crise des années 1930 » | Travailler sur le rôle de l’État dans la gestion des mouvements sociaux, montée des extrêmes, et défense de l’ordre républicain. |
| Chapitre 6 : Mai 68 et l’évolution des doctrines du maintien de l’ordre | Contestation étudiante et ouvrière, modernisation des doctrines | Terminale Histoire – « La République face aux mutations sociales » | Comprendre Mai 68 au-delà des événements : analyser la réforme profonde de l’appareil sécuritaire. |
| Chapitre 7 : Le maintien de l’ordre en Outre-mer | Usage différencié de la force en métropole et dans les colonies/départements d’Outre-mer | Terminale Histoire – « Décolonisation et construction de nouveaux États » / EMC – égalité républicaine | Aborder la question des violences d’État et du rapport centre/périphérie dans l’application des principes républicains. |
| Chapitre 9 : Les mutations contemporaines (années 2000-2020) | Défis du maintien de l’ordre face aux nouvelles formes de contestation (ZAD, Gilets jaunes, écologie) | EMC Terminale – Libertés publiques / Histoire contemporaine Prépa | Actualiser les connaissances : analyser les tensions contemporaines autour du maintien de l’ordre et leur impact sur la démocratie. |
| Chapitre 10 : Gendarmerie mobile et droits de l’Homme | Encadrement juridique du maintien de l’ordre | Philosophie / EMC Terminale : Monopole de la violence légitime (Weber), respect des droits fondamentaux | Faire débattre sur les mécanismes démocratiques de contrôle de l’usage de la force publique. |