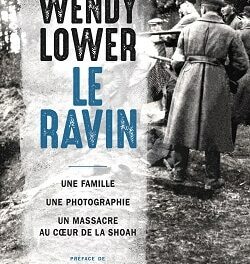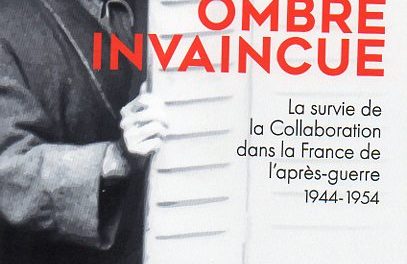« La consolidation du dialogue entre recherche et politique est le plus souvent perçue comme un développement positif, presque une évidence. » Pourtant, les résistances sont également nombreuses à la mise en place de politiques basées sur des faits scientifiques. C’est à ce paradoxe que s’attaquent Hugues Draelants et Sonia Revaz. « Loin de dépolitiser et de renforcer la légitimité et la confiance dans l’action publique » c’est au contraire un facteur supplémentaire de défiance dans l’action publique. Hugues Draelants est professeur de sociologie à l’Université de Louvain et membre du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l’éducation et la formation. Sonia Revaz est maître assistante à l’Université de Genève et membre du Groupe genevois d’analyse des politiques éducatives.
D’hier à aujourd’hui : apports et limites des statistiques
Les trois premiers chapitres se focalisent sur une mise en perspective historique. A partir du XIXe siècle, l’État comprend le profit qu’il peut tirer de statistiques et d’informations chiffrées précises. Tout cela s’est fait progressivement. A partir d’exemples de controverses dans le domaine médical, on se rend compte de la difficile articulation entre cas précis et régularités statistiques. Certains médecins au XIXe siècle se méfient des statistiques vues comme des menaces pour leur savoir. Les responsables politiques sont eux intéressés par l’instrument statistique car ils doivent toucher une large population.
La politique des preuves : nouveau chapitre de la raison statistique
Les principes de preuves qui concernaient au départ la santé sont ensuite utilisés dans d’autres domaines. Dans ce domaine, il faut savoir et définir l’EBM, soit l’evidence-based medicine. L’idée est que les connaissances générales puissent être utilisées pour traiter les cas individuels. Cela produit des résistances sur le terrain de la part d’acteurs qui se sentent dépossédés de leur domaine de compétence. L’EBM a néanmoins évolué. Il faut aussi resituer cela dans un contexte plus global qui est celui des politiques libérales. L’idée est que les politiques publiques peuvent être rationalisées, mais il y a loin entre théorie et pratique. On a donc un risque d’illusion de scientisme.
La politique des preuves en éducation
Il s’agit d’analyser pour mieux réguler. Auparavant, la réflexion portait sur les moyens mis en oeuvre, alors qu’aujourd’hui on se centre davantage sur les résultats à atteindre. En parallèle, on note également que la culture d’évaluation des systèmes éducatifs se développe à l’échelle internationale. Si les intentions d’améliorer du système éducatif sont louables, le nombre de biais qui existent pour décréter que telle ou telle politique est efficace sont nombreux. Un risque majeur est l’utilisation de la preuve pour fonder une politique publique alors que le lien de cause à effet est loin d’être certain. Plus important encore est le fait que, si les travaux montrent l’inutilité du redoublement, très peu donnent des pistes pour faire autrement. Encore plus essentiel est le fait que rien ne peut se faire sans les acteurs de terrain.
Les épreuves de réalité sur le terrain
Les auteurs s’attachent ensuite à comprendre pourquoi la politique des preuves ne peut se prévaloir, à ce jour, de résultats supérieurs à une politique classique. « Il ne s’agit ni de postuler que la statistique reflète la réalité objective, ni de dénoncer l’illusion qui se cache derrière toute production statistique, mais plutôt de s’intéresser aux épreuves de réalité ». Bruno Latour dit d’ailleurs qu’est « réel ce qui résiste dans l’épreuve ». Il faut aussi se rendre compte qu’au départ les statistiques étaient vues comme un outil d’aide à la décision, alors qu’elles sont parfois devenues une justification de la décision. Il faut plutôt aller vers une politique informée par la recherche et la pratique.
La suppression du redoublement en Belgique : un cas édifiant
Au départ on trouve un constat qui est que les dépenses produites par le redoublement des élèves induisent de l’inefficience et doivent donc être réduites. Plusieurs changements sont mis en place comme l’officialisation de la pédagogie différenciée, la définition d’un socle de compétences de base. Tout semble aller dans un sens positif, mais les enseignants, par exemple, n’ont pas été formés à différencier leur pédagogie alors qu’on les incite à le faire. Le passage automatique à la classe supérieure brouille la compréhension qu’ont les élèves sur ce qu’il faut acquérir pour progresser. Cela conduit alors à des rééquilibrages par exemple sur cette mesure.
Des épreuves de réalité aux épreuves de légitimité : une montée en généralité
« La thèse défendue dans ce livre est que les politiques inspirées par des données probantes se heurtent à des résistances ou plus précisément à des épreuves qui tiennent pour l’essentiel à une forme d’ignorance volontaire qui elle-même recouvre plusieurs aspects distincts ». Trois ont déjà été pointés à savoir l’ignorance des singularités, des processus causaux et de l’intuition. Les auteurs s’appuient sur un exemple lié à la politique de sécurité routière pour montrer le décalage entre les travaux et la perception des personnes. Faire appel à la science est utile, mais risque rapidement de clore le débat entre des informés et « les autres ». Le cas des vaccins est aussi envisagé : les parents qui hésitent à faire vacciner leur enfant sont plutôt en demande de davantage de science. S’ils se sentent caricaturés ou méprisés, cela ne peut que les braquer négativement. La politique des preuves a parfois tendance à oublier d’étudier les causes des phénomènes. Certes, on peut mettre en évidence le facteur vitesse dans les accidents de la route, mais on ne peut les réduire à cela. « La politisation des connaissances comporte pour la science un risque de délégitimation par association, l’instrumentalisation des sciences affectant au final la confiance du public dans la science ».
En conclusion, les auteurs précisent bien qu’il ne s’agit nullement de remettre en cause le principe d’une action publique guidée par la recherche. « Ce que nous questionnons est la définition trop exclusivement quantitative de ce que la politique des preuves considère comme preuve, l’oubli de ce que cette connaissance ignore via l’impasse faite sur les savoirs qualitatifs ainsi que les savoirs d’expérience ». Une dérive possible aussi est que l’action publique recourt à l’expertise scientifique pour se légitimer. Martyn Hammersley a cette formule : « même de bonnes connaissances au service de bonnes causes peuvent avoir des effets négatifs ».
Vous pouvez consulter également un entretien dans le café pédagogique ici.