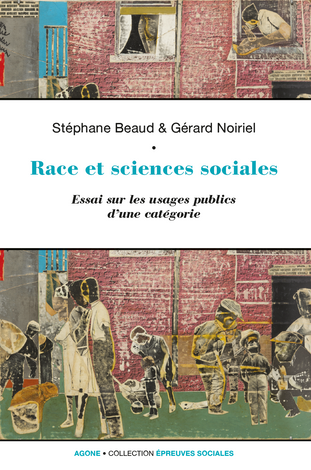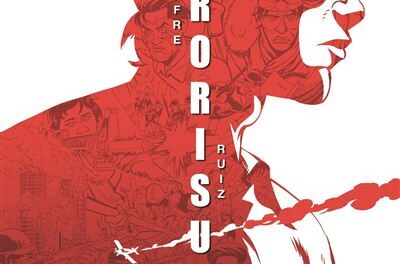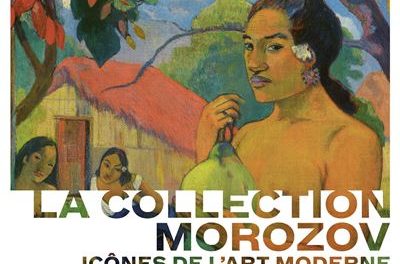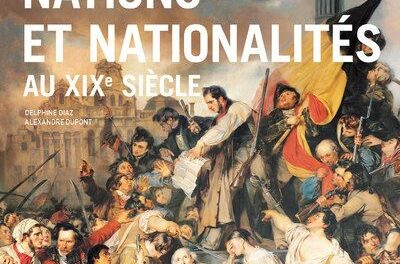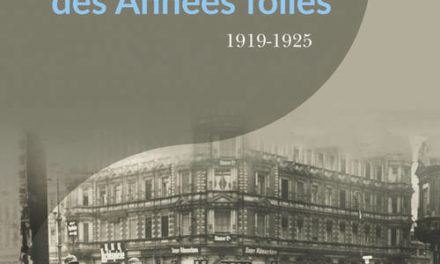Paru aux éditions Agone en février 2021, l’ouvrage corédigé par l’historien Gérard Noiriel et le sociologue Stéphane Beaud a, on le sait, suscité de nombreuses polémiques. Nous ne reviendrons ni sur le détail ni sur les acteurs de ces dernières car tel n’est pas ici notre propos. Cependant les réactions épidermiques provoquées par cette parution montrent la sensibilité et l’actualité vives de la question de la race tant dans le débat public que dans le cadre universitaire. L’ouvrage faut-il le rappeler s’intitule « Race et sciences sociales : Essai sur les usages publics d’une catégorie. » Les auteurs entendent analyser dans ce livre les relations entre le concept de race d’une part, et les sciences sociales d’autre part. Les rapports qu’entretiennent la première avec les secondes et vice-versa. Le sous-titre n’est pas sans importance puisqu’ils s’essaient réellement à faire sens et à dénouer l’écheveau de la pensée publique et académique française autour de cette catégorie de la race.
L’ouvrage est divisé en trois grandes parties. Dans l’introduction, Stéphane Beaud et Gérard Noiriel rappellent la genèse des débats médiatiques autour de la race. Le meurtre en mai 2020 aux États-Unis de l’afro-américain George Floyd par un policier blanc de Minneapolis. Un crime qui a soulevé « une vague immense d’émotion et de protestations dans le monde entier. » Partant de ce fait divers hyper-médiatisé, le sociologue et l’historien soulignent « la logique du système médiatique actuel [qui] explique le rôle majeur que joue la presse écrite dans l’orchestration des polémiques identitaires relayées ensuite par les grands médias audiovisuels. » Pour les deux universitaires, l’affaire George Floyd confirme ce processus. (Page 10)
Afin que le lecteur comprenne bien leur propos et surtout d’où ils s’expriment, Stéphane Beaud et Gérard Noiriel rappellent leurs parcours intellectuels respectifs et leurs « socialisations politiques ». Le premier a eu dix-huit ans en 1968 et s’est engagé très tôt durant ses études d’histoires dans les combats politiques de sa génération. Une expérience comme volontaire du service national en République populaire du Congo lui fait comprendre les réalités coloniales. Il est par la suite, nommé enseignant dans la banlieue de Longwy. Il y côtoie les ouvriers sidérurgistes et participe à leur révolte en 1978-79. Ses liens d’amitié avec des travailleurs immigrés lui font découvrir les « formes spécifiques de discrimination » que subissent ces deniers. Son expérience à Longwy forme plus tard la matière de sa thèse, soutenue en 1982. Son travail porte sur l’histoire ouvrière de la sidérurgie locale où « les questions d’immigration et d’intégration occupent une place centrale. »
Stéphane Beaud, de huit ans le cadet de Gérard Noiriel, appartient à la génération post-68. A l’issue de ses études supérieures « la question de l’immigration s’impose à lui comme un sujet majeur de préoccupation et de mobilisation civique. » (Page 14) Il est vite sensibilisé à la question du racisme anti-arabe après la flambée des crimes racistes en 1982-83 et l’émergence du Front National. En effet, nommé professeur stagiaire de sciences économiques et sociales dans un lycée du centre-ville de Dijon, il prend conscience du racisme anti-arabe « de certains élèves de la bonne société dijonnaise ou des banlieues ouvrières pavillonnaires. » (Page 14)
C’est donc forts de ces expériences significatives et sensibles que les deux hommes affirment de bonne foi (Page 15) : « « Au croisement des perspectives de classe et de « race », ce sont les situations sociales qui surgissent de ces histoires…..Plutôt que de chercher à rendre compte d’identités toutes faites, il s’est agi, au contraire de déconstruire les identités collectives pour revenir aux individus et montrer comment elles se construisent et se concrétisent dans la vie quotidienne des gens. »
L’introduction est également l’occasion pour les auteurs d’exposer un de leurs chevaux de bataille : La participation de certains chercheurs à la scène médiatique. Les deux hommes citent Pierre Bourdieu « quand il affirmait que les universitaires qui interviennent sur les questions d’actualité outrepassent leur rôle lorsqu’ils s’autorisent de la compétence (au sens juridique du terme) qui leur est socialement reconnue pour parler avec autorité bien au-delà des limites de leur compétence technique, en particulier dans le domaine politique. » (Page 18).
« Une sociohistoire de la catégorie de race »
La première partie leur permet de poser les jalons de la genèse du discours sur la race en France jusqu’à la moitié du siècle dernier. « Pour comprendre comment la race est devenue un objet d’étude pour les sciences sociales, il faut commencer par dire quelques mots sur les étapes historiques qui l’ont constitué en domaine du savoir. » écrivent-ils page 24.
Ils rappellent le lien à l’origine entre l’usage de ce mot et la catégorie sociale de la naissance noble. Initialement : « Le lien entre la race et l’origine d’une personne fut établi […] pour des motifs qui n’avaient rien à voir avec la question coloniale. » (Page 24). Notons au passage que le Code noir est un Édit et non une ordonnance et qu’il date de 1685 et non pas de 1684 comme l’écrivent les deux universitaires page 24. Ces derniers analysent en page 25 les barrières raciales en vigueur dans les colonies comme une fabrication de la noblesse selon sa propre logique : « dans le but de briser les velléités d’alliance entre les colons pauvres (statistiquement les plus nombreux), les esclaves, les noirs libres et les amérindiens. ». Ils font là une lecture marxiste des rapports de pouvoir dans les sociétés coloniales esclavagistes de l’Ancien régime.
Toute cette première partie amène le lecteur, à travers une galerie de personnages et leur concours à la construction de cette notion de race, à suivre le parcours et les avatars de cette notion, telle que perçue et utilisée par les scientifiques, les politiques et les philosophes. Sont évoqués, tour à tour Georges-Louis Leclerc de Buffon, l’abbé Grégoire, Napoléon 1er, Charles Dunoyer, Auguste Comte, Ernest Renan, Hyppolyte Taine, Francis Galton (où l’on apprend qu’il est le cousin de Darwin), Théodule Ribot, Edouard Drumont (on l’attendait presque.), Vacher de Lapouge, Alfred Bertillon (le frère de Jacques) et bien sûr Emile Durkheim (l’oncle de Marcel Mauss), Jules Ferry, Emile Zola…Mentionnerons-nous Louis Marin, Jean Giraudoux, André Siegfried, Maurice Halbwachs, Léon Blum, W.E.B Dubois et Frantz fanon ?…Que le dernier ferme la porte…
La période de Vichy puis le rôle des intellectuels de gauche et la redéfinition du racisme, perçu désormais sous l’angle des comportements individuels et non plus comme une idéologie politique (Page 136), viennent clore ce premier volet de la démonstration. Le lecteur parvient à la fin de cette première partie, quasi exténué par l’énumération de tant de personnages et le détail de leurs contributions diverses aux usages de la race. Ce défilé d’acteurs, politiques et scientifiques au lieu de clarifier le propos le rend en somme assez confus.
« Un tournant identitaire : autour de « classes » et « races »
C’est cependant d’un esprit confiant que l’on aborde la deuxième partie. Les deux auteurs se lancent alors dans une nouvelle forme de démonstration. Il s’agit maintenant d’« Expliquer comment et pourquoi l’hégémonie que les forces de gauche avaient réussi à construire après Mai 1968, en associant la lutte sociale et la lutte anti-raciste, s’est progressivement renversée au profit d’une droite identitaire qui domine, aujourd’hui encore la scène publique française. » (Page 141). Malgré nos efforts pour suivre le fil de cet exposé sur la race et les sciences sociales notre attention se perd dans la démonstration « de l’usage de la race en politique ». Dans cette sous-partie Noiriel et Beaud expliquent comment, selon eux, la race a peu à peu pris le pas dans les débats publics sur les problèmes sociaux. Notamment par une instrumentalisation de l’immigration. Les deux chercheurs prennent comme exemple l’affaire Djilali Ben Ali, un jeune parisien d’origine algérienne tué en octobre 1971 par un concierge d’un immeuble de la Goutte d’Or, quartier de Paris à forte population immigrée. (Page 147)
Beaud et Noiriel considèrent ce crime comme un tournant dans l’histoire de l’antiracisme. C’est l’occasion pour les deux universitaires de souligner l’insuffisance de l’angle racial pour expliquer un tel acte. Cette affaire révèle pour eux un décalage entre d’une part, la lecture de ce crime par les intellectuels et d’autre part celle de la famille de la victime. « Qualifier ce crime de « raciste », c’était aussi renvoyer publiquement les Ben Ali à leur seule identité arabe, ce que ne souhaitait pas la famille Ben Ali. » (Page 150) La sœur de la victime évoquant plus volontiers la jalousie comme motif du crime (Page 149).
Cette partie est aussi l’occasion d’évoquer la fin de l’année 1983 avec les attentats terroristes de Marseille, l’émergence dans le débat public du mot « djihad » et l’opportunité saisie, selon les auteurs, par la droite et l’extrême droite pour faire l’amalgame entre terrorisme et islam. Une stigmatisation visant les jeunes musulmans de France. La Une du Figaro est révélatrice de ce climat de montée du discours identitaire. Un phénomène que Beaud et Noiriel expliquent de nouveau par : « l’évolution du rapport de forces entre les classes sociales au cours de cette période » (Page 160). C’est à la même période qu’est publiée la « première thèse de sociologie consacrée au racisme : L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel. » C’est à ce travail de la sociologue Colette Guillaumin que nous devons le terme « racisé », très utilisé aujourd’hui pour désigner les victimes du racisme.
« L’affaire des quotas dans le football français (2011) »
Dans la troisième partie intitulée, Gérard Noiriel et Stéphane Beau enfoncent le clou, ou plutôt touchent au but. Dans cette dernière partie sous-titrée « Un scandale racial revisité par l’enquête » les deux chercheurs entendent essayer : « de montrer que cette affaire de quotas revêtait une dimension footballistique et institutionnelle dont l’histoire a été occultée ou niée dans la tourmente médiatique. » Et tous deux de préciser qu’ils : « montreront justement que les faits qui se sont révélés à travers cette affaire ne peuvent pas se comprendre à travers cette unique grille de lecture (« raciale ») qui cache autant de choses qu’elle en montre. » (Page 252). Le site d’informations Médiapart à l’origine de l’affaire est pointé pour lui : « avoir donné un cadrage exclusivement racial. » (Page 254). Les deux auteurs reconnaissent toutefois (page 253) les insuffisances de leur propre enquête et en expose les raisons. Ces lacunes dans leur démarche d’investigation sont essentiellement dues, selon les deux chercheurs, au fait que : « le football de haut niveau est un milieu très fermé, assez impénétrable aux enquêteurs qui ne sont pas des journalistes de football… » (Page 254).
Cette troisième partie, dense en exemples et explications sur la différence entre FFF (Fédération française de foot) et DTN (Direction technique nationale) et les différents modes de recrutement des jeunes footballeurs français, est également profuse en lectures des diverses acceptions du mot « Black » dans le monde du sport. L’on hausse tout de même le sourcil en lisant : « On a vu que l’emploi de ce mot de « blacks » est devenu courant dans le football professionnel, comme dans d’autres sports comme le basket-ball, l’athlétisme et surtout la boxe-où les appartenances populaires se conjuguent à des stéréotypisations raciales sans que ce ne soit nécessairement malveillant -, pour des raisons de morphologie sociale. […] Il faut aussi insister sur la nécessité de mettre en rapport les propos tenus et les situations de parole. Plus généralement, ce qui est en jeu dans ces différents types d’usage du mot « blacks » dans le milieu du football, c’est la question des désignations ethniques dans le langage populaire, qui a son autonomie propre. » (Page 346) Là encore Stéphane Beaud et Gérard Noiriel privilégient une lecture à travers le prisme de la classe sociale. Les deux chercheurs affirment ainsi : « Ils [les stigmatisés] expriment […] le ‘ nous’ des classes populaires, qui s’oppose aux ‘eux’, le monde des autres, un monde inconnu et souvent hostile qui, pour les plus pauvres ‘constitue un groupe occulte mais nombreux et puissant, qui dispose d’un pouvoir presque discrétionnaire sur l’ensemble de la vie. » S’il est évident et bien compris que le monde du sport et celui du football notamment ont leurs propres codes de langage et de comportements ; des codes qui croisent ceux des milieux populaires, je ne suis pas sure cependant que Stéphane Beaud et Gérard Noiriel soient conscients de la violence de la réalité qu’ils décrivent. Une violence d’autant plus terrible lorsqu’on relève la couleur des différents protagonistes. La couleur de ceux qui ont le pouvoir et celle de ceux qui ont intériorisé le stigmate et l’ont retourné (Cf. le sociologue américain Irving Goffman). Les premiers comme les seconds, il faut le souligner, privilégient le terme anglais « black » car le mot français « noir » pose encore problème. Il renvoie à des représentations qu’il faut tenir à distance. [NDLR]
CONCLUSION
Tout au long de cet ouvrage composite le discours de Stéphane Beaud et Gérard Noiriel ne cesse de glisser vers la lecture des faits que ces derniers maîtrisent le mieux. Celle de la « Lutte des classes ». Le lecteur est de fait, tout décontenancé après la démonstration longue et, à mon sens, assez laborieuse de la première partie d’atterrir de but en blanc dans le deuxième volet du livre qui s’ouvre sur la révolution prolétarienne et le concept « d’hégémonie culturelle » forgé par Antonio Gramsci. D’un coup nous voici dans « le combat de classe qui se prolonge dans les « superstructures » de la pensée marxiste. La troisième et dernière partie arrive aussi attendue, par la lectrice amateure de foot que je suis, qu’une finale de la Ligue des champions. C’est en effet là que la partie se joue et se conclue. L’affaire en 2011 des quotas dans le football français vient clore le propos et mettre tout le monde d’accord. Car, c’est bien connu lorsqu’il s’agit de foot, tout est affaire d’interprétation.
Race et sciences sociales omet dès les premières pages de définir son sujet, la « race ». La définition et le discours qu’en donne Ernest Renan : « La race comme nous l’entendons, nous autres historiens, est quelque chose qui se fait et se défait. […] Elle n’a pas d’application en politique » (Page 44) est, il faut le dire, aujourd’hui complètement dépassée. Manquant de pertinence, elle ne suffit pas à mener la démonstration à son terme d’une façon cohérente et satisfaisante. L’absence de définition claire et actualisée d’un des termes essentiels du sujet, ce dont les auteurs entendent traiter dans leur exposé, révèle en creux l’incapacité de certains universitaires français à penser la race comme concept. Et partant de la définir en des termes contemporains qui soient propres aux sciences humaines. A savoir, la « race » vu, avant tout, comme un ensemble de représentations, une construction, un outil conceptuel explicatif des rapports sociaux au même titre que les rapports de classe ou le genre. De fait au fil de la lecture on observe les différents acteurs sociaux et politiques réagir à l’émotion orchestrée par les médias et instrumentaliser des mots tels que : « immigration, antiracisme, beur, djihad… » qui disent l’air du temps. Comme les Gaulois du village d’Astérix ils s’étripent alors entre eux sous l’œil des caméras, sur la signification profonde à donner à tel événement, à tel terme sensible (forcément) et l’usage qu’il convient d’en faire. La race comme outil d’analyse et catégorie reste pour nombre d’entre eux, universitaires, politiques et acteurs sociaux une catégorie impensable. Pétris qu’ils sont de l’idée d’une République française universaliste essentiellement scindée en clivages sociaux et politiques. Tout au long de l’ouvrage, les deux auteurs soulignent, à juste titre, l’insuffisance de cette notion de race à expliquer seule les inégalités de traitement et les tensions sociales. Certes mais l’ennui est que, bien qu’encore difficilement concevable comme matière à penser par bien des chercheurs français, la race comme concept renvoie à des réalités bien concrètes de nos sociétés modernes et contemporaines. Des réalités incarnées dans le vécu de nombreuses personnes, prises tant comme individus que comme appartenant à une communauté. Cette catégorie de race n’est, bien entendu, pas la seule opérante comme facteur explicatif des inégalités et des discriminations. Toutefois occulter cette réalité, prégnante pour beaucoup, et asséner la prépondérance de la lutte des classes comme grille de lecture des tensions sociales revient du même coup à amputer ces dernières d’une de leur composante non négligeable et opérante pour une analyse qui soit réellement pertinente.