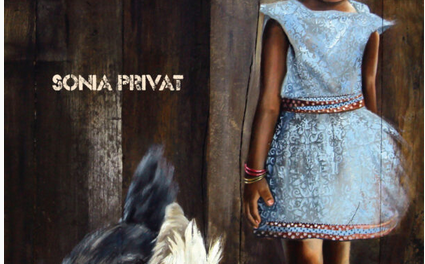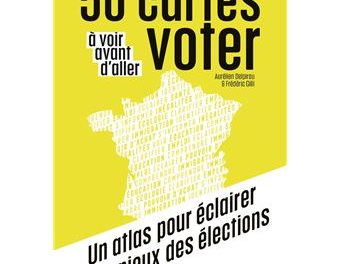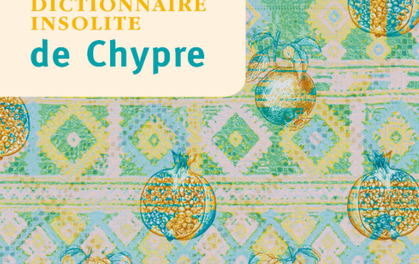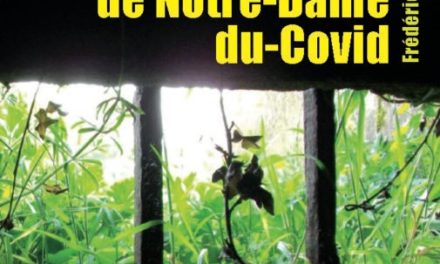Dans ce volume de la Documentation Photographique, Charlotte RUGGERI, agrégée, docteure en géographie et professeure en classes préparatoires, met en avant les grandes évolutions du territoire français : dynamiques de peuplement, littoraux, enjeux de la puissance française, intégration européenne et mondiale, mais aussi métropolisation, systèmes productifs, mobilités et questions environnementales.
« Le point sur »
Les différents territoires français, d’outre-mer compris, connaissent des situations bien différenciées. Aujourd’hui puissance moyenne, au passé colonial contesté, la France subit un vieillissement de sa population, un processus de métropolisation inabouti comme les conséquences du réchauffement climatique. Face à ces transitions à assumer, son aménagement est à la croisée des chemins.
Les espaces français offrent des paysages et des climats très variés. Les montagnes couvrent un tiers du territoire national. Le réseau hydrographique est assez dense, structuré part la présence de grands bassins versants. Les 551 695 km² de la France hexagonale bénéficient d’un climat océanique, avec des températures intermédiaires et des précipitations autour de 800 mm par an. Le territoire français est aussi composé de nombreuses îles, notamment dans les espaces ultra-marins qui présentent des particularités topographiques, géologiques et climatiques. Les espaces français sont donc diversifiés et offrent des cadres paysagers de plus en plus valorisés et recherchés. Ceci met en lumière l’un des principaux enjeux à l’œuvre, à savoir la difficulté de concilier leur mise en valeur et leur protection, d’autant plus dans un pays densément peuplé, dont les aménités paysagères sont de véritables facteurs de croissance démographique et d’attractivité touristique.
Selon l’INSEE, 32% des 68,6 millions de français vivent dans dans des espaces ruraux et 38% dans des espaces urbains. Entre ces deux catégories, les espaces aux densités intermédiaires abritent 30% de la population française. Si on observe la carte des densités de population en détail, on remarque des espaces plus denses dans les grandes vallées fluviales. Les littoraux apparaissent également comme des lieux de fixation privilégiés de la population. Les frontières aux densités aussi plus élevées jouent un rôle majeur dans les mobilités avec les pays voisins.
Finalement, ressortent les grandes villes et métropoles. Depuis les années 1980, la croissance urbaine française a été de 23%, soit 9 millions de personnes supplémentaires vivant dans les villes. Elles attirent toujours autant, malgré les évolutions connues après le Covid. A l’opposé, les espaces les moins dynamiques correspondent aux espaces hyper-ruraux combinant, selon Samuel Depraz, faibles densités (moins de 30 habitants par km²), une faible diversification économique, voire un déclin économique, et un éloignement des pôles urbains. Entre espaces urbains et espaces ruraux plus ou moins dynamiques, les espaces péri-urbains connaissent de profondes recompositions, notamment liées à l’étalement du bâti. Chaque année, 20 000 hectares sont artificialisés en France. Mais depuis la loi Climat et résilience de 2021, la France s’est engagée à réduire de moitié l’artificialisation des terres d’ici 2030, pour passer de 250 000 à 125 000 hectares sur une décennie. Ceci doit se faire grâce à l’objectif déjà controversé de « zéro artificialisation nette ».
Cette hétérogénéité pose des problèmes de gouvernance et de définition des compétences et des acteurs impliquées. Historiquement, la géographie administrative française repose sur la commune, le canton et le département. Se rejoutent dans les années 50, les régions dont les compétences ont été ensuite progressivement renforcées. Aussi a émergé l’échelon intercommunal. Ces deux derniers échelons, les plus récents, posent encore aujourd’hui des questions d’appropriation citoyenne. La crise des Gilets Jaunes a rappelé que la prise en compte des populations les plus vulnérables par la puissance publique était faible, malgré les volontés affichées de décentralisation. Par ailleurs, les conflits d’aménagement et plus largement les conflits territoriaux se multiplient. On assiste à la naissance de véritables territoires du conflit, à l’image des ZAD (Zone À Défendre). Ils ouvrent certainement des pistes de réflexions, notamment sur une autre manière d’aménager les espaces français, qui cherchent à rompre avec des décennies d’aménagement dirigiste.
Même si, à l’échelle internationale, la France est considérée comme un pays riche, les inégalités tendent à s’y creuser. Le taux de pauvreté est en hausse. D’un point de vue géographique, les territoires d’outre-mer sont parmi les plus pauvres du territoires français. Dans l’Hexagone, les départements du Nord ou du pourtour méditerranéen sont aussi parmi ceux où le taux de pauvreté est le plus élevé. Les espaces urbains fixent une pauvreté plus importante, mais sont aussi le lieu d’une forte concentration de richesses. Paris en est le meilleur exemple. Les espaces français ont accueilli de nombreuses politiques d’aménagement, qui ont à la fois contribué au développement économique du pays et à l’atténuation de certaines grandes disparités nationales. Toutefois, ces politiques ont aussi favorisé certains espaces. Ainsi, la volonté d’inscrire plus fortement les espaces français dans des logiques mondialisées à permis au pays de s’affirmer comme une puissance économique globale, cela a aussi contribué à creuser les disparités entre espaces, mais aussi les inégalités au sein de la population française.
Les politiques d’aménagement doivent également prendre en compte les enjeux environnementaux, car la France est un pays vulnérable. La hausse des températures a des effets sur les sols. En outre-mer, les ouragans et cyclones devraient quant à eux être de plus en plus puissants. Le quotidien des populations, les paysages et espaces français sont donc progressivement chamboulés par ces évolutions climatiques. Aujourd’hui, de nombreuses politiques de protection, à la fois d’un point de vue environnemental mais aussi face aux aléas et aux risques : parcs nationaux, loi Montagne, loi Littoral… Pourtant, la protection environnementale est loin d’être totalement acceptée et appropriée par les populations. Pour de nombreux acteurs locaux, ces initiatives sont parfois considères comme un frein à la délivrance de permis de construire ou au développement économique. La questions de l’acceptation sociale des espaces protégés est donc au cœur des enjeux e la protection environnementale.
« Thèmes et documents »
Elle illustre concrètement les points théoriques développés dans la première partie. Elle se divise en quatre chapitres : La France : territoire et population ; La diversification des espaces français ; La France face à la mondialisation ; La France en transition.
En raison d’un recul de la mortalité, d’un allongement de l’espérance de vie et d’une fécondité qui se porte assez bien, la population française n’a cessé de croitre depuis les années 1950. Mais depuis quelques années ce dynamisme est plus contrastée (p.20-21). Par contre, les dynamiques migratoires internes se sont stabilisées (p.22-23). Les espaces ruraux renouent avec la croissance démographique, notamment le périurbain, entraînant des problématiques de mobilités (p.26-27) avec les pôles urbains où se situent majoritairement les emplois. Les départements littoraux, alpins et du Sud-Ouest sont aussi les plus dynamiques avec de nombreuses conséquences sur le prix du foncier (exemple du pays Basque). Pôle migratoire de second rang (p.24-25), la France compte 7 millions de personnes immigrées, soit 10,3% de la population. Ils restent surtout concentrés dans les grandes villes.
Signe d’un haut degré de métropolisation, Paris (p.28-29) a accueilli les Jeux Olympiques en 2024. Mais le poids de Paris déséquilibre le réseau urbain français où les autres métropoles sont secondaires (p.30-31). Concernant les petites villes et les villes moyennes, les trajectoires sont très contrastées (p.32-33). Les plus grandes villes (p.34-35) sont marquées par des processus de ségrégation (exemples de Lyon) mais aussi de gentrification (exemple de Lille) et la périurbanisation (p.36-37). Enfin, les espaces ruraux devenus multifonctionnels (p.38-39) rassemblent 32% de la population.
La France est une puissance mondiale moyenne (p.44-45), au soft power surtout culturel (p.56-57). Elle a atteint son objectif d’accueillir plus de 100 millions de touristes en 2024 (p.46-47). Son espace maritime (2e domaine maritime mondial) est un enjeu de puissance (p.50-51). Mais ses espaces industriels sont en pleine mutation avec une recomposition marquée (p.52-53). L’agriculture est une activité fragilisée, également marquée par de fortes mutations (p.54-55).
Enfin la France est également en phase de transition face aux effets contrastés du changement climatique (p.58-59). De nombreux espaces vulnérables sont à protéger (p.60-61) par une législation parfois spécifique (p.62-63).
Complété par une rapide bibliographie classée selon les 4 thèmes développés dans l’ouvrage, ce volume de la Documentation Photographique fait le point sur les évolutions, les mutations, parfois sources de fragilités et qui poussent la France et ses habitants à s’adapter. Son principal intérêt est de fournir des données récentes et des documents réactualisés, qui seront à coup sur utiles pour nos cours sur la France au collège et au lycée.