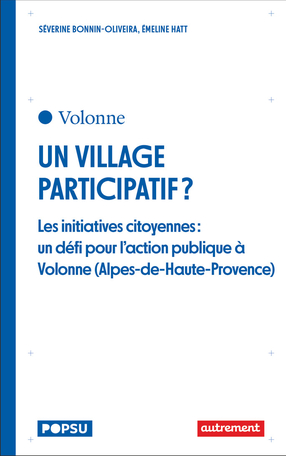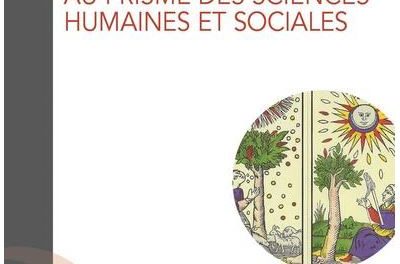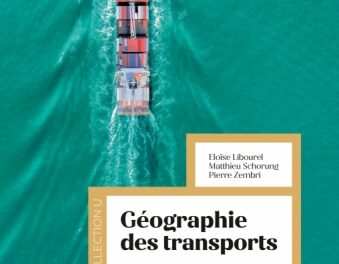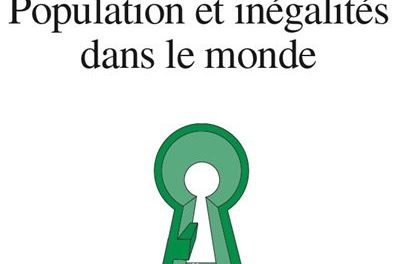Cet ouvrage traite de la recomposition entre acteurs publics et citoyens dans la conduite de projets d’urbanisme dans les petites villes, dans une petite ville : Volonne. Les autrices sont Séverine BONNIN-OLIVEIRA et Émeline HATT, maîtresses de conférences en aménagement et urbanisme, la première à l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université et la deuxième au sein du Laboratoire interdisciplinaire en environnement et urbanisme (LIEU).
Un contexte favorable aux initiatives citoyennes en milieu rural ?
La participation des citoyens dans la fabrique des politiques publiques, en particulier locales, est au cœur des débats. La crise de la démocratie représentative constitue en effet le terreau pour une démocratie plus participative, favorisant l’implication directe des citoyens dans les affaires publiques, à différentes phases et à travers des dispositifs variés. La participation est un levier pour restaurer une relation de confiance avec les citoyens, améliorer la cohésion sociale et favoriser des initiatives au service d’un urbanisme plus durable. D’abord réticentes face à ces initiatives citoyennes, de plus en plus de collectivités tendent à la reconnaître comme « porteuses de solutions d’avenir, d’énergie et d’inventivité dans un contexte de crises multiples face auxquelles les institutions se trouvent désarmées. Toutefois, les degrés de l’implication citoyenne sont encore variables : coproduction, coresponsabilité, codécision, cocréation ou encore cogestion.
Cette implication croissante des citoyens dans des initiatives de transition, ainsi que ses effets sur les modalités de définition et de conduite de l’action publique en la matière dans les petites villes, sont au centre de l’analyse du cas de Volonne, commune de 1 637 habitants située dans les Alpes-de-Haute-Provence en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Des initiatives citoyennes inscrites dans la transition socio-écologique
Les projets initiés par les habitants de Volonne accompagnent d’abord la requalification du centre-bourg en s’inscrivant au sein même du périmètre de l’Écoquartier, à l’image de la Gratuiterie installée face à la crèche. Ils se déploient ensuite plus largement dans l’ensemble du centre ancien, par le biais de la végétalisation des rues, de la restauration du patrimoine bâti, ou encore de l’installation de boîtes à livres. Ils maillent enfin le territoire de manière plus diffuse encore si l’on considère des projets comme l’aménagement du parcours de l’eau ou l’inventaire naturaliste, qui permettent d’investir l’ensemble de la commune. Ce « bouillonnement » citoyen (16 projets en moins de 10 ans) participe ainsi d’une forme d’essaimage, en ce sens que le déploiement isolé de chaque initiative finit par produire de la complémentarité et du lien sur le territoire à différentes échelles spatiales et temporelles.
Marquées par la dimension écologique, les initiatives volonnaises ne s’y limitent toutefois pas. Elles sont dans le même temps porteuses d’une vocation sociale et solidaire faisant du vivre ensemble un moteur de l’engagement. Par contre, les initiatives citoyennes d’économie plus collaborative sont limitées.
L’écosystème évolutif de l’engagement et du soutien aux initiatives citoyennes
Cet engagement citoyen appelle au déploiement de modes d’accompagnement agiles de la part de l’action publique. Les initiatives développées à Volonne s’inscrivent dans la continuité du projet municipal visant à « associer les habitants à l’aménagement par des méthodes différentes » dont l’Écoquartier en centre-bourg a constitué le premier jalon entre 2015 et 2020. La municipalité s’est appuyée sur une assistance à maîtrise d’ouvrage en développement durable (AMODD), afin de combler son déficit d’ingénierie en interne. Ce choix, qui souligne le besoin d’accompagnement des territoires ruraux pour transformer leur envie d’agir en capacité d’action.
3 formes différentes d’engagement citoyen ont été identifiées à Volonne : l’engagement « Post-it » court (cas du nettoyage du chemin rural) ; la constitution de groupes auto-organisés, autogérés et peu structurés sans leader formalisé (exemple de la Gratuiterie) ; un engagement « timbre » (de longue durée) et « affiliée » (marqué par l’adhésion à un groupe dans une association). Parallèlement, le rapport entre ces initiatives citoyennes et l’action publique (à plusieurs échelles) se décline selon 3 configurations : l’impulsion, l’accompagnement et le rattrapage.
Limites et perspectives pour un « village participatif »
Les difficultés organisationnelles et le risque d’essoufflement des citoyens rendent nécessaire une réflexion sur les leviers de sa pérennisation. Comment construire un village participatif, entendu comme « un espace de confiance entre les habitants et ceux qui les représentent [dans lequel] la commune change de posture en offrant la possibilité d’expression aux habitants [pour qu’ils participent à la vie et à l’esthétique de leur village ? »
Le manque de réactivité face aux demandes des porteurs d’initiative et la lenteur du développement des projets entre leur conception et leur réalisation sont les premiers à peser sur la dynamique citoyenne. Il peut générer une perte d’énergie et un essoufflement préjudiciables à la dynamique collective. Au-delà de ce manque de retour, c’est l’accompagnement et le suivi sur le long terme qui font parfois défaut, notamment lorsque les difficultés opérationnelles se présentent. Passé le temps de l’expérimentation, de l’effervescence et du bricolage, la collectivité comme les citoyens actifs se trouvent en quelque sorte au milieu du gué. Les différents acteurs se trouvent dépassés par une dynamique qui finit par sur-solliciter les 2 parties et qui met à l’épreuve les « conditions de survie » des projets. Il est possible de proposer des pistes de pérennisation du village participatif par la réalisation d’un « Livret de la participation citoyenne » rassemblant des outils qui facilitent la coordination ou la création d’une maison citoyenne, lieu de rencontre propice à la création de synergies entre les projets.
Cet ouvrage confirme le rôle essentiel de l’engagement citoyen, du bénévolat et des associations dans la cohésion territoriale en contexte rural. Ce dernier offre, à n’en pas douter, des atouts pour « bricoler », voire expérimenter, des solutions pour faire advenir la transition écologique. Pour autant, ce même contexte peut ensuite constituer un frein à la coconstruction de la transition socio-écologique et à la pérennité de la dynamique engagée, étant donné la faiblesse des moyens ou le manque d’ingénierie de projets. Pour les auteures, le cas volonnais ouvre donc des perceptives stimulantes autour des enjeux d’ingénierie, de montée en échelle et de mise en réseau.
Ressources pour compléter l’ouvrage :