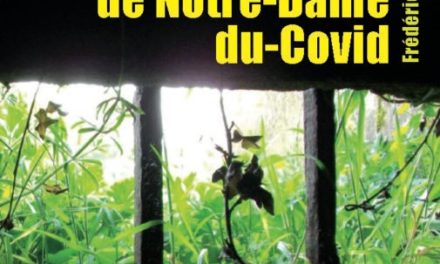Vendu au profit de ADDAx (Association pour le Développement Durable en Afrique et dans le monde), la lecture du dernier ouvrage de Sylvie Brunel, professeure de géographie à Paris IV, est à conseiller à tous ceux qui s’intéressent à ce continent. La limpidité de son écriture non dénuée d’humour et souvent empreinte de révolte rend particulièrement facile et stimulante sa lecture. Calqué sur le titre de l’ouvrage de René Dumont (L’Afrique noire est mal partie) paru en 1962, l’auteure se demande si les signaux que renvoie l’Afrique émergente peuvent permettre de généraliser cette vision optimiste à l’ensemble du continent.
Actuellement, trois représentations de l’Afrique se chevauchent : celle de l’Afrique de la misère, celle de l’Afrique exotique (des parcs naturels et des populations authentiques) et celle de l’émergence (qui affecte notamment l’Afrique du Sud, intégrée aux BRIC’S). « Encenser l’Afrique aujourd’hui paraît pourtant aussi excessif que l’accablement dont elle était hier l’objet. L’engouement qu’elle suscite est tout aussi caricatural que l’était le catastrophisme à tous crins des quinze ans qui ont suivi la fin de la guerre froide, avec l’effondrement en dominos de la plupart des Etats, minés par la crise de la dette, les rivalités politiques internes, l’instauration brutale du multipartisme sous l’influence des bailleurs de fonds, la baisse drastique de l’aide publique au développement. » (p. 12).
L’objet de l’ouvrage est donc de déconstruire les idées reçues qui circulent à propos du continent africain. « Les baobabs florissants exhibés par la presse et les magazines en quête de belles histoires masquent la forêt quotidienne, qui est celle de la lutte pour la survie de centaines de millions d’êtres humains que le reste du monde méprise ou ignore, à commencer par leurs propres concitoyens les plus nantis. » (p. 35). Pour cela, l’auteure examine tout au long de chapitres thématiques les paradoxes de ces 50 Afriques (50 pour montrer que la diversité l’emporte et que l’emploi du singulier n’a pas de raison d’être). Elle relativise aussi l’importance de l’épidémie Ebola au regard des autres fléaux qui touchent le continent : fièvre jaune, paludisme, maladie du sommeil, sida… Les progrès réalisés ne seront véritables que lorsque le taux de mortalité infantile sera passé sous le seuil symbolique des 50%0, actuellement celui de la majorité des pays en développement (pour mémoire : 111%0 en RDC). L’Afrique est aussi le continent de la faim, il suffit de se souvenir des émeutes de la faim l’ayant ébranlé en 2007-2008. Pourtant, ce ne sont pas les terres qui manquent mais une mise en valeur permettant des rendements suffisants pour nourrir une population en croissance exponentielle : « un décrochage de type malthusien entre la production et la demande » (p. 122). Seule la modernisation agraire doit permettre d’accroitre la production et ce n’est surement pas en confiant ces terres à des pays étrangers que les problèmes vont être réglés. « Pourtant, bien menée, avec des chartes éthiques et des codes de conduite respectés, des garanties données aux communautés rurales, ces concessions agricoles pourraient aussi représenter des opportunités car elles apportent les capitaux et les investissements qui manquent aux campagnes africaines et leur permettent de passer de systèmes extensifs à un intensif intelligent, avec le développement de l’agro-écologie, une rémunération équitable, l’essor de l’emploi et des opportunités de transformation sur place. » (p. 130). Dans ce tableau sombre, l’arc de crise sahélien comme les flux migratoires générés par la pauvreté et l’instabilité politique du continent ne sont pas oubliés.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de signes encourageants. « Le made in Africa émerge, avec la création de zones franches dans les pays les plus stables, comme l’Île Maurice ou l’Ethiopie, permettant de contourner les dispositions protectionnistes qui obèrent aujourd’hui les exportations chinoises à destination de l’Europe ou des Etats-Unis. » (p. 41) Mais, encore faut-il que « le made in Africa » soit un « made for Africa ». La Chine, « capable de prêter 5 milliards de dollars au seul Congo (RDC) pour avoir accès à ses gisements » (p. 45), a bien compris l’enjeu d’être présente sur ce continent. Ce modèle peu durable de développement, basé sur une économie minière et sur une logique de consommation, ne génère pas de création d’emplois permettant aux populations de sortir de la pauvreté : « une croissance sans le développement » (George Ayittey, 2011). L’essor des classes moyennes est toutefois une réalité : plus d’un Africain sur trois en fait partie (revenus situés entre 2 et 20 $/jour en parité de pouvoir d’achat). « Cette montée des classes moyennes offre donc des opportunités aux producteurs de biens et de services » (p. 115) : grandes chaînes de distribution, services bancaires, vendeurs de boissons, firmes de vêtements, firmes pharmaceutiques et cosmétiques, entreprises informatiques et de téléphonie.
L’ingérence écologique s’est substituée à l’ingérence économique (ayant conduit à la mise en place des plans drastiques d’ajustements structurels à partir des années 1980). « Le syndrome de Tarzan » fait des ravages en Afrique. En mettant sous cloche des espaces naturels, on oublie les populations autochtones qui y vivent. En leur interdisant de chasser ou de vivre dans ces espaces, ils sont contraints de se diriger vers les villes à la croissance exponentielle. « Le défi de l’urbanisation tient en quelques chiffres simples : en 1950, il n’existait aucune ville de plus d’un million d’habitants au sud du Sahara. En 2010, elles étaient trente-huit ! » (p. 103). Non seulement la capitale des pays attire les flux mais le réseau des villes petites et moyennes se renforce. Partout, la périurbanisation est une réalité. « Beaucoup de villages deviennent de gros bourgs, tandis qu’autour des villes, les banlieues s’étirent indéfiniment, marquées par l’imbrication des activités de services urbains et la persistance des champs cultivés. » (p. 104) : les périurbains continuant à garder « un pied dedans, un pied dehors » selon la formule de Jean-Louis Chaléard.
On retrouvera ici actualisés l’ensemble des éléments travaillés jusque là par Sylvie Brunel sous l’angle de la faim, du développement durable et présentés dans ses précédents ouvrages. « Une Afrique riche peuplée de pauvres et d’exclus n’est pas durable » (p. 171) et l’avenir de l’Afrique passe par son développement mais pour cela les défis à relever sont colossaux : accroissement de la productivité agricole, éducation et formation des populations, accès de tous à l’eau, faire face au changement climatique, mettre en place une bonne gouvernance. Mais comme le dit si bien Nkosazana Alamine-Zuma, présidente de la Commission de l’Union africaine de 2014 à 2016 : « Il faut des solutions africaines aux problèmes africains ».