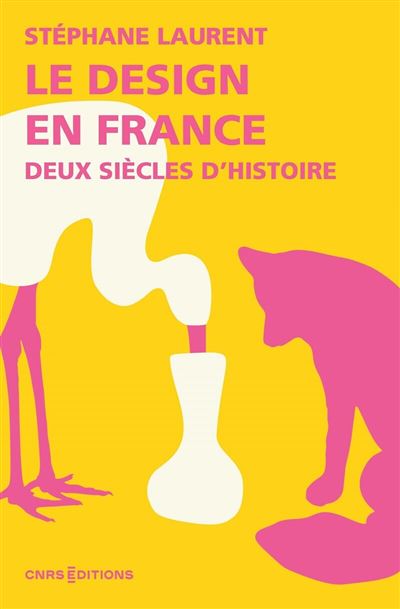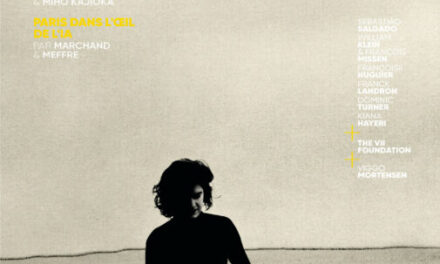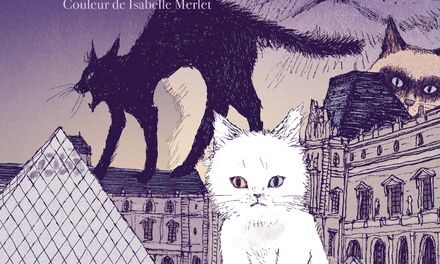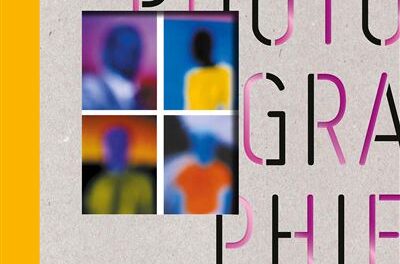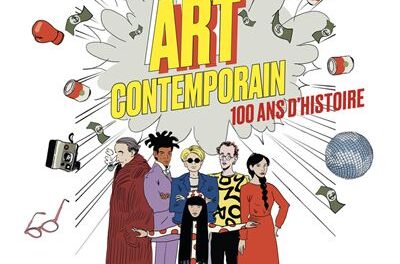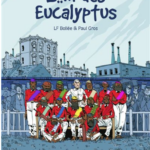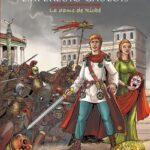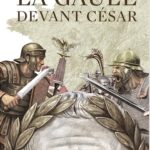Le design relève à la fois de la création artistique et de l’industrie, de la production de biens tout aussi esthétiques que répondant à des besoins. L’ouvrage de Stéphane Laurent, historien d’art, « Le design en France – Deux siècles d’histoire » retrace chronologiquement le développant de cette activité entre ses débuts balbutiants au milieu du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXIe siècle, du Portrait-médaillon de Philippe d’Orléans en verre (1685) au défilé de Haute Couture de la Maison Saint-Laurent sous la Tour Eiffel (2018) en passant par la Chaise 501 de Gaston Cavaillon (1961).
Une somme dense et richement illustrée qui brosse aussi les évolutions de la société française.
L’entrée dans la modernité
Les deux grands principes qui vont dominer toutes les époques sont la sérialité qui permet la production pour le plus grand nombre. L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (1751-1772) témoigne du bon usage de la fabrication. Au même moment Bachelier dans son école de dessin forme les premiers designers en 1766. Mais c’est au XIXe siècle naturellement que l’industrie d’art se développe par des procédés innovants. Des ingénieurs s’associent alors aux inventeurs et aux artistes.
Le mouvement est lancé et il trouve son public grâce à la publicité. Des designers s’emparent de ces nouveaux supports pour mettre en valeur des produits facilement identifiables par le consommateur -la bouteille de Perrier (1903) et celle de Coca-Cola (1915)-. L’Art Nouveau fait son entrée dans la sérialisation des produits grâce à l’automatisation des techniques traditionnelles de la verrerie (Daum, Gallé), de la céramique et du textile. Prenant conscience de ce renouveau, une loi de mars 1902 reconnaît les artistes industriels comme des auteurs avec des droits. Au moment de la Première Guerre mondiale, les artistes se lancent dans l’art de la dissimulation et du camouflage, l’invention des « arbres blindés » permet de mesurer la capacité des peintres français.
Continuation et accélération
Dans les années 1920, l’Art Déco reçoit le soutien des journalistes et des institutions ainsi que des Grands Magasins. Les Galeries Lafayette signent des contrats avec la cristallerie Baccarat et des ateliers de tapisserie à Aubusson. Raoul Dufy, Sonia Delaunay, Eileen Gray, Jeanne Lanvin, participent à cette tendance. Le Corbusier ouvre les espaces et banni les décors dans l’immobilier du quotidien. Paradoxalement, cette démocratisation est renforcée par la crise de 1929 qui oblige à renforcer la standardisation et la série pour faire baisser les coûts. Le design devient facteur de consommation en intégrant les innovations : luminaires avec l’électricité, mobilier avec l’usage du tube ou du formica… Le modèle 1935 de la moulinette presse-purée de Jean Mantelet en est le parfait exemple.
La période de la Reconstruction laisse le champ libre pour les Modernistes : tout est à faire à l’instar de la ville du Havre dans les mains d’Auguste Perret. Un programme de remeublement est lancé par l’État. Fabricants et décorateurs doivent équiper des millions de Français : bon marché, en série et à la machine. La population reste malgré tout attachée au style « rustique modernisé » qualifié aujourd’hui de « style Reconstruction« . Le bois y occupe toujours une place majeure dans des ensembles pour salle à manger et chambre à coucher. C’est une immense période d’inventions adaptées à un nouveau mode de vie : Vélosolex, chaussure en plastique La Méduse et verre gigogne Durdalex dès 1946. Le vaste champ d’innovation industriel s’appuie sur le design et la publicité dans les mains des Arts graphiques. La création du « Label Beauté France » (1953) devenu les « Janus de l’industrie » aujourd’hui encourage la fabrique de produits aux formes exemplaires.
Richesses et bouleversements
À partir des années 1960, les années pop, la consommation de masse devient un stimuli à la création. La modernisation de la distribution, l’explosion des exportations, l’usage intensif du plastique s’accompagnent de remise en cause et débats intellectuels. Roland Barthes, Henri Lefebvre et Jean Baudrillard interrogent leur époque. André Malraux au ministère de la Culture favorise la création. On assiste à un bouleversement des formes et techniques de fabrication, le meuble par exemple se doit d’être « démocratique et innovant« . Au même moment, Pierre Paulin équipe les appartements privés du couple Pompidou en 1968.
L’arrivée en masse de la jeunesse est un facteur de mutation. La bande dessinée, Le Livre de Poche, l’affiche qui trouve une seconde vie en Mai 1968 connaissent un nouveau dynamisme. L’État passe de grandes commandes. Il faut créer et meubler des établissements scolaires, livrer les collectivités, sortir de terre les villes nouvelles. En 1969 et 1971, sont respectivement inaugurées les stations RER Nation et Auber. Designers et artistes y laissent leur signature. Les très nombreux bureaux d’études qui sont des agences de design poussent aux styles fonctionnaliste et pop. La cabine de remontée mécanique Pomalgalski SP3, « Les oeufs » entre en fonction en 1967, synthèse de toutes les évolutions du design et de la société.
Ruptures et renouvellement
La 3e révolution industrielle oblige les marques françaises à davantage collaborer avec les bureaux d’étude pour se renouveler tel Thomson et Philippe Stark (1993-1997). La crise économique de 1973 provoque l’effondrement de pans entiers de l’industrie française et renforce la concurrence internationale. Le Salon des arts ménagers et des marques emblématiques comme Lipp sont emportés dans la tourmente. L’État ne redevient acteur qu’avec l’arrivée de la gauche au pouvoir. L’exposition « Le design français » au Centre Georges Pompidou (1988) mais surtout la rétrospective au Grand Palais (1993) « Design miroir du siècle » sont des vitrines d’un secteur fragile sur le terrain. Paradoxalement, le design d’expérimentation, l’art-design audacieux rencontre son public.
Aujourd’hui, si l’externalisation de la production est une réalité, les bureaux d’étude demeurent sur le territoire national. Ils permettent une collaboration efficace entre les ingénieurs, les commerciaux et les créatifs, ce qui est indispensable pour développer des produits « à la pointe de l’innovation « . La question environnementale est devenue un aspect incontournable dans la réflexion d’une jeune génération touche-à-tout, mondialisée mais encore anonyme.
Stéphane Laurent dans cette magistrale histoire du design français en dresse un portrait en demi-teinte. Le design français est fort d’atouts : sa capacité à intégrer le fonctionnalisme et l’innovation permanente ainsi que la mission sociale. Cependant, ces réussites doivent être tempérées par la très faible représentation internationale et le poids des multiples tutelles qui sont autant de freins à la mise en valeur d’un domaine d’excellence hexagonale.