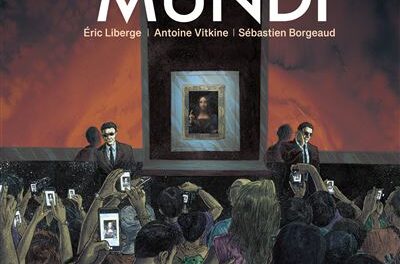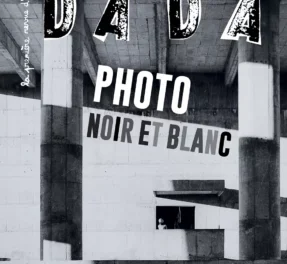Le musée du Luxembourg ouvre la saison avec une exposition « L’âge d’or de la peinture anglaise, de Reynolds à Turner ». Cette période féconde se situe sous l’ère géorgienne, soit des années 1720 jusqu’au début du règne de la reine Victoria, au milieu du XIXe siècle. Ce petit carnet d’exposition, selon le principe de la collection, s’ouvre sur quelques pages de dépliants pour apprécier les œuvres en plus grand format. Professeur à l’école du Louvre, Amandine Rabier, est historienne de l’art, spécialiste de la peinture anglaise. Sa thèse, non encore publiée, porte sur Henri Fuseli.
Une dizaine de petits chapitres illustre le propos pour explorer un thème d’une grande richesse. Ce carnet d’expo s’ouvre sur une question essentielle, existe-t-il un art anglais ? Alors qu’en France, l’Académie de peinture et de sculpture naît en 1648, il faut attendre un siècle plus tard pour que l’Academy of art voit le jour. George III (1760-1820) associe cette fondation à la construction de la nation anglaise. L’époque précédente, riche en événements (la Glorieuse Révolution (1688-1689), l’Union Act de 1707) s’attache plutôt à utiliser les artistes à des fins politiques ; le portrait exalte la grandeur du souverain. Charles Ier fait venir Rubens puis Van Dyck qui introduit le portrait en pied. Au milieu du XVIIIe, William Hogarth constitue une collection de peintures anglaises qui sert de base à des expositions fréquentées par une élite artistique puissante capable de faire rayonner la Grande-Bretagne à travers l’Europe. La jeune Academy qui comprend 38 artistes dont deux femmes, Mary Moser et Angelina Kauffmann, dispense des cours pratiques et théoriques. Selon le modèle continental, elle hiérarchise les genres, de la nature morte, en bas de l’échelle, au paysage, à la scène de genre, au portrait et enfin, la plus noble qui soit, la peinture d’histoire apte par ses sujets aussi bien religieux que mythologiques à élever l’âme exaltant le civisme et la morale. Paradoxe typiquement anglais, Joshua Reynolds, président de l’institution officielle, est un portraitiste et peu de mécènes commandent des œuvres du beau genre. De plus, les expositions de l’Academy sont payantes, ce qui entraine une dépendance vis à vis d’un public riche. Le pragmatisme l’emportera donc sur la théorie et la noblesse du portrait sera réévaluée par rapport aux autres genres. Reynold parle « de grand style » du portrait, valorisant les qualités morales et la beauté idéale du sujet. Il faut dire que le public cherche des modèles d’identification. Ainsi, des artistes proposent des peintures d’histoire sur des sujets contemporains comme des batailles navales ou terrestres, comme Benjamin West ou Singleton Copley. Prendre en compte le regard du spectateur pour lui donner des sensations et la recherche de l’effet deviennent les premières préoccupations des artistes. Le philosophe Edmund Burke distingue le beau du sublime. Le beau, lisse et délicat incarne une perfection sélective et le sublime transcende les passions et produit un effet sur les sens. Deux plaisirs du regard s’opèrent, le plaisir positif qui émane de l’expérience du beau et le plaisir négatif, lié à la douleur provoquée par le sublime. Les peintres de tous les genres, vont user du sublime burkien, introduisant une narration tragique. Stubb spectacularise la nature même dans ses peintures animalières. Les paysagistes associent des faits historiques pour rivaliser avec la peinture d’histoire. Turner introduit cette hybridation dans Le champ de bataille de Waterloo. Ainsi le paysage devient l’emblème de cette englishness représentée par Gainsborough et plus encore, Constable et Turner.
Le triomphe du portrait
Genre plébiscité par la société anglaise, le portrait correspond au « grand style » prôné par Reynolds, une idéalisation de la réalité afin d’ennoblir le sujet. Les attitudes de ses modèles copient la statuaire antique, tandis qu’à l’inverse Gainsborough, privilégie les couleurs chatoyantes. Ce dernier ose une touche brossée qu’on qualifiera d’inachevée.
La conversation piece ou l’intimité à l’anglaise
Un nouveau genre s’impose dans les années 1730, la conversation piece. Il synthétise le goût du portrait et celui de la scène de genre telle que la pratiquaient les peintres hollandais du XVIIe siècle comme Ter Borch, Metsu ou Mieris. Il s’agit de représenter un groupe familial dans un contexte privé. Les dimensions modestes des œuvres leur confèrent un caractère intime.
Le paysage, entre réel et idéal
La mode du Grand Tour au XVIIIe stimule le goût anglais pour les sites naturels. Voyageurs ou non, les artistes utilisent le paysage comme un laboratoire d’expérimentations. Grand itinérant et admirateur du Lorrain, Turner effectue une combinaison entre le paysage et l’histoire avec une liberté de touches qui représente bien l’un des traits dominants de la peinture anglaise.
L’art dans les colonies
Le traité de Paris de 1763 confirme la suprématie anglaise sur les mers. Certains artistes cèdent à l’appel du large et enchaînent les voyages. William Hodges, élève de Richard Wilson, transpose le paysage classique pour peindre une image paradisiaque des Indes, tandis que Johan Zoffany s’installe en Inde pour satisfaire une clientèle de nabobs, des membres de la société anglaise qui commandent « des souvenirs » pour leurs amis. De nouveaux sujets stimulent la production : des paysages exotiques colorés, des scènes de genre bigarrées.
Une histoire d’animaux
Publiée à partir de 1749, l’histoire naturelle de Buffon valorise la place des animaux par rapport aux humains. Ainsi les artistes anglais peignent les animaux comme les chevaux ou les chiens pour élever socialement leurs propriétaires. La chasse à courre ou les courses hippiques sont des sujets très prisés en rejoignant le genre appelé sporting painting, dont George Stubb est le maître incontesté.
L’aquarelle : un art de voyageur
Le développement de l’aquarelle suit celui du tourisme. Plus maniable que l’huile, l’aquarelle illustre les guides de voyage où apparait l’esthétisme du pittoresque divulgué par William Gilpin. Certains artistes combinent le goût de la campagne anglaise, la beauté accidentée des ruines et peignent des paysages imaginaires. Turner et Constable se plaisent à étudier les changements atmosphériques.
Rêves et visions
Henri Fuseli et William Blake explorent le domaine du rêve qui devient prétexte à un espace de création individuel. Ils constituent un répertoire de créatures récurrentes notamment le papillon, un être de passage vers un monde rêvé. L’imagination donne le pouvoir d’accéder à de nouveaux mondes.
Le spectacle de la peinture
La fin du XIXe et le début du XXe siècle sont des tournants dans l’histoire anglaise : la perte des colonies américaines, l’industrialisation suivie de l’urbanisation, l’impact de la Révolution française… le monde change. En art, le spectaculaire l’emporte sous toutes ses formes avec la recherche d’un effet visuel toujours plus saisissant. Les théâtres s’agrandissent et les salles de spectacles se multiplient. Leurs décors plus élaborés offrent même des versions panoramiques, inventées à Londres par Robert Parker. Cette période de mutation privilégie une iconographie de catastrophes et destructions où le sublime apparait. Turner, pionnier de cette peinture vertigineuse puise son inspiration dans les textes de la Genèse ou de l’apocalypse.
Shakespeare ou l’art de la liberté
Pour l’auteur de ce carnet, Shakespeare n’est pas célèbre, il est adoré. L’Angleterre protestante du XVIIIe siècle, privée d’images religieuses, voue un véritable culte à l’écrivain. Cette passion du public stimule les entreprises : les festivités du Shakespeare Jubilee en septembre 1769 et la création d’une Shakespeare Gallery en 1789, où sont vendues de luxueuses reproductions, devenues ensuite un patrimoine d’images qui sera une source d’inspiration pour les peintres romantiques à travers l’Europe. En France, les philosophes des lumières, Voltaire et Diderot, fustigent les écrits shakespeariens, qualifiés de barbares et de vulgaires. Plus tard, l’anglomanie gagne la France et Delacroix se peindra en Hamlet. Les artistes trouvent dans les héros passionnés un espace pour exprimer le grotesque comme le sublime, ce que les Anglais peignaient, 70 ans plus tôt. Non seulement, l’art anglais existe mais sa spécificité se diffuse ensuite sur le continent.
Si ce petit carnet guide le regard du spectateur visitant l’exposition, il s’avère aussi une bonne synthèse du sujet pour ceux qui n’auront pas ce plaisir. Vraiment pratique, le visuel des deux dernières pages regroupe les œuvres commentées. Il permet ainsi d’effectuer des recherches plus approfondies pour les plus passionnés.
A l’occasion de cette exposition, les éditions Gallimard rééditent le volume de la collection « Découvertes » sur le peintre William Turner, rédigé par Olivier Meslay, ancien conservateur du département des peintures au Musée du Louvre, aujourd’hui directeur du Clark Art Institute à Williamstown dans le Massachussets. Cette collection abondamment illustrée, choisit un angle particulier pour aborder la vie d’un artiste dont l’expérience artistique est largement documentée.