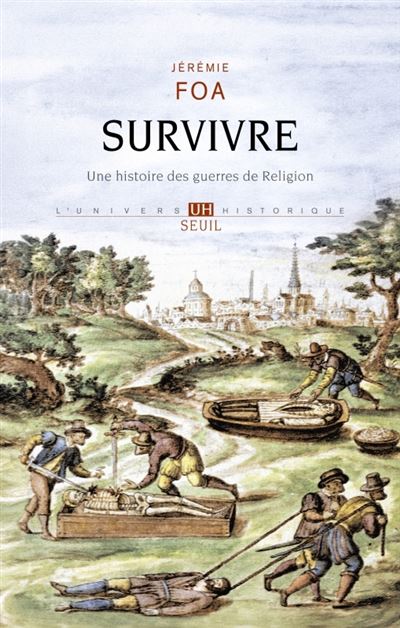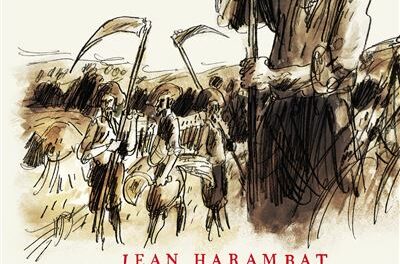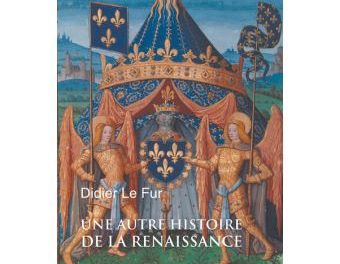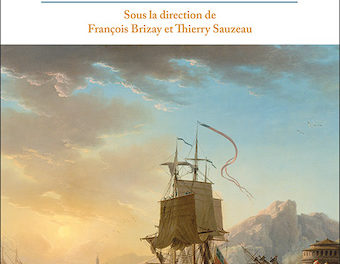Dans cet ouvrage brillant et foisonnant, Jérémie Foa s’intéresse à la question de la survie en temps de guerre civile, en l’occurrence les guerres de Religion (1562 – 1598), cherchant à restituer au mieux ce que fut l’expérience concrète des « tristes hommes d’après 1560 » face à une situation de stasis qui ébranle en profondeur leur monde. Dans la lignée de Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy, c’est du ras du sol, sur « l’humus où les idées tombent du ciel et s’incarnent », que Jérémie Foa a travaillé à partir des chroniques contemporaines – avec d’ailleurs pour postulat de départ une citation de Montaigne, et d’un matériau archivistique en partie inédit. Cet ouvrage s’inscrit donc dans une perspective micro-historique, mettant à distance grands évènements et problèmes de grands, pour se focaliser sur des situations, des face-à-face d’acteurs, dont le quotidien s’apparente désormais à une incertitude radicale et où la vie ordinaire devient littéralement impossible, quand la guerre éreinte et détruit les fondements familiers de la société, de la sociabilité, de l’intimité familiale. Constamment au bord de l’abîme dans un conflit où il est illusoire de distinguer un ennemi d’un ami, où rien ne ressemble plus à un protestant qu’à un catholique, un royaliste à un ligueur, les hommes et les femmes de ces temps chaotiques n’ont d’autre choix pour survivre que d’afficher les apparences de la normalité, au prix de ruses, mensonges et travestissements permanents. En cela, les guerres de Religion, qui contribuent de manière décisive à la construction des identités religieuses, abîment paradoxalement les âmes, la violence des temps contraignant à dissocier sans cesse la confession affichée des convictions intimes, concourant ainsi à une relativisation du religieux et ouvrant la voie à un détachement de Dieu.
Le livre de Jérémie Foa s’articule en quatre parties construites à partir des doutes et des angoisses qui parcourent cette longue période de crise, où rien n’est plus tout à fait ce qu’il devrait être et où la perspective d’un retour de la paix et de la stabilité n’est qu’un espoir lointain. Face à un ennemi omniprésent et invisible, il y a d’abord doute sur les personnes, dont le « qui vive ? » expression inlassablement répétée durant les troubles, est le cri symptomatique. Parce qu’il n’y a pas, comme dans un conflit classique de distinction entre un « front » et un « arrière », l’espace, urbain en particulier, se transforme lui aussi, et les territoires du quotidien deviennent à leur tour menaçants sous l’effet d’une fragmentation incessante. Autrement dit, pour survivre, il faut savoir se repérer dans une véritable mosaïque spatiale et une myriade d’interfaces, sans certitude d’être pour autant en sécurité chez soi, alors que les perquisitions sont légion dans un monde obsédé par la transparence et l’explicitation comme corollaire de la simulation et de la dissimulation. La défiance s’étend même aux objets : quand il y a suspicion continuelle à l’égard des gens, on attend des objets qu’ils révèlent les identités réelles et les intentions cachées, sans toutefois occulter le fait qu’eux-mêmes ne sont pas nécessairement ce qu’ils paraissent être. La stasis imprime donc un rapport pour le moins singulier aux choses, entre confiance excessive et appréhension profonde, désir d’être assuré et crainte d’être berné. Enfin, les doutes des contemporains s’étendent jusqu’aux mots dans un conflit où l’adversaire maîtrise la langue. Il faut par conséquent opacifier son discours que ce soit pour se protéger, pour disqualifier, pour exprimer l’indicible ou pour taire l’insoutenable. Mais sous l’effet des coups de boutoir qui lui sont sans cesse portés, la langue —redoutable alliée pour ceux qui en maitrisent toutes les subtilités en temps de troubles — se fragilise sur fond de multiples flottements sémantiques, nécessitant tout un travail d’apaisement et de simplification linguistique dans le premier tiers du xviie siècle.
Au final, l’ouvrage de Jérémie Foa soulève, via « le tremblé du quotidien » de vastes questions, dont certaines très actuelles. Comment se retrouver dans un monde où le mensonge l’emporte sur la vérité ? Comment reconstruire une cohésion sociale après une épreuve d’une violence aussi radicale ? Comment se conduire quand l’État est affaibli et délégitimé ? À ces questions importantes, Jérémie Foa ne prétend pas apporter de réponse définitive, mais donne à voir les solutions trouvées par des hommes et des femmes confrontés à ces problèmes. Les humbles acteurs de cet ouvrage, enfants d’une « Renaissance perdue », ne doivent leur survie qu’à un usage massif du mensonge, à une culture du secret et à une aptitude à la ruse et à la triche, apanage d’un quotidien fait davantage d’épreuves de réalité et de justice que de pures épreuves de force face à une violence certes inouïe, mais ponctuelle. Pour faire tomber le masque de l’hypocrisie ambiante, l’arme la plus efficace réside dans l’esprit critique des contemporains, avec une élévation indéniable de leur seuil de réflexivité afin de s’adapter à un monde foncièrement insincère. C’est ce « règne de la critique » qui les épuise littéralement, bien plus que les désordres et les exactions, par la remise en cause incessante de tous et de tout. Ce sentiment d’épuisement irrigue d’ailleurs l’ensemble de l’ouvrage, engendrant l’impression d’une période étouffante pour ceux qui l’ont vécus, mais qui a également joué un rôle dans la genèse de l’individu moderne, capable, tel une huître, de s’ouvrir au monde en se conformant à ce qu’on attend de lui, et de se fermer sur lui-même pour préserver ce qu’il est vraiment.