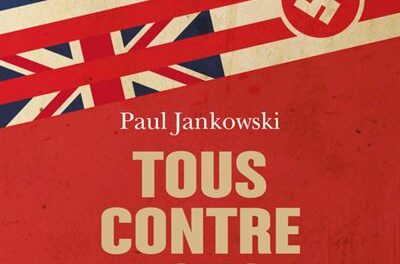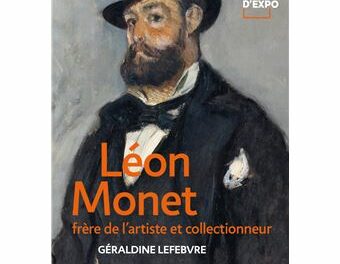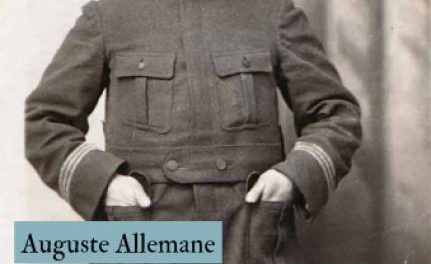S’il se situe bien dans le champ de l’histoire sociale, au sens large, ce numéro du Mouvement social regroupe des articles portant sur des sujets très divers : l’histoire de l’Etat social en France, celle des combattants de la Première Guerre mondiale et de la guerre d’indépendance algérienne, celle des luttes sociales en Argentine au XXe siècle et enfin celle du socialisme utopiqueLe sommaire détaillé et complet est disponible sur le site de la revue, http://www.lemouvementsocial.net/, et sur CAIRN, https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social.htm.
« Cols blancs et Etat-providence en France »
Sous ce titre sont regroupés l’éditorial de Patrick Fridenson, intitulé « Ce que la société et la politique font aux (petits) cols blancs » et deux articles : « La grande distribution et le repos dominical. Aux origines d’une controverse vieille de 45 ans » de Tristan Jacques et «État-providence, rationalisation bureaucratique et traitement du social : l’« efficacité » des caisses de Sécurité sociale et de leurs agents en question (1945-années 1980) » de Christophe Capuano.
Comme le souligne Patrick Fridenson dans son éditorial, ces trois articles viennent opportunément apporter un éclairage historien aux débats sur la « nécessaire réforme » de l’Etat social tel qu’il s’est construit en France depuis le XIXe siècle. Après avoir rappelé les origines de la législation sur le repos dominical en France (loi de 1906 en particulier), bien connue grâce, notamment, aux travaux de Robert Beck, Tristan Jacques, qui prépare une thèse sur « Les relations entre l’Etat et la Grande distribution en France » entre 1958 et 1996, montre comment les termes du débat actuel sur l’ouverture des grandes surfaces le dimanche sont en place dès les années 1970 avec l’affrontement entre les mêmes acteurs qu’aujourd’hui et la même attitude hésitante de l’Etat qui peine à jouer son rôle d’arbitre :
« En premier lieu figure le constat, toujours récurrent, de la réticence du pouvoir politique à trancher dans un sens ou dans l’autre, celui-ci préférant ménager la colère des petits commerçants confrontés à leur déclin, les revendications syndicales des travailleurs, l’exigence des consommateurs, et la pression de distributeurs de plus en plus puissants. L’arbitrage politique qui en résulte oblige à s’en remettre à des solutions réglementaires au coup par coup, opportunistes et toujours dans la demi-mesure. »p. 29.
Christophe Capuano, maître de conférences à l’Université de Lyon 2 et membre du LAHRA, auteur notamment d’un livre sur la politique familiale du régime de VichyCAPUANO Christophe, Vichy et la famille. Réalités et faux-semblants d’une politique publique, Rennes, PUR, 2009, 356 pages., livre une étude neuve sur les agents de la sécurité sociale et leur travail entre 1945 et les années 1980. La matière principale de sa documentation est constituée de témoignages de retraités des caisses de Bourgogne et de Franche-Comté, ce qui donne assurément à l’article de Christophe Capuano une « saveur » particulière. Une des vertus de cette étude, au-delà de ses apports en termes historiographiques, est la « mise en histoire » de certains clichés, par exemple à propos de la productivité, de l’efficacité et de l’investissement dans le travail du personnel de la sécurité sociale.
« Histoires et mémoires de soldats »
Deux articles, pouvant intéresser plus directement les enseignants du secondaire, portent sur les combattants de deux conflits majeurs du XXe siècle. Dans « Quelle mémoire pour les soldats alsaciens-lorrains de la Grande Guerre », Raphaël Georges, doctorant à l’Université de Strasbourg[http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=13762->http://ea3400.unistra.fr/index.php?id=13762], montre comment la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale est intégrée à la mémoire nationale française après la 1918. Pourtant, la très grande majorité des soldats alsaciens-lorrains (environ 300 000) a combattu sous l’uniforme allemand : « On estime que 17 500 Alsaciens-Lorrains se sont engagés volontairement dans l’armée française au cours de la guerre, parmi lesquels quelque 12 000, qui se trouvaient en France depuis plus ou moins longtemps au moment de l’entrée en guerre, choisissent d’y rester et de s’engager, tandis qu’environ 3 000 auraient fui la mobilisation allemande quand celle-ci s’est précisée. Le reste est constitué des prisonniers de guerre et des hommes mobilisables capturés par les troupes françaises lors des offensives en Alsace en août 1914, qui décident également de s’engager plutôt que de rester internés. »p. 59, note. Les choix faits lors de l’érection des monuments aux morts constituent l’aspect le plus frappant de ce qu’on pourrait qualifier de « dégermanisation » de la mémoire de la guerre :
« Comme partout en France, les communes d’Alsace et de Moselle entreprennent d’ériger leur monument aux morts. Or nombre d’entre elles ne comptent de morts que dans les rangs allemands et, là où on en trouve, les « morts pour la France » sont minoritaires. Dans ce contexte, il est tout aussi inapproprié de faire figurer des symboles patriotiques français sur les monuments aux morts qu’inconcevable d’y porter des motifs allemands. On s’accorde donc, le plus souvent, sur des formes et des inscriptions neutres. Les formules les plus fréquentes contiennent le nom de la commune sous la forme : « La commune de… à ses morts » ou « Aux enfants de… » ; voire s’en tiennent au sobre « A nos morts ». Par souci d’égalité, les listes de noms ne distinguent pas l’armée d’appartenance, la mort des uns n’étant pas rendue plus glorieuse que celle des autres. De cette manière, on évite aussi de souligner la disproportion du nombre des soldats tombés sous l’uniforme allemand. […] Finalement, rien ne laisse paraître l’armée d’appartenance. Certains monuments sont même trompeurs. À Strasbourg, ancienne capitale du Reichsland, il faut attendre 1936 pour voir apparaître le monument aux morts municipal. Un premier « monument des morts » est néanmoins érigé dès 1919 pour commémorer les Poilus tombés pour la victoire, sous la forme d’un obélisque portant l’inscription « Aux morts pour la patrie » enserrée entre une croix de guerre et le symbole « RF » de la République française. À Phalsbourg (Moselle), le monument élevé en 1919 porte : « Aux Phalsbourgeois et leurs enfants morts pour la France 1914-1918 ». Ailleurs, des communes érigent des monuments surmontés d’un coq gaulois ou d’une statue de Jeanne d’Arc, « sainte de la patrie », figure consensuelle interprétable au choix comme symbole patriotique ou religieux. »p. 63-64.
Marc Giovaninetti, dans « Le Parti communiste français et les soldats du contingent pendant la guerre d’Algérie : prôner l’insoumission ou accepter la mobilisation ? », revient sur la question des atermoiements du PCF face à la guerre d’indépendance algérienne. Auteur d’une thèse soutenue en 2009 sur Raymond Guyot, responsable des questions militaires au PCF à cette époque, Marc Giovaninetti était bien placé pour aborder cette question et approfondir un sujet par ailleurs abordé par Tramor Quemeneur dans sa thèseQUEMENEUR Tramor, Une guerre sans « non » ? : insoumissions, refus d’obéissance et désertions de soldats français pendant la guerre d’Algérie : 1954-1962, sous la direction de Benjamin Stora, Université de Paris 8, 2007.. Il a repéré près de 40 cas de militants communistes qui ont pris le risque de refuser d’accomplir leur service en Algérie et ont été, pour la plupart, condamnés à deux ans de détention, ce qui ne les dispense pas d’avoir à accomplir leur devoir militaire ensuite. Le parti hésite entre trois attitudes : dans un premier temps il s’en tient au silence, quitte à laisser les militants et les organisations « satellites » aider et défendre les insoumis, dans un deuxième temps, il choisit le soutien actif, sans inviter clairement tous les jeunes appelés communistes à faire le choix de l’insoumission, avant, dans un troisième temps, de tenir un discours de réprobation. Comme le montre bien Marc Giovaninetti, ces atermoiements tiennent principalement au contexte politique (le soutien au gouvernement Mollet en 1956 en particulier), aux hésitations de Maurice Thorez et à la doctrine léniniste. En 1959, Thorez, dans un discours prononcé devant la conférence de la fédération de Paris du PCF et reproduit dans L’Humanité, sans condamner les insoumis, explique : « Il reste que nous devons non seulement penser à ces camarades, mais penser à l’ensemble des soldats, et ne pas revenir, c’est notre avis, sur les principes définis par Lénine : le soldat communiste part à toutes les guerres, même à une guerre réactionnaire, pour y poursuivre la lutte contre la guerre. Il travaille là où il est placé »Cité p. 90.. Ce revirement de Thorez, qui ne se double pas, cependant, d’une condamnation ferme ou d’une exclusion des insoumis, est plus ou bien vécu par les principaux intéressés, sur le moment et par la suite. Plus généralement, les anciens combattants communistes regrettaient, lors d’une rencontre organisée en 2004 au siège du parti, de ne pas avoir été clairement encadrés et « guidés » par leur parti pendant la guerre : « Plusieurs vétérans, jeunes militaires anonymes de la fin des années 1950, s’adressèrent alors à leurs ex-dirigeantsIl s’agit des dirigeants des Jeunesses communistes à l’époque de la guerre d’Algérie. avec amertume, encore meurtris par les épreuves et les indécisions qu’ils avaient vécues. Ils leur reprochaient de n’avoir pas formulé de consignes précises à l’époque de leur service militaire alors qu’ils étaient envoyés combattre au sud de la Méditerranée, ni dans le sens de l’insoumission, ni pour les guider dans leur « action de masse » auprès de leurs camarades de régiment. »p. 76.
Au-delà des frontières de la France
Dans une partie intitulée « Organiser le travail dans l’Argentine contemporaine », ce numéro du Mouvement social donne à lire deux études sur le syndicalisme et les luttes sociales en Argentine. Marcos Schiavi, docteur en histoire de L’Université de Buenos Aires, propose une nouvelle lecture des relations entre le mouvement syndical argentin, représentée par le CGT argentine, et le régime péroniste dans un article intitulé « Mouvement syndical et péronisme (1943-1955) : pour une nouvelle interprétation. » Pia Valeria Rius s’intéresse quant à elle aux mouvements des piqueteros qui se sont développés dans les années 1990 et 2000 dans une étude intitulée « Les contours pluriels de la notion de travail. Activités solidaires et productives des mouvements piqueteros argentins (années 1990-2000). » Le terme piqueteros apparaît au cours des années 1990 pour désigner les mouvements sociaux qui se sont développés à l’occasion de la crise que connaît alors l’Argentine et dont le mode de protestation le plus courant consiste à bloquer les routes par des piquetes, c’est-à-dire des piquets de grève.
Enfin, dans « Les admirateurs catalans d’Étienne Cabet : républicains et communistes à Barcelone, 1838-1856 », Genís Barnosell Jorda, de l’Université de Gérone, présente le groupe des disciplines catalans d’Etienne Cabet qui s’est formé à Barcelone, pour l’essentiel, entre les années 1830 et 1850, et plus largement l’influence de Cabet en Catalogne. Pour ce faire, il s’attache en particulier à étudier les relations entre deux Catalans, Abdon Terradas et Narcis Monturiol, d’un côté, et la pensée et la personne d’Etienne Cabet, de l’autre. On peut aussi lire dans ce même numéro du Mouvement social, en complément de l’article de Genís Barnosell Jorda, deux longs comptes-rendus de lecture rédigés par Vincent Robert : le premier est consacré à la biographie d’Etienne Cabet écrite par François Fourn et publiée en 2014 (p. 162-166)FOURN François, Étienne Cabet ou le temps de l’utopie, Paris, Vendémiaire, 2014, 348 pages. et l’autre au livre de Michel Cordillot, Utopistes et exilés du nouveau monde. Des Français aux États-Unis, de 1848 à la Commune, publié chez Vendémiaire en 2013 (p. 166-168)CORDILLOT Michel, Utopistes et exilés du nouveau monde. Des Français aux États-Unis, de 1848 à la Commune, Paris, Vendémiaire, 2013, 379 pages..