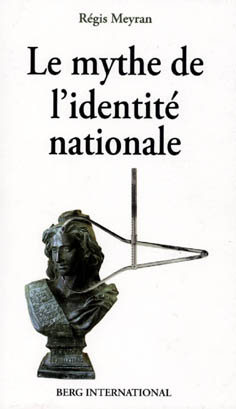La création d’un ministère de l’immigration et de l’identité nationale en 2007 a eu pour effet de présenter cette notion comme une évidence est une réalité bien établie.
Pourtant nul n’a vraiment une idée assez précise du sens que recouvre cette notion. Si une nation est un ensemble hétéroclite de populations regroupées sur un territoire, marqué du sceau de la nationalité, il est beaucoup moins évident de préciser « identité » de cette population comprise comme collectif.
L’expression d’identité nationale a été popularisée dans l’espace public par Jean-Marie Le Pen au cours des années 1980. L’identité nationale se définissait alors en négatif, opposant les Français de souche à ce qu’il y avait une autre identité, à savoir les immigrés.
Pourtant les débats sur ce sujet, d’après l’auteur, sont déjà assez anciens et ont opposé un milieu assez composite, celui des anthropologues.
D’après Régis Meyran, ils se divisent en plusieurs écoles : les racialistes, ceux qui pratiquent l’anthropologie physique, auxquels viennent s’ajouter les médecins eugénistes. Ils s’opposent à ce que l’on pourrait qualifier d’ethnologues qui s’occupent de faits culturels et des nébuleuses de folkloristes et d’érudits locaux.
Dans cet ouvrage, l’auteur étudie un réseau savant, porteur d’une vision du monde particulière. Le sentiment d’identité nationale, le sentiment diffus d’appartenir à une communauté de destin, existe sans doute joue de l’île de sein d’un État – nation. Toutefois, ce sentiment a pu être manipulé au gré des idéologies dominantes. Au nom d’une certaine conception de la science, les anthropologues ont pu élaborer une mythologie perméable aux idées du moment, ce n’est pas tout simplement à leur service. Au-delà de la conception physique, permettant de différencier les groupes ethniques, pour ne pas dire raciaux, les ethnologues ont introduit le mythe d’une identité aux nationale, en s’appuyant sur des références historiques. Ces récits mythiques définissent en négatif ceux qui ne sont pas des Français, les immigrés mais aussi les nationaux de fraîche date selon la race et les traditions ne sont pas « compatibles ».
Dans la première partie de l’ouvrage, Régis Meyran traite de race d’identité nationale. Il montre comment la société d’anthropologie de Paris, avec l’apparition des sciences de l’homme, s’est développée la tendance à procéder à des mesures permettant de définir un type racial spécifique. Les concepts sont restés, pour certains d’entre eux dans la mémoire collective : l’âge mental, le coefficient intellectuel, l’indice céphalique. De multiples outils permettaient de procéder à des mesures de capacité respiratoire ou de force. Fondée en 1859 par Paul Broca, la société d’anthropologie se fixe pour but l’étude des races humaines. L’anthropologie est alors fondée la science naturelle de l’homme. La race est alors fixée comme un outil permettant de délimiter les groupes humains à partir des caractères fixes et héréditaires partagés par les membres de chaque groupe. La distinction des races humaines fait à partir de mesures « scientifiques ». Si Paul Broca peut être considéré comme un racialiste il considère cependant que « la race française n’existe pas ». L’auteur étudie également les principaux théoriciens du racisme, comme Arthur de Gobineau, Georges Vacher de la Pouge et Gustave Le Bon. Arthur de Gobineau, présente les inégalités natives, originelles et permanentes entre les différentes races comme une évidence. Georges Vacher de la Pouge évoque le premier la thèse de la supériorité des aryens, tandis que Clémence Royer, à partir d’une lecture de Darwin bâtit un système philosophique basé sur la lutte des races.
Les anthropologues se sont opposés à ces théories racistes tout en leur reconnaissant peu ou prou une certaine validité. Ils s’appuient toujours sur les mesures de l’homme et, sans forcément établir une hiérarchie, ils justifient des différences innées.
On retrouve cette explication dans les analyses du Docteur Collignon, étudiant les populations du département de la Manche du point de vue de la guerre des races. Deux types coexistent. Des bretons d’origine gauloise, de type brachycéphale et des descendants de la race nordique de type dolicocephale, aux yeux bleus et grands de taille.
De la guerre des races à la norme raciale. À partir de ces travaux sur la guerre de race la nation se lit comme une communauté d’individus consanguins, liés entre eux par les éditer est établis sur le sol français depuis un temps long. C’est ce temps « mythique » qui confère aux individus leur enracinement sur le sol national et qui fait d’eux de « vrais » français.
Le deuxième chapitre de l’ouvrage traite de l’anthropologie et de la norme raciale. Si les ethnologues affirment dans l’entre-deux-guerres leur antiracisme, il n’en reste pas moins que le racisme à partir des années 30 devient une opinion acceptable. Dans une période de tensions sociales, l’idée de la coexistence en France des deux races perd peu à peu du terrain au profit d’une conception d’une « race française », une formule qui fera fortune dans la France de Vichy.
Dans l’entre-deux-guerres par ailleurs, l’eugénisme est une science reconnue, enseigné à l’université. Cette science se propose d’améliorer les races humaines parle de sélection artificielle, puisque la sélection naturelle est entravée par des lois sociales qui conservent les médiocres.
Les théories de l’hygiène raciale
On sait que ces théories de l’hygiène raciale nazie ont abouti à partir de 1939 à l’opération T4 en Allemagne : L’assassinat de 100 000 handicapés et aliénés.
En 1937 une revues scientifique et militante races et racisme fondée par Paul Rivet paré de janvier 1937 à décembre 1939. Ce mouvement dénonce le racisme et surtout les théories raciales en vigueur de l’autre côté du Rhin. C’est dans ce domaine que la définition « d’une race juive » et le plus dénoncé. Pour autant, selon les auteurs le mal raciste semble être un phénomène uniquement allemand. Dans ce chapitre, Régis Meyran évoque également une sorte d’eugénisme « antiraciste », visant à une sorte d’amélioration de la race en éliminant ceux qui sont susceptibles de poser le plus de problèmes. Finalement, d’après l’auteur, les savants antiracistes de races et racismes acceptent l’idée qu’une race puisse être purifiée.
Le troisième chapitre de cet ouvrage évoque les « vertus » de la race française en France occupée. Il semblerait que les folkloristes, comme Louis Marin, à la suite de Van Gennep, l’auteur du folklore français contemporain, aient trouvé dans l’idéologie de la révolution nationale, un véritable jardin. En France occupée, l’école d’anthropologie a été un véritable centre d’apprentissage de l’eugénisme raciste. Loin de se limiter à l’eugénisme raciste à la française, cette école d’anthropologie a repris les théories de l’eugénisme nazi en considérant que les techniques allemandes étaient plus efficaces.
La conclusion de cet ouvrage est sans doute la partie la plus accessible et celle qui le révèle l’apport méthodologique le plus important.
À propos des mythes de l’identité nationale, Régis Meyran nous apporte les éléments suivants :
– premier mythe : la France a été le lieu d’affrontement entre deux races, gauloise et Franques.
– deuxième mythe : la France était habitée, en des temps immémoriaux, par une race de paysans qui vivaient heureux avant d’être pollués par l’industrialisation.
– troisième mythe, qui débouche sur une utopie : auparavant, race française était pure. Aujourd’hui on peut la régénérer en fondant un nouvel ordre social établi à partir du plan par raciale.
Pendant cette période de l’entre-deux-guerres, et sous le régime de Vichy, les anthropologues français se sont accommodés de ces théories. Les racialistes ont certes combattu le racisme ethnique ou biologique, mais ils ont tout de même, pour la plupart d’entre eux, repris à leur compte la théorie des deux races.
Les folkloristes ont repris à leur compte la thèse d’une France rurale, aux solidarités agraires, dans une terre qui ne manquait pas, ce qui se retrouve dans le discours pétainiste.
Les théoriciens de la race pure se sont retrouvés à la remorque des idéologues du IIIe Reich, tenants de la hiérarchie raciale, ils ont accompagné les collaborationnistes dans leurs dérives.
Derrière ce débat théorique, ce sont les complicités avec la solution finale qui sont en cause. Rien n’est innocent ici.
Le retour de Claude Lévi-Strauss
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les folkloristes ont été oubliés au profit d’une ethnographie du domaine métropolitain. L’épisode de Vichy est devenu un sujet tabou et le reste pendant un bon demi-siècle. Régionalistes et érudits locaux ont été mis au placard. La notion de race très présente dans tous les discours d’avant-guerre a été totalement occultée avant de refaire surface quelques années plus tard.
Si dans les années 50, Claude Lévi-Strauss pouvait lire dans race et histoire publiée en 1952 à la demande de l’Unesco que la diversité culturelle était le paramètre essentiel permettant de différencier les groupes humains, en 1971, dans race et culture l’anthropologue, à la lumière des découvertes sur la génétique pouvait considérer que les choses n’étaient pas aussi simples.
Claude Lévi-Strauss considère qu’il existe une co-évolution entre gênes et cultures.
D’une part la spécificité des gènes humains a permis l’émergence de la culture, d’autre part, les différentes formes de culture de sélection naturelle. Au final, c’est l’organisation de la société qui influe sur la génétique des populations.
Dans les années 60, on peut considérer que la question raciale est revenue en force. Ce retour est lié à des groupes de pressions pourtant il raciste, qui ont réintroduit la race comme principe explicatif. On retrouve cette démarche par le conseil représentatif des associations noires pour qui les discriminations entre majorité minorité doit être mis en évidence à l’aide de statistiques ethniques. C’est, plus ou moins, le discours d’un mouvement comme celui des « indigènes de la république ».
De ce fait, même si le discours discriminatoire qui s’est diffusé dans la société française dans les années 80 explique cette évolution, les tenants d’une identité nationale à la française, comme ceux qui la refusent, se sont retrouvés comme des alliés objectifs. Pourtant, même si les différences sont présentées comme des évidences, rien n’est moins « évident » que la race. Pourtant, les chaînes de télévision ont présenté la mise en avant de présentateurs issus de minorités visibles comme des concessions indispensables à leur reconnaissance de leur statut dans la société.
Selon Régis Meyran, cette évolution va à contre-courant de ce qui se passe aux États-Unis. De plus, la France est en retard. En réalité, ce discours sur l’identité nationale, qui se retrouve dans la conception de l’histoire de France selon Nicolas Sarkozy, s’inscrit dans une construction idéologique lourde de menaces. En affirmant une « identité nationale » qui ne repose sur rien de réel, le risque est grand de considérer que « l’autre » est porteur d’une menace sur l’identité nationale est donc sur la tranquillité publique. Cette conception d’une histoire de France déconnectée du réel, des brassages de populations, des enrichissements réciproques se retrouve analysée dans cet ouvrage présenté sur ce site, « comment Sarkozy écrit l’histoire de France ? ». Le risque est grand de voir apparaître une xénophobie d’État qu’il considèrerait que « l’étranger est un problème ».
On le voit, cet ouvrage est particulièrement stimulant et cette étude de la formation du concept d’identité nationale permet de décrypter le discours actuel en le rattachant à un passé qui décidément « ne passe pas ».