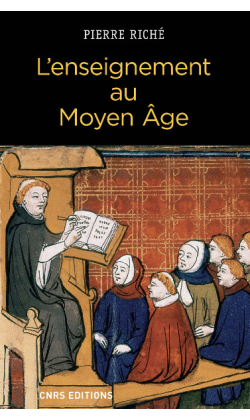
Les deux premiers chapitres permettent à Pierre Riché de dessiner les grandes lignes de 1000 ans de l’histoire de l’éducation. Jusqu’à l’époque carolingienne, le propos décrit la survivance de l’école antique, par exemple chez les aristocrates de l’Espagne wisigothique, et la relation ambivalente de l’école médiévale à l’héritage classique. Comment se démarquer de cette culture profane et développer un enseignement orienté sur l’Ecriture sainte dans une époque pétrie de culture greco-latine ? Dans ce haut Moyen âge, une synthèse s’opère donc entre classicisme et christianisme. Les maîtres chrétiens, suivant Saint Augustin, font des arts libéraux, notamment le quadrivium (arithmétique, géométrie, astronomie et musique), une propédeutique à l’étude des textes sacrés. Il n’y a d’ailleurs pas encore d’écoles spécifiquement chrétiennes : clercs comme laïcs suivent le cursus de l’école romaine.Cette éducation antique survit à la chute de l’empire romain puis aux conquêtes justiniennes au moins jusqu’au VIIe siècle. Cependant, le VIe siècle est celui de l’autonomisation de l’école chrétienne. D’abord monastique, elle se détache des sources profanes pour se focaliser sur le texte biblique et forme les moines et les clercs puis des jeunes laïcs, les oblats par exemple. Le tissu scolaire s’enrichit d’écoles épiscopales et presbytériennes qui dispensent le rudiment (lecture, écriture, calcul, chant). La spécificité de l’âge enfantin est perçue et, sous l’influence de Saint Benoît, les traités pédagogiques se multiplient entre le Ve et le VIIIe siècle, les concepts moraux de l’Antiquité le cédant peu à peu aux valeurs chrétiennes.
C’est dans ce sillon que s’inscrit la première « révolution carolingienne » axée sur l’enseignement religieux. S’appuyant sur le réseau scolaire existant, Charlemagne réorganise l’école franque à l’aide des moines et légifère sur les programmes : lecture du psautier, grammaire latine et calcul, chant, sténographie, arts libéraux constituent l’enseignement des clercs. Une nouvelle révolution correspond aux règnes de Louis le Pieux et Charles le Chauve marquée par le retour à la culture classique (Virgile, Cicéron, Tacite).
L’effondrement de l’empire carolingien n’interrompt que provisoirement cette dynamique. L’Eglise reprend alors l’initiative de la formation scolaire. Méfiante à l’égard de la culture profane, les écoles monastiques ne négligent pas de la transmettre aux enfants mais, dans le même temps, se ferment aux laïcs qui doivent trouver ailleurs de quoi étancher leur soif d’apprentissage. Le XIIe siècle et le regain de dynamisme des villes marchandes leur en donnent l’opportunité. L’offre scolaire s’étoffe : Les écoles urbaines (cathédrales, collégiales) se multiplient, l’Eglise perd le monopole qu’elle détenait depuis 5 siècles. L’essor de l’écrit, des administrations locales érigent en moyen d’ascension sociale une culture où la langue vulgaire prend de plus en plus de place (rhétorique, droit, notariat).
Leurs réseaux se juxtaposant, autorités civiles et religieuses ne pouvaient manquer d’entrer en concurrence. L’Eglise est ainsi à l’origine de la création des universités, à partir des écoles épiscopales. Urbaines, spécialisées, animées par des maîtres réputées comme Thomas d’Aquin à Paris, elles dispensent un enseignement dont les arts libéraux restent le socle ainsi que les trois grades : baccalauréat, licence et doctorat. Parallèlement, les ordres mendiants ouvrent leurs propres écoles à partir des années 1220. Dans les villes comme les campagnes, la possibilité d’accéder à l’enseignement élémentaire continue de se renforcer.
Le prestige des universités est de courte durée. Engagées dans les querelles du Grand Schisme, prises dans les soubresauts de la Guerre de Cent Ans et peinant à renouveler des pratiques pédagogiques dénoncées sous le terme péjoratif de scholastique, elles déclinent progressivement et se réduisent à des lieux de formation des administrateurs pour des états en pleine expansion administrative. Ce seront alors les collèges qui prendront le relai dans les villes pour offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de faire de bonnes études.
DES ENTREES THEMATIQUES POSSIBLES
Un autre regard sur l’enfant
P. Riché rompt avec l’idée selon laquelle la période médiévale aurait évacué la question de la transmission du savoir et refuserait de voir dans l’enfance un âge spécifique. Les chapitres 10 et 11 consacrés aux écoles monastiques montrent que la règle de Saint Benoît, abondamment publiée et commentée, jette un regard nouveau sur l’enfant. Elle en fait un être fragile qu’il faut entourer de soins et qui doit s’épanouir au sein des monastères. Il y suit la règle, même les prières nocturnes, mais chez les bénédictins comme les clunisiens, elle fait l’objet d’inflexions : temps de détente, régime alimentaire moins strict, hygiène et soins médicaux plus attentionnés, les maîtres sont invités à l’indulgence et la patience dans la transmission du savoir. Certes, l’indiscipline des jeunes garçons et filles se doit d’être corrigée mais la modération est de rigueur pour les châtiments corporels. On comprend, dans ces conditions, le succès de la pratique de l’oblation qui voit des parents, confier définitivement leur enfant à des monastères. Cet acte de piété n’en est pas moins contractuel et prévoit des contreparties mobilières et immobilières. Il posait aussi le problème de la liberté de décider du jeune enfant ainsi placé. Il faudra attendre le XIIe siècle et la multiplication des écoles urbaines pour qu’existe une véritable alternative à cet enseignement monastique dont l’héritage est profond.
La réflexion pédagogique donne aussi lieu à une littérature abondante (educatio, speculum, miroir, eruditio…) qui culmine au XIIIe siècle. P. Riché se risque à en faire un inventaire abondant et une typologie. Il les classe d’abord par thème : ils sont relatifs à la première enfance (hygiène, pédiatrie), à l’éducation physique, par le jeu. Ils concernent ensuite la formation socioprofessionnelle, le gouvernement de la maison, l’édification morale (par les maximes de Sénèques) et religieuse, la formation politique, l’amour courtois ou encore les manières de table… Ils s’adaptent à l’âge et au sexe, à la fonction qui attend l’enfant dans sa vie d’adulte. Nous ne revenons pas sur la littérature pédagogique relative aux jeunes moines et oblats, elle est peu abondante en dehors du commentaire des Règles. Les traités pour les maîtres et la formation des jeunes clercs profitent de l’essor urbain des XIIe et XIIIe siècles (De disciplina schuolarium du Pseudo-Boece). Les jeunes laïcs ne sont pas en reste. Certains traités maintes fois mentionnés dans ce livre méritent d’être cités : l’Institutionum disciplinae d’Isidore de Séville (VIIe siècle), le Manuel pour mon fils de l’aristocrate carolingienne Dhuoda (843), ou encore le De eruditione filiorum nobilium de Vincent de Beauvais (1272).
Transmettre les savoirs fondamentaux
La lecture pose le double problème des supports et des méthodes. L’école carolingienne utilise une méthode syllabique proche de celle de l’Antiquité. Les jeunes moines découvrent les lettres de l’alphabet, les mono et les bisyllabes regroupés dans de petits syllabaires avant de se consacrer à la lecture du psautier à partir de 7 ans que viennent compléter des textes simples comme les Distiques de Caton. Le débat est permanent sur la pertinence de donner aux jeunes clercs l’accès à cette culture profane mais la méthode monastique reste dominante en Occident. Le chant fait d’ailleurs aussi partie des méthodes pédagogiques à la fois comme discipline spécifique qu’un moine doit maîtriser et comme moyen de mémorisation. La période carolingienne voit ainsi les écoles de chant se multiplier et le chantre y tient une place primordiale.
L’apprentissage de l’écriture est déconnecté du précédent. Assis autour d’un maître, les élèves tracent des lettres sur des tablettes à l’aide de stylets ou de plumes. Les niveaux de formation sont variables selon la fonction à laquelle les jeunes se destinent mais tous sont réunis en une seule classe.
Ces tâches sont accomplies sous la férule du grammairien. Les textes classiques permettent l’acquisition des déclinaisons et des conjugaisons, donnent lieu à des exercices d’application qui peuvent prendre la forme d’un dialogue avec l’enseignant. On y puise des repères historiques et géographiques dont on alimente des glossaires et florilèges à mémoriser. Ainsi armé, l’élève peut se confronter à la lecture et l’exégèse des textes Sacrés.
La mémoire tient une place fondamentale dans les apprentissages. Si l’école chrétienne s’insurge contre l’inutilité d’un emmagasinement stérile des connaissances, apanage de l’école antique, l’apprentissage et la répétition du psautier est un outil essentiel dans les premières écoles monastiques. Les écoles chrétiennes des VIe et VIIe siècles puis les écoles carolingiennes restent fidèles à cette méthode qui facilite l’apprentissage d’un latin devenu langue savante par l’intermédiaire de petits textes, de dialogues ou de connaissances présentées sous forme versifiée. Le renouveau du XIIe siècle poursuit dans cette voie où la transmission orale est prépondérante. Il faudra attendre le XIIIe siècle et l’avènement des universités pour que le livre et la prise de notes par les étudiants deviennent l’auxiliaire de la mémoire.
Le quadrivium est, quant à lui, un cursus d’études complet qui mène, après le trivium, à la philosophie. Il comprend la géométrie, l’arithmétique, l’astronomie et la musique. Héritage antique, son enseignement connaît un sort contrasté au Moyen âge. Il se maintient en Gaule et en Italie mais connaît de profondes transformations de sa conception en Gaule et monde anglo-saxon. Les trois renaissances carolingiennes entre le IXe et le Xe s. marquent un regain d’intérêt pour les études scientifiques et donc pour le quadrivium. Il accompagne les progrès scientifiques de l’époque dont Gerbert d’Aurillac, devenu le pape Sylverstre II, est un excellent porte étendard.
Savoir et culture du public laïc
P. Riché déconstruit l’idée que la société médiévale serait composée de masses incultes. D’emblée, le vocabulaire est source d’embuches : le lettré est celui qui connaît le latin, l’illettré n’est donc pas analphabète. Un laïc qui le maîtrise peut être affublé du nom de clerc. Enfin, il est possible d’être très cultivé sans nécessairement être lettré.
Ceci posé, les laïcs lettrés et cultivés existent, à commencer par les cours princières et royales. Louis VII, l’empereur Conrad III ou Henri Beauclerc sont les exemples non-exhaustifs de ces souverains ayant reçu tôt une éducation religieuse et savante. P. Riché consacre quelques lignes aux catégories urbaines, marchands et artisans. Le XIIe siècle voit fleurir la littérature en langue vulgaire (romans en prose ou vers, fabliaux, contes, récits historiques, traduction des textes sacrés) tandis que la complexité croissante des affaires commerciales et publiques exigent d’eux la maîtrise des savoirs fondamentaux. Fondant des écoles lorsque l’offre vient à manquer (Gand), ils ravissent à l’Eglise le monopole qu’elle détenait sur l’enseignement depuis 5 siècles. Mais loin de combattre les progrès culturels des laïcs, elle lutte contre l’ignorance de ses clercs et s’appuie sur cet essor en encouragent la prédication laïque.
L’auteur consacre également quelques pages à la culture spécifiquement religieuse de ces laïcs. Les aristocrates sont édifiés par des petits livres appelés « miroirs » où l’enseignement moral prime sur le dogme : respect de l’autorité parentale, sainteté du mariage, culture religieuse fondamentale, modèle des vertus du chevalier chrétien sont à l’honneur. Chez les plus humbles, cette édification se fait davantage par la parole et le geste. La prédication, les pèlerinages, la culte des saints et des reliques, la peur du démon, l’observation des fresques et des vitraux qui ornent les églises voire la conversion à l’érémitisme sont les expressions d’une piété populaire où l’imaginaire est plus sollicité que la raison mais qui n’en demeure pas moins vivace. L’Eglise saura en faire un atout pour le renouveau de la vie monastique du XIe siècle. Ainsi, si la frontière se dessine plus nettement entre les clercs et les laïcs au tournant du XIIe siècle, la participation de ces derniers à la vie religieuse est aussi foisonnante qu’essentielle.
Le fonctionnement des institutions scolaires
Un dernier axe thématique proposé dans cet ouvrage est le quotidien des écoliers. Celui des écoles monastiques a été examiné plus tôt. Que savons-nous des universités ? Elles ne sont pas des écoles mais des corporations d’étudiants et de maîtres. On n’en compte pas plus d’une vingtaine au XIIIe siècle. A partir de 14 ans, les étudiants y sont répartis en facultés et par origine géographique. Les cours, du moins à Paris, sont composés de conférences, d’explications et de commentaires de texte. Le maître dispose de livres recopié par des copistes mais peut aussi faire copier son cours par ses étudiants.
Le collège est à l’origine prévu pour les étudiants boursiers et s’ouvre aux élites urbaines au XIIe s. Son organisation est calquée sur celle d’une abbaye. Il possède généralement une bibliothèque, une chapelle, un jardin. Il est régi par une discipline stricte comme le montre le chapitre 19 consacré à celui du Bueil à Angers. L’élève doit être de naissance légitime, maîtriser sa grammaire et fournir son matériel. Ses entrées et sorties sont réglementées, ses fréquentations contrôlées. Ses repas sont pris en commun et il dort sur place sauf exceptions accordées par le maître. Il s’inscrit dans une hiérarchie d’élèves bien définie et se doit de vivre en bonne entente avec ses camarades. Amendes, suspension de bourses, châtiments corporels, exclusions temporaires ou définitives sanctionnent les manquements.
CONCLUSION
Cet ouvrage de P. Riché permettra aux enseignants de cinquième et seconde d’approfondir les cours consacrés aux sociétés urbaines et rurales médiévales. On déplore cependant que le livre n’échappe pas aux écueils qui guettent ce type de compilations d’articles. Les redites sont nombreuses et il manque une introduction plus étoffée et problématisée pour donner sens à un ensemble où les articles de vulgarisation en côtoient d’autres, extrêmement techniques et difficiles d’accès pour les non-initiés.



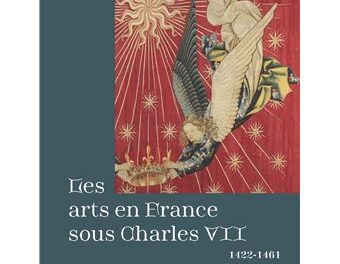

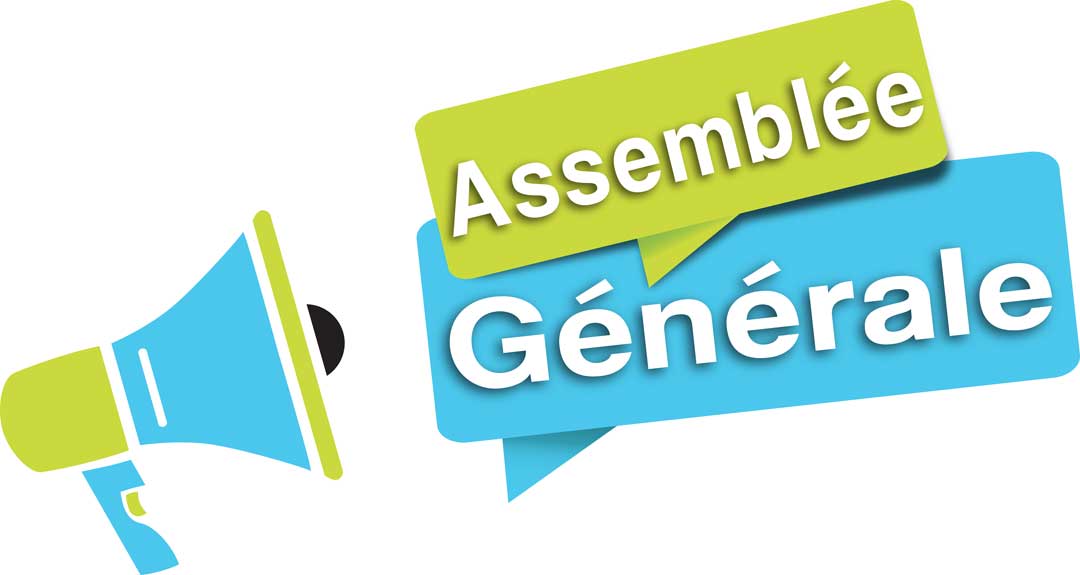



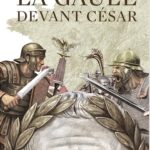




Trackbacks / Pingbacks