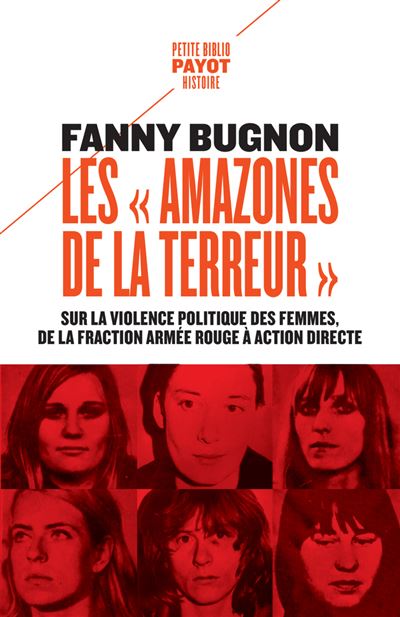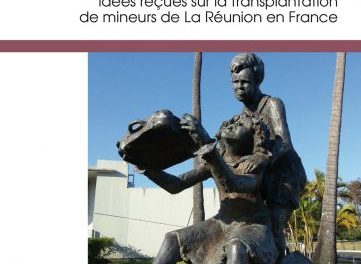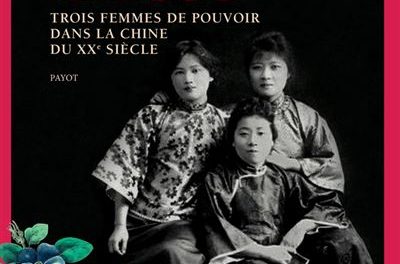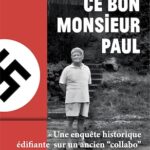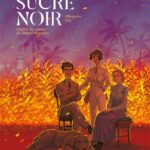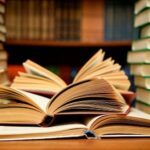Sur la violence politique des femmes, de la Fraction Armée rouge à Action directe,
Des « femmes terroristes » ?
À rebours des représentations usuelles qui tendent à considérer les femmes comme victimes des faits de violences, dans les années 1970-1980, en RFA (République fédérale allemande) et en France, des femmes ont appartenu à des groupes ayant recours à des actions politiques violentes qui ont entrainé la mort de policiers, de grands patrons, de militaires… La présence au premier plan de femmes dans la Fraction armée rouge et au sein d’Action directe a alors beaucoup surpris et donné lieu à de nombreux commentaires. En effet, des femmes ont été actives dans des groupes terroristes, très isolés dans ces deux pays par rapport au mouvement ouvrier traditionnel mais aussi aux gauches radicales de l’après Mai-juin 1968[1]. Et elles n’ont pas hésité à participer à des actions très violentes voire meurtrières. Leur présence et leur activité ont alors suscité la curiosité de nombreux médias. Ce sont les réactions et les interprétations diffusées par la presse écrite qui sont plus particulièrement étudiées dans ce livre par Fanny Bugnon[2]. Comme l’indique d’ailleurs le titre de sa thèse : La Violence politique au prisme du genre à travers la presse française (1970-1994), soutenue en 2011.
Des femmes… « amoureuses », des femmes… « dangereuses »
La presse écrite a relevé avec étonnement la présence de femmes dans les groupes politiques qui s’affirmaient révolutionnaires et avaient recours à l’action armée dans les années 1970-1980. Elle les a comptées parfois minutieusement et leur a accordé une place importante dans ses colonnes. La plupart des journalistes cependant ne les ont pas présentées de la même manière que les hommes terroristes. Un certain nombre d’entre elles ont été vues comme des amoureuses en perdition, sans autonomie et vivant sous l’influence de leur compagnon et mentor ou bien comme des femmes refusant d’endosser le rôle de mère. Certaines toutefois sont considérées comme peut-être plus dangereuses que les hommes, furies cruelles qui menacent l’ordre social. Le prisme du genre auquel a recours Fanny Bugnon se révèle utile pour comprendre le discours des médias sur ces femmes.
« Le féminisme en accusation »
Pour l’autrice, cette violence de quelques femmes « fascine d’autant plus qu’elle représente un renversement de l’ordonnancement du monde ». En effet, Fanny Bugnon ne se contente pas de décrire les actions violentes menées et les réactions de la presse écrite[3], elle propose une interprétation des analyses véhiculées par les médias qui n’est pas sans éveiller un questionnement sur des discours très actuels portés par les sphères réactionnaires. Pour elle, les jugements portés sur ces femmes renvoient aux transformations des sociétés contemporaines. Transformations refusées par certains médias, courants politiques et intellectuels car ils les considèrent comme « un symptôme de dérèglement politique, social et moral ».
Un livre clair sur un passé proche mais oublié qui, à travers un cas très particulier, permet de percevoir nombre de clichés traditionnels sur les femmes.
[1] Contrairement à ce qui s’est passé en Italie et à ce que semble parfois suggérer l’autrice de cet ouvrage.
[2] La première édition de cet ouvrage date de 2015. Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, a aussi publié : L’Election interdite. Itinéraire de Joséphine Pencalet, ouvrière bretonne (1886-1972).
[3] Mais non celles des journaux télévisés.