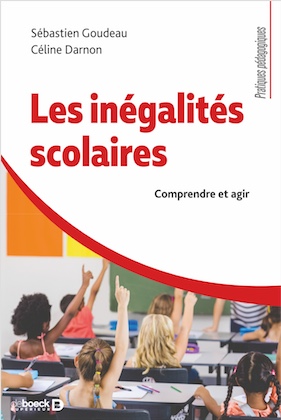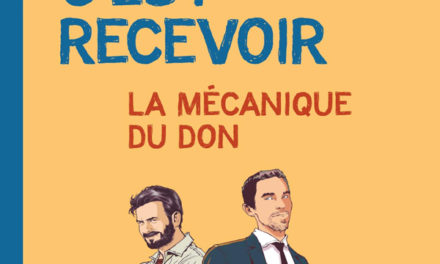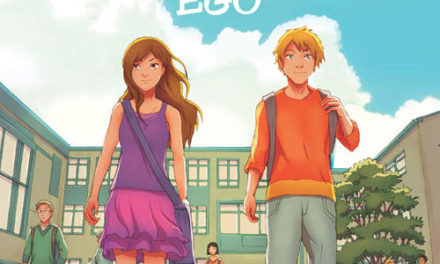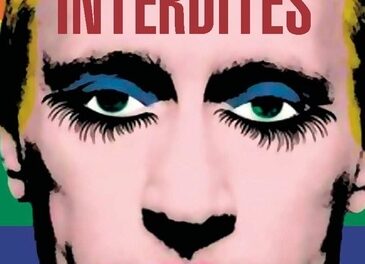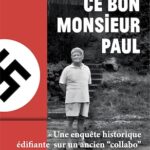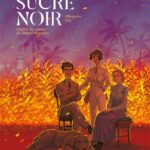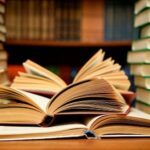Nous l’avons tous observé en tant que parents ou enseignant : tous les élèves ne sont pas égaux face à la scolarité. Ce constat d’évidence n’empêche pourtant pas le mythe de l’égalité des chances scolaires. Ce livre prend le temps de s’arrêter sur ce sujet central qui peut sembler abyssal lorsque l’on commence à le travailler.
D’où viennent les différences de réussite scolaire ?
Dans ce premier chapitre, Sébastien Goudeau, ancien professeur des écoles et professeur des universités en psychologie sociale à l’université de Poitiers, ainsi que Céline Darnon professeure de psychologie sociale à l’université de Clermont-Ferrand, dressent un état des lieux des connaissances. On sait par exemple que la réussite scolaire s’explique par une combinaison de plusieurs facteurs. Certains restent des prédicteurs importants des trajectoires scolaires. Cependant, tout n’est pas joué à la naissance. En France, l’école maternelle conçue en partie pour réduire les inégalités initiales ne permet pas de le faire en réalité. On constate que les filles réussissent mieux que les garçons à l’école primaire. Au sein de l’enseignement supérieur, la proportion d’étudiants issus de milieux ouvriers est seulement de 10 %. La manière d’enseigner et les pratiques de classe impactent la réussite des élèves comme en témoignent les travaux de John Hattie.
Culture scolaire et socialisations familiales
Il s’agit de montrer comment les modes de socialisation de certains élèves sont plus ou moins en accord avec les pratiques et la culture scolaire. Toutes les formes de langage et de savoirs ne se valent pas à l’école. Les pratiques des familles culturellement plus favorisées encouragent les activités qui vont au-delà de l’objectif strict de préparation à la scolarité. L’une des conséquences du décalage de capital culturel est que les élèves issus de milieux populaires participent moins souvent en classe que leurs camarades des classes moyennes et supérieures. Certaines pratiques pédagogiques peuvent réduire ou aggraver les inégalités scolaires. On note ainsi que plus les méthodes pédagogiques reposent sur l’implicite, plus elles sont susceptibles de créer du malentendu. C’est le cas par exemple des méthodes basées sur le jeu.
Les parents et leur lien avec l’école
Les liens entre implication parentale et réussite scolaire diminuent avec l’âge des enfants. Avec l’avancée en âge, la transmission d’informations entre l’enseignant et les parents se fait de plus en plus par des plateformes numériques. Les échanges informels lors de la dépose ou de la reprise des enfants à l’école primaire sont plus fréquents chez les parents issus des milieux populaires. Cette simple constatation invite à se méfier de l’idée de démission parentale de la part de ces familles.
Stéréotypes et attentes au sujet des élèves
Les stéréotypes relatifs à des groupes sociaux (filles, élèves de quartiers populaires) peuvent peser aussi. Les enseignants ajustent leurs attentes en fonction de ce qu’ils perçoivent des performances des élèves. Les auteurs relatent plusieurs expériences qui ont permis de mettre en évidence ce phénomène. Faire corriger une dictée en attribuant tel ou tel prénom à l’élève crée des biais dans les attentes des enseignants.
Croire ou ne pas croire au mérite scolaire ?
Les différences de réussite sont souvent interprétées comme la résultante de caractéristiques internes de l’élève. La façon dont les élèves interprètent et expliquent les différences qu’ils observent peut avoir des conséquences cruciales sur leur motivation et leurs efforts. Croire que l’école est méritocratique est à double tranchant. C’est garder un certain sentiment de contrôle sur ce qui arrive, sentiment qui est indispensable pour ne pas baisser les bras, mais c’est aussi considérer que chacun est responsable de ses réussites comme de ses échecs.
Réduire les inégalités sociales à l’école ?
L’égalité des chances n’a en réalité jamais totalement existé ni en France, ni ailleurs dans le monde. La manière dont un élève interprète la situation qu’il est en train de vivre va impacter ses réactions, ce qui va le conduire ou non à persévérer. Il est essentiel que les élèves aient une conception malléable de l’intelligence. Des résultats existent mais les effets positifs constatés ont tendance à s’estomper avec le temps.
Des inégalités scolaires aux inégalités sociales
Ce chapitre insiste donc sur des freins qui relèvent davantage du rôle que joue l’école au sein de la société. Le fonctionnement de l’institution pèse et contribue à faire de la classe un espace de compétition. L’école à travers les diplômes détermine en grande partie les futures positions sociales.
La formation des enseignants est essentielle. Il s’agit de promouvoir les pratiques efficaces et équitables au sein de l’école. Cela ne peut se faire sans un changement plus structurel relevant des inégalités qui existent au-delà de l’école, au sein de la société.