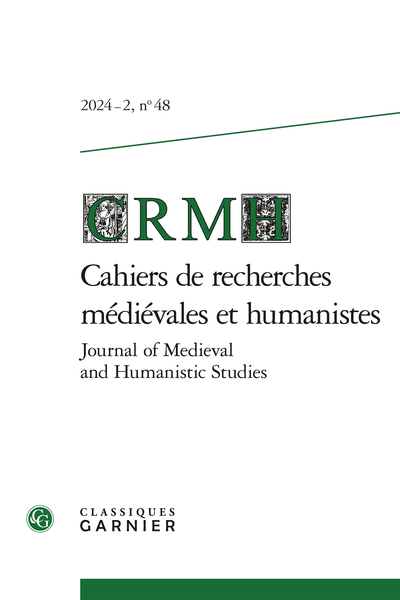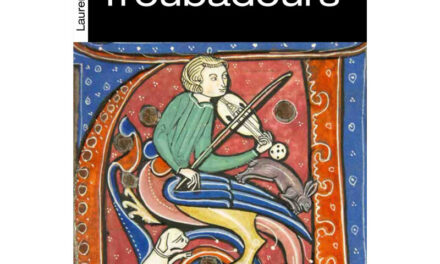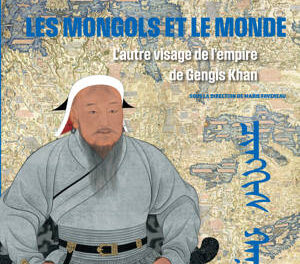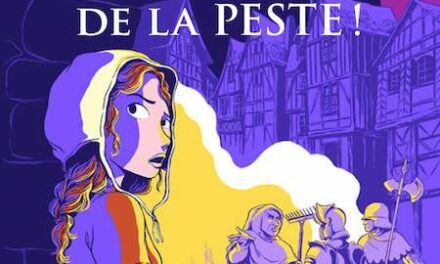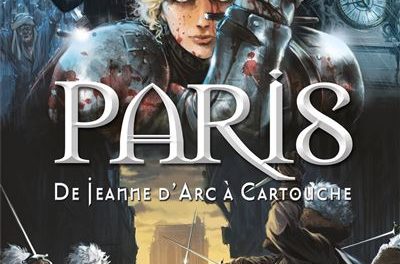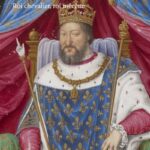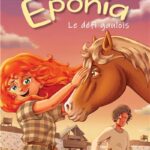Au Moyen Âge et durant la Première modernité, le mariage est « une alliance entre deux groupes familiaux par le moyen de la conjonction charnelle entre un homme et une femme et qui débouche ou non sur la procréation d’enfants » (Eric BOUSMAR). Le présent ouvrage est un recueil d’articles qui étudient ces mariages qui ont failli.
Nous verrons ici des négociations matrimoniales qui ont été entreprises alors que les protagonistes ne souhaitaient pas réellement du mariage (J. M. CAUCHIES) ; des négociations matrimoniales durant lesquelles un roi se fait totalement « balader » (Cl. KALOGERAKIS) ; un catalogue de raisons qui empêchent un mariage d’être conclu (J. ÖZCAN). Nous examinerons également les politiques matrimoniales infructueuses de deux princes de la fin du Moyen Âge (A. M. S.A. RODRIGUES ; E. PIBIRI) ainsi que le contrôle d’un suzerain sur la politique matrimoniale de son vassal (G. LECUPPRE). Enfin, nous observerons (de loin) une tentative de mariage d’amour (M. MARINHO FERNANDES) et un mariage totalement raté qui débouche sur une véritable guerre entre époux (E. BOUSMAR).
Les négociations matrimoniales
Le cas de négociations entamées pour une alliance matrimoniale alors qu’un (ou plusieurs) protagoniste ne souhaite pas réellement du mariage. C’est ce qui se déroule lors des négociations de mariage de Claude de France avec Charles Quint. Jean-Marie CAUCHIES, professeur émérite à l’université Saint-Louis de Bruxelles, nous résume parfaitement cette histoire en allemand : « Im Grunde misstraute jeder jedem »*. Aucun des protagonistes de ces négociations (le roi de France Louis XII, l’empereur Maximilien Ier et le roi Ferdinand d’Aragon) ne se font confiance ; mais chacun a besoin de l’autre. Seuls deux acteurs semblent sincères dans cette histoire : Anne de Bretagne, qui souhaite voir un jour sa fille devenir impératrice (destinée qui devait être la sienne quelques années auparavant) et Philippe le Beau, qui se rêve en « courtier de la paix ». Louis XII a besoin de l’investiture impériale pour ses nouveaux territoires en Italie ; l’empereur Maximilien doit traverser le Milanais français pour atteindre Rome afin d’y être officiellement couronner empereur par le Pape ; et enfin Ferdinand d’Aragon qui « la joue perso » : son seul objectif étant de garder pour lui le royaume de Naples. Pendant environ cinq ans, on se fait des promesses, on s’engage, on signe des traités, on se rencontre et on confirme ces traités mais finalement, toutes les négociations tombent à l’eau. Le testament de Louis XII (mai 1505) et les Etats généraux de Tours (mai 1506) décident que Claude de France se mariera à l’héritier du trône, François d’Angoulême.
Ce jeu de dupes est également visible lors des tentatives malheureuses menées par Henri VII Tudor pour se remarier à la mort de son épouse, Elisabeth d’York (1503). L’article de Clara KALOGERAKIS, doctorante à l’université de Lille, cherche à comprendre la volonté du roi de se remarier malgré son grand âge (46 ans) et malgré qu’il possède déjà un (plusieurs) héritier mâle. On fait « miroiter » deux princesses au roi anglais (qui est très versatile – il aime bien les deux…) : Marguerite d’Autriche et Jeanne de Castille. Le père (Maximilien Ier) et le frère (Philippe de Habsbourg) poussent pour un mariage avec Marguerite d’Autriche. De par sa position privilégiée (elle administre les Pays-Bas bourguignons au nom de l’empereur et s’occupe de la formation du futur Charles Quint et s’occupe de la formation du futur Charles Quint) et par une mise en scène brillamment orchestrée (celle de l’épouse répudiée et celle de l’épouse veuve par deux fois**), Marguerite d’Autriche exige de participer aux négociations de ce nouveau mariage et fait tout son possible pour les faire capoter. Henri VII tente désespérément d’épouser une autre princesse : Jeanne de Castille***. Ni elle, ni son père (Ferdinand d’Aragon) ne souhaitent de ce mariage. On fait alors durer les négociations en faisant traîner le deuil de la reine Jeanne qui est tellement affectée par la mort de son époux (elle y gagnera le surnom de Jeanne la Folle) qu’elle refuse de l’enterrer ! Son père n’ose la contraindre pour ne pas la brusquer. Deuil bloqué, pas de remariage ! Les échecs dans ces deux négociations matrimoniales (durant lesquelles il s’est fait un peu balader) nous permettent néanmoins d’en apprendre davantage sur Henri VII : un roi en quête de légitimité auprès des cours européennes mais plus ambitieux qu’il n’y paraît (il aimerait ceindre plusieurs couronnes sur sa tête).
Julie ÖZCAN interroge les raisons qui empêchent les mariages des enfants d’Henri VIII Tudor – Marie, Elisabeth et Edouard – en se basant sur une quarantaine de projets d’alliances matrimoniales sur une période de 63 ans (1518-1581). La question de la religion est un premier facteur de rupture de négociations. Les longues tractations de mariage entre Marie et Philippe de Palatinat échouent devant le refus catégorique de Marie d’être marier à un prince protestant. La question de l’âge est un deuxième facteur de difficultés des négociations. Lors des fiançailles de Marie Tudor à Charles Quint entre 1521 et 1525, Marie n’a que 9 ans tandis que Charles en a 25. Or, ce dernier a besoin d’une épouse en âge de porter des enfants. Cela explique que les fiançailles sont annulées et Charles Quint décide de se marier avec sa cousine Isabelle de Portugal. La question de la nationalité de l’époux est un troisième facteur bloquant les négociations de mariage. Marier Marie ou Elisabeth avec un prince anglais, c’est faire le jeu des factions à la Cour ; Marier Marie ou Elisabeth à un prince étranger (espagnol ici), c’est prendre le risque de voir l’Angleterre tomber aux mains d’une puissance étrangère (catholique qui plus est, dans le cas de l’Espagne). Un des derniers facteurs bloquant lors de négociations matrimoniales est la question de la légitimité. Lors des tractations entre Valois et Tudor pour le mariage de Marie, la princesse anglaise est déclarée bâtarde par son père (1527), ce qui a pour conséquence d’annuler son mariage avec le fils de François Ier.
Les politiques matrimoniales infructueuses
Aux rangs des politiques matrimoniales mal ficelées, on trouve l’ambitieux duc de Savoie Amédée VIII. Eva PIBIRI, professeure à l’université de Lausanne, examine avec soins ses projets matrimoniaux. En novembre 1439, le concile de Bâle décide d’élever le duc Amédée VIII à la dignité papale (il prend le nom de Félix V). Dans un contexte de schisme religieux, le duc de Savoie mène des négociations matrimoniales dans l’objectif de renforcer son autorité en tant que nouveau pape : en proposant sa fille Marguerite de Savoie à l’empereur et en proposant sa petite-fille Charlotte de Savoie au fils aîné du prince-électeur de Saxe (Frédéric II). Mais dans les deux cas, les négociations n’aboutissent pas. Dans le premier cas, c’est la différence de rang (la fille d’un duc, dût-il être pape, avec un empereur) ainsi que l’absence de virginité de la princesse qui font capoter les négociations. Dans le deuxième cas, malgré les nombreux riches cadeaux et les promesses d’une riche dot, le mariage de la petite Charlotte ne se fera pas non plus****. Cette politique matrimoniale mal ficelée aura eu raison d’Amédée VIII (qui est forcé d’abdiquer et de laisser la place à son fils) et du trésor ducal savoyard…
On trouve également une politique matrimoniale ratée chez le roi de Castille, Henri IV (1425-1474), racontée par Ana Maria S. A. RODRIGUES. Après s’être débarrassé de sa première épouse, Blanche de Navarre – le mariage est annulé car Henri est déclaré impuissant à cause d’un maléfice – (1453), le roi se remarie avec Jeanne de Portugal (1455). Il faut attendre 6 ans avant que Jeanne ne tombe enceinte d’une petite Jeanne. Entre temps, à la cour, les rumeurs se sont répandues sur l’incapacité du roi à accomplir son devoir conjugale et sur le fait que le roi forçait son épouse à avoir des relations sexuelles avec son/ses favoris pour qu’elle tombe enceinte. Lorsque la guerre civile touche la Castille, le roi Henri IV tergiverse au sujet de son épouse et de sa fille. Un temps promise à son demi-frère rebelle Alphonse (1464), Jeanne devient otage avec sa mère lors des pourparlers avec les rebelles (1466-1467). A cette occasion, la reine-mère prend un amant parmi ceux qui la séquestrent. Pour cette raison, elle est renvoyée au Portugal et son mariage est déclaré illégitime. En signant la paix avec les rebelles (1468), Henri IV reconnait Isabelle de Castille (sœur d’Alphonse) comme son unique héritière ; puis, deux ans plus tard, il déshérite Isabelle au profit de sa fille Jeanne (1470). Ces différentes volte-face font, qu’à sa mort, la Castille a deux reines qui prétendent à la couronne : Isabelle et Jeanne. Le bilan de la politique matrimoniale d’Henri IV est donc catastrophique : il se débarrasse de sa première épouse Blanche de Navarre (qui est renvoyée chez elle et qui sera enfermée jusqu’à sa mort) ; il n’hésite pas à donner son épouse Jeanne de Portugal en otage aux rebelles – empêchant ainsi d’avoir d’autres enfants d’elle et en portant atteinte à sa réputation – ; il tergiverse enfin sur la légitimité de sa fille Jeanne en hésitant plusieurs fois entre elle et Isabelle sur celle qui hériterait de la Castille à sa mort.
Dans son article, Gilles LECUPPRE examine les interventions du roi de France dans la politique matrimoniale des comtes de Flandre sur un siècle et demi (1206-1369). Dans l’esprit des rois de France, les mariages des comtes et comtesses de Flandre doivent servir les intérêts de la monarchie française, n’hésitant pas à intervenir et user de la violence pour parvenir à leurs fins. A la mort du comte de Flandre Baudouin IX (1206), Philippe II Auguste met la main sur ses deux filles Jeanne et Marguerite (avec la complicité de leur oncle et tuteur, Philippe de Namur). On fait monter les enchères entre les différents candidats au mariage et c’est Ferrand du Portugal (neveu du roi du Portugal) qui est accepté par la couronne française. Après la bataille de Bouvines (1214), ce même Ferrand est fait prisonnier et enfermé à la prison du Louvre. Sa femme, Jeanne, tente de se remarier (en invoquant la non consommation de son mariage pour obtenir du pape son annulation) avec Pierre Mauclerc, « régent » de Bretagne. Le roi Louis VIII préfère relâcher Ferrand (qui devient ainsi redevable) « que se trouver pris entre le marteau breton et l’enclume flamande ». A la mort de Ferrand, Jeanne souhaite se remarier ; mais le pouvoir royal français lui impose Thomas de Savoie (bien moins dangereux que l’autre prétendant, Simon de Montfort, comte de Leicester). Lorsque, quelques décennies plus tard, le comte de Flandre tente de marier une de ses filles au roi d’Angleterre, Guy de Dampierre est convoqué à Paris par Philippe le Bel, séquestré et finalement libéré en échange de sa fille. Avec l’exemple flamand, on voit ici le droit de regard constant d’un suzerain sur la politique matrimoniale de son vassal.
Une tentative de mariage d’amour
Quid du mariage d’amour à la fin du Moyen Âge et durant la Première modernité ? Marcos MARINHO FERNANDES nous propose d’observer au plus près une relation amoureuse secrète qui dura presque deux ans entre une princesse, Eléonore de Habsbourg et un prince allemand, Frédéric de Palatinat. Ce projet, qui se fait dans le dos de l’empereur Charles Quint, marque un écart flagrant avec la norme des projets de mariages royaux « basés sur des critères dynastiques et sur une stratégie diplomatique ». Lorsque des courtisans (rivaux de Frédéric de Palatinat) apprennent à l’empereur cette histoire de cœur, les deux amoureux doivent renoncer par écrit à leurs promesses de mariage ; Frédéric est banni de la cour de l’empereur ; Eléonore est mariée au roi du Portugal. L’article demeure intéressant en cela qu’il révèle une perception toute féminine des projets de mariage, qui laisserait une petite liberté de consentement aux princesses : Eléonore a longtemps cru ce mariage possible !
En introduction de son article, Eric BOUSMAR propose une double définition de ce qu’est un mariage. La première a été rappelée plus haut au tout début de ce compte-rendu. Le professeur de l’université de Saint-Louis de Bruxelles la complète avec ces mots : le mariage est « une micro-société hiérarchisée où le mari est le chef de sa femme avec une obligation de protection envers elle, et où l’épouse, obéissante et subordonnée, joue un rôle d’assistante ». Pour illustrer son propos, l’historien belge présente un mariage raté qui s’est transformé en véritable guerre entre époux : celui de Jacqueline de Bavière (1401-1436) avec Jean IV de Brabant. Mariée en deuxième noce à son cousin Jean IV de Brabant, elle est la jeune héritière de trois comtés (Hainaut, Hollande et Zélande). Sur le papier, ce mariage (1418) semble promis à un bel avenir. De cette union doit naître un bloc territorial homogène. Il n’en sera rien. En trois ans, la faillite du mariage est totale. Aucun enfant (héritier) ne naît de cette union (il faut dire que les époux séjournent très peu ensemble : à peine 6 mois discontinus en trois ans de mariage, ce qui complique les projets de procréation). Il n’y a aucune collaboration entre les époux (le contraire aurait été surprenant vu le peu de temps passé ensemble). Entre temps, Jean IV de Brabant n’a pas pu empêcher la perte de deux comtés (sur trois) de son épouse : la Hollande et la Zélande. Jacqueline de Bavière refuse d’être une victime de ce mariage. Elle utilise un moyen radical pour faire pression sur son mari : elle souhaite être libérée de ce lien matrimonial pour pouvoir se remarier. Elle souhaite trouver un nouveau mari qui sera capable de lui donner des enfants et qui sera capable de défendre les droits de son épouse. Elle obtient gain de cause : le pape invalide ce mariage en 1420 !
*En fait, tout le monde se méfiait les uns des autres.
**Marguerite d’Autriche a été répudiée par le roi de France Charles VIII (1491) ; est devenue veuve de l’héritier espagnol Jean d’Aragon (1497) et veuve du duc de Savoie, Philibert II (1504).
***Jeanne de Castille a perdu son époux, Philippe de Habsbourg en le 25 septembre 1506.
****Cette dernière est finalement mariée au dauphin Louis, futur Louis XI.