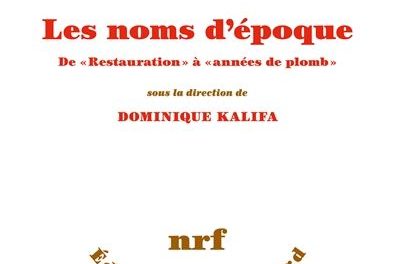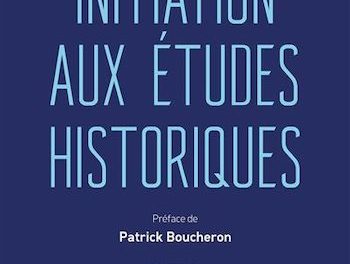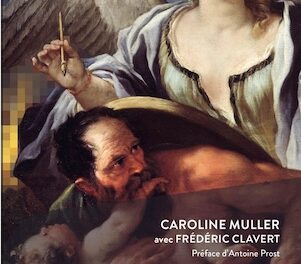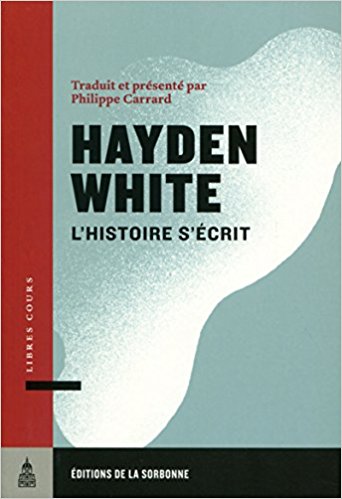
Pour Philippe Carrard, il est essentiel de revenir aux sources de la pensée d’Hayden White à l’instar du chercheur aux archives – paradoxe ironique pour ceux qui auront considéré l’auteur comme « relativiste », « peu intéressé par les faits », « professeur de littérature » et non historien. Il faut dire que White n’a pas ménagé les provocations, et déjà dans les titres de ses écrits (Metahistory)…L’histoire comme écritureSi le nom de Hayden White est inconnu du public français c’est parce que cet historien américain n’a été traduit qu’une seule fois dans notre langue en 2009 pour l’introduction à Metahistory http://journals.openedition.org/labyrinthe/4028, ouvrage datant de 1973, alors qu’il a été beaucoup plus traduit et commenté à l’étranger.
On peut donc s’interroger sur cette absence d’intérêt venant d’un auteur qui est considéré comme ayant « altéré la théorie de l’histoire » : comme l’ambivalent terme after le suggère dans Philosophy of History After Hayden White, (Robert Doran [dir.] 2013), il y aurait une philosophie de l’histoire « après » et « d’après » White qu’il convient d’interroger comme objet de débats non seulement en histoire mais aussi dans les sciences sociales.
L’oeuvre de White commence dans les années 50 avec des publications relevant de l’historiographie traditionnelle comme sa thèse sur le schisme papal de 1130 ou ses écrits sur l’émergence de l’humanisme européen de la Renaissance à son ordalie à partir de la Révolution française.
Il a également traduit le philosophe italien de l’histoire Carlo Antoni et le sociologue français de la littérature Lucien Goldmann ; on comprend que White n’entendait pas limiter son champ d’investigation à sa discipline d’origine.
Le choix du titre de ce recueil de textes (« L’histoire s’écrit ») met en avant un autre aspect du travail de White qui est l’auteur de nombreuses formes d’écriture : recensions, préfaces, direction d’ouvrages, notes critiques, essais, monographies. La dernière biographie de White en 2015 recense plus de 150 entrées ; les 15 textes présentés dans ce recueil ont néanmoins l’ambition de faire connaître au public français les facettes les plus remarquables de son oeuvre.
Il faut dire que White qui est docteur honoris causa de plusieurs universités européennes n’a séjourné en France que six semaines à l’EHESS en 1992 invité par Roger Chartier et François Hartog. Il notera que ses thèses sur le relativisme inhérent à l’entreprise historique et sur l’historiographie comme genre littéraire avaient été froidement accueillies…
Pour comprendre ce qui dans la pensée de l’auteur a pu irriter la communauté des historiens, on peut s’intéresser plus particulièrement au texte que lui adresse R. Chartier l’année suivante « Figures rhétoriques et représentations historiques. Quatre questions à Hayden White », in Storia della Storiografia, Chartier R., 1993 et à la réponse que lui fera White, en ayant à l’esprit que sur le plan rhétorique la pratique des questions écrites et publiques présuppose une querelle qui porte sur deux points essentiels pour « l’écriture de l’histoire » : en quoi la forme littéraire qu’utiliserait l’historien reconstruit-elle le passé et conséquemment ce passé n’est-il alors que relatif et rendant sans objet le travail patient, méthodique, scientifique de l’historien ?
White s’attaque ici à l’objectivité de l’histoire écrite censée rendre compte des faits passés. Depuis Metahistory, il ne cesse de reprendre l’idée que les choix d’écriture sont censés modifier l’exigence proclamée de description objective, s’inscrivant dans une pensée structuraliste dominante de l’époque. Pour démythifier la thèse courante que le discours historique est transparent et caractérisé par ce qu’il énonce explicitement – qu’il ne pourrait être un « méta-langage », il s’appuie sur la sémiologie, le déconstructivisme et la psychanalyse. Les formes de récit et de mises en intrigue qui sont ici mises en cause sont celles issues de la fin de la Renaissance à la fin du XIXe siècle et qui, remobilisées au XXe, lui apparaissent comme « conservatrices ». Ainsi, concernant la question de l’étude historique de la Shoah, il loue Maus. Un survivant raconte, le roman en bande-dessinée d’Art Spiegelmann pour « sa nouveauté et sa réflexivité » et seules Les années d’extermination de Saul Friedländer par son absence de narrateur omniscient et son refus de mise en intrigue lui apparaissent comme « progressistes ». Au vu de l’abondante « littérature » sur la question, on comprend pourquoi cette position « formaliste » s’est heurtée à l’objection de la centralité de l’atrocité des faits.
Invité à préciser sa position, dans l’essai sur les représentations de la Shoah il écarte les thèses négationnistes non pour des raisons morales mais pour des raisons épistémologiques : les « chercheurs » qui prétendent que les chambres à gaz n’ont pas existé ne travaillent pas selon les règles de la communauté historienne. De même, parler de « tragédie » comme le fait Andreas Hillgruber à la fois pour la fin du judaïsme européen et pour la destruction du Reich allemand est irrecevable car la Wehrmacht ne s’est pas comportée de manière noble… Il ne s’agit pas ici pour White de morale mais bien d’esthétique, le mot « tragédie » renvoyant à un type de rédit traversant la pensée occidentale au moins depuis Eschyle.
Le relativisme qui pour White caractérise toute entreprise historique pose le problème de la liberté du chercheur. Quand Chartier questionne White sur l’inutilité in fine du patient travail de recherche, de confrontation des sources et d’écriture des faits, il ne fait que défendre le caractère scientifique de la méthodologie utilisée par les historiens qui à ce titre inscrivent leur discipline dans le champ des sciences humaines. White est dans sa réponse plus proche d’un Michel de Certeau pour qui toute entreprise historique dépend d’un lieu, c’est-à-dire de conditions sociales et institutionnelles qui autorisent ou proscrivent non seulement tel ou tel sujet mais la manière dont il faut les aborder.
L’histoire écrite comme fiction
Il a été reproché à White de considérer l’histoire comme « fiction ». Ce qu’il avance, c’est que les données réunies par l’historien ne peuvent se transformer spontanément en livre mais passent nécessairement par une phase littéraire de « mise en texte » codifiée selon le genre « étude historique » car l’historien ne peut présenter des données brutes et doit donc les « modeler »; il ne fait là que reprendre la distinction de Ricoeur entre fiction comme « synonyme de configurations narratives » et non comme « antonyme de la prétention du récit historique à constituer un récit vrai ».
Il est clair que le romancier n’engage pas la même recherche de vérité que l’historien. Il n’empêche que pour ce dernier, le langage utilisé ne peut être innocent ou dénué par nature d’options politiques ou épistémologiques…
Réceptions de l’oeuvre de Hayden White
Même si ce fut peu le cas en France, Philippe Carrard rappelle que l’oeuvre de White a été amplement discutée de l’Europe au Japon. Il est néanmoins significatif que hormis pour Metahistory ce ne sont pas les historiens mais leurs collègues des sciences humaines qui l’ont commenté. Ce sont les essais consacrés au « passé utilisable » qui ont relancé les débats à partir des années 2000.
Sur sa réception en France, l’accueil fut froid pendant son cours séjour à l’EHESS (cf. supra), on ne peut que déplorer l’omission dont il a fait l’objet : si White cite fréquemment la dette qu’il doit à Barthes, celui ne le mentionne jamais dans ses écrits et rien n’indique qu’il l’ait lu. On aurait pu s’attendre à ce que des collègues prestigieux, critiques de la science historique comme Aron, Certeau ou Veyne l’aient commenté. C’est Paul Ricoeur qui souligne les contributions essentielles de White à l’analyse de « l’opération historique », c’est-àdire du « rapport du récit historique au passé réel » et le mérite d’avoir fait sauter les verrous des rapports de l’histoire à la fiction. Ricoeur par contre doute de l’intérêt réel de White aux « procédures scientifiques du savoir historique » est se demande en quoi l’adoption d’une écriture « moderniste » permettrait de « combler l’écart entre la capacité représentative du discours et la requête de l’événement ».
Si Roger Chartier reconnaît à White la faculté d’avoir obligé les historiens à « abandonner la certitude d’une coïncidence sans écart entre le passé tel qu’il fut et l’explication historique qui en rend raison » et admet que l’histoire avait longtemps « effacé les figures propres à son écriture dans la revendication de sa scientificité », d’autres historiens français ont pu se féliciter que les conceptions de White n’aient pas entamé » le principe de la quête de vérité comme intention fondamentale de la construction du savoir ».
Dans sa réponse à Roger Chartier il écrit : « A partir de l’idée que toute mise en récit est également « mise en allégorie », et que mettre en allégorie permet de donner aux événements une signification plus morale et éthique que simplement causale, j’ai pu lier le langage qu’utilisent les historiens pour décrire ces événements aux divers codes dont ils se servent pour leur attribuer une signification. Ainsi, j’ai pu expliquer comment différents historiens peuvent produire des analyses radicalement différentes des mêmes phénomènes, et cela sans déformer les faits ni violer les règles qui président au maniement des preuves documentaires. »
Le passé « utilisable »
Hayden White oppose dans … le passé « utilisable » au passé historique. Il s’en explique avec l’une de ses traductrices, Ewa Domańska : à propos de la possibilité de lois « mémorielles » comme celles existant en France et de l’implication de l’histoire dans l’actualité, White objecte que si la majorité des historiens ne souhaitent pas être instrumentalisés par le pouvoir, les politiques eux ont un intérêt tout particulier à un passé qui peut leur être utile en recherchant le soutien de tel ou tel groupe d’influence. De même, les communautés mémorielles n’ont pas à se voir dicter la manière dont ils devraient désigner les événements survenus dans leur passé. En fait, pour lui « les politiciens s’intéressent à ce qui fonctionne, les communautés à ce qui les réconforte, les blesse ou leur communique un sentiment de fierté. La plupart des historiens de métier nient que la connaissance du passé soit « utilisable », et ils pensent qu’il est illégitime de se servir de cette connaissance à des fins concrètes. »
En conclusion
Cette anthologie de textes de White permet de se familiariser avec une approche critique de la « science historique » aux titres volontairement explicites comme « le fardeau de l’histoire », mais aussi de découvrir combien l’historien américain a été marqué par la pensée philosophique, structuraliste et linguistique française, dans une approche de « déconstruction » originale, convocant Foucault, Kristeva, Ricoeur, Derrida, Laplanche… L’occasion de se rappeler combien la pensée française du XXe siècle a joué un grand rôle dans les études universitaires « modernistes » aux Etats-Unis.