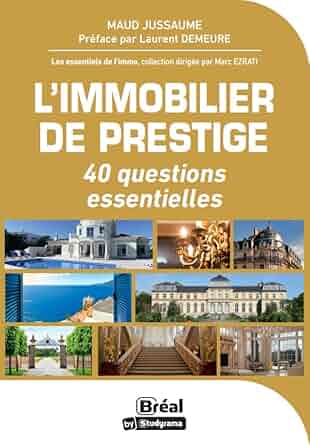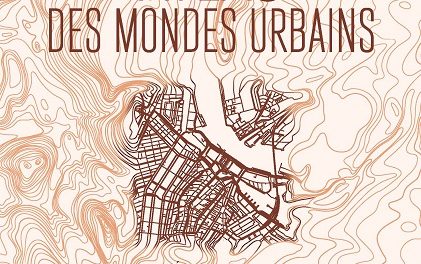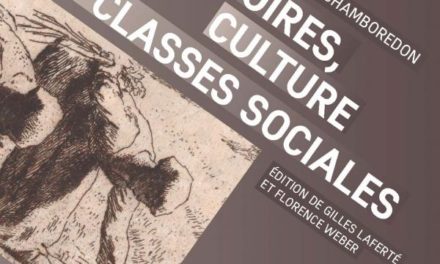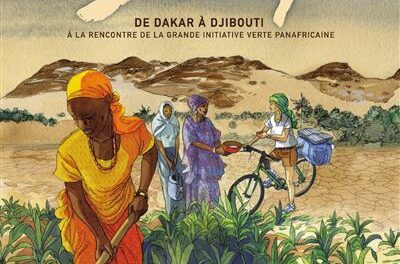Nos élèves sont souvent réactifs à l’évocation de hauts lieux du prestige comme Dubaï ou voient la possession d’une villa comme un aboutissement lorsqu’ils seront adultes. Au sein de l’étude de l’habiter et des questions relatives au logement, une occasion peut être saisie d’amener quelques éléments sur ce qu’on peut nommer « l’immobilier de prestige ».
La lecture de ce cours opus de Maud Jussaume, journaliste, permet d’éclaircir certains points sur cette thématique.
Sur des éléments de définition, on lira qu’un bien est considéré comme exceptionnel dès lors que sa qualité architecturale et esthétique est optimale, que son emplacement est perçu comme idéal (dont la vue « imprenable ») et que celui-ci ait un caractère réellement « unique ». Pour le reste, il peut s’agir d’une villa, d’un château, d’un mas ou encore d’un hôtel particulier.
Si la subjectivité est de mise (quel type de vue ? un voisinage urbain foisonnant ou alors un relatif isolement ? un minimalisme architectural ou alors de nombreux ornements ?), le critère objectif demeure le prix : il faut au moins dépasser le million (quelque soit la devise d’ailleurs).
On en apprend d’ailleurs un peu sur le type de personnes pouvant s’offrir ce type de biens avec les acronymes HNWI (« high net worth individual », à savoir une personne possédant au moins un million de liquidités) et UHNWI (« ultra high net worth individual », la même chose mais avec 30 millions de liquidités), fussent ces personnes des entrepreneurs, des célébrités ou des héritiers ; sur la typologie du marché (toujours en hausse de façon structurelle même si ces crises peuvent survenir par moments) ; sur les contraintes liées à la sécurisation nécessaire de tels biens (de la domotique high tech aux sociétés privées de surveillance).
Et outre les questions juridiques et celles liées à la posture de l’agent immobilier, certaines font l’objet d’une lecture spatiale pouvant interpeller le géographe.
C’est sans doute là que le propos est quelque peu dilué. On peut appréhender des éléments au sujet :
- Des catégories d’espace : ce qui est prisé se trouve du côté des zones balnéaires, historiques et de sports d’hiver ;
- Des régions françaises : Paris en valeur refuge mais également la Provence Côte d’Azur, les Alpes, Monaco, le littoral Breton/Normand et Basque,
- Du reste du monde avec, de manière très vague, une évocation de Dubaï, Miami et New York pour les Etats-Unis, Madrid et Milan pour la fiscalité avantageuse en Europe, Marrakech et Casablanca pour le Maroc.
La question climatique est rapidement abordée par endroits mais surtout au travers l’idée que les stations de montagne qui s’en sortiront seront celles qui auront misé sur l’adaptation à la saison estivale.
Vraiment pour une première approche car cet écrit manque de tableaux chiffrés, de photographies et de cartes pour appuyer ces considérations au demeurant très générales.