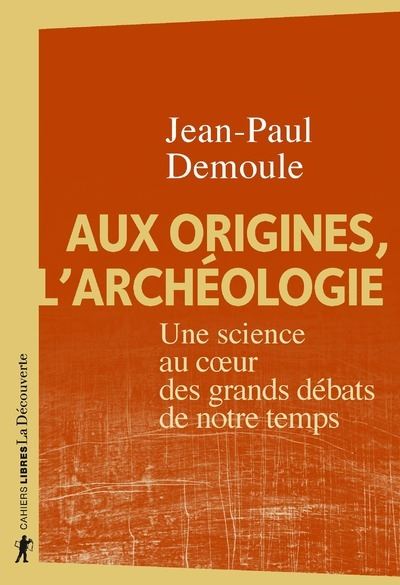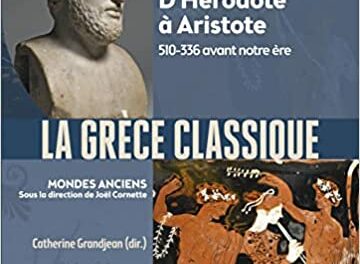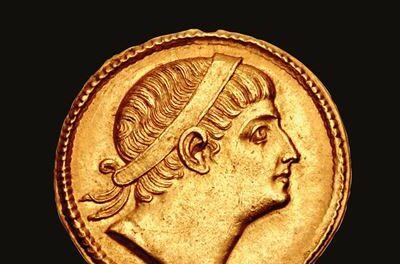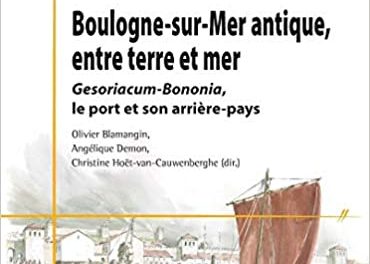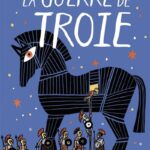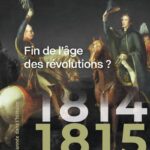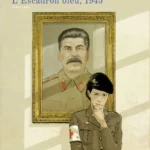Jean-Paul Demoule est archéologue et professeur émérite de Paris I, il est l’ancien président de l’INRAP. S’intéresser à l’archéologie revient à s’interroger sur les origines du monde, des humains, de chaque société et à se questionner sur la double fonction de l’archéologie, scientifique et idéologique. L’ouvrage débute par l’exemple du dernier roi de Babylone, Nabonide qui fait restaurer d’un temple construit 1500 ans plus tôt à Larsa par le roi Hammurabi. Son récit évoque les fouilles et la restauration, mais aussi l’utilisation du passé à des fins politiques. Jusqu’à la fin du XVIIIe s. et à la remise en question de la lecture littérale de la Bible, les religions limitent cependant le questionnement sur les origines et les objets du Néolithique retrouvés à la Renaissance sont considérés comme des curiosités naturelles.
Archéologie et « identité » : les manipulations de l’histoire
J.-P. Demoule évoque tout d’abord l’intérêt des présidents de la République pour l’histoire et l’archéologie. Il revient sur le projet de Nicolas Sarkozy d’une Maison de l’histoire de France en 2011 pour combler le manque d’un grand musée archéologique dans la capitale. Cela crée une polémique et Pierre Nora reproche au président de vouloir « renforcer l’identité nationale ». Cette identité est remise en cause par J.-P. Demoule qui met l’accent sur « un processus continu et permanent de mélanges, d’assimilations, de recompositions de populations sur un territoire donné » et décrit le baptême de Clovis comme « l’acte opportuniste d’un chef germanique pour mieux s’intégrer aux structures […] de l’empire romain, où le christianisme était la seule religion française ». Cet événement devient un mythe utilisé par la monarchie française pour renforcer sa légitimité et est souvent présenté comme la « naissance » de la France. Il revient également sur le débat autour de la localisation de la bataille d’Alésia, malgré les vestiges du siège retrouvés à Alise-Sainte-Reine et les travaux de Michel Reddé (Alésia, l’archéologie face à l’imaginaire, 2003). Le mythe d’une « France éternelle » dans les discours de Nicolas Sarkozy et de Charles de Gaulle est aussi évoqué.
Si l’archéologie est présente dans les discours politiques, la Préhistoire occupe cependant une place marginale dans les programmes scolaires, elle a été réintégrée en 2016 mais uniquement en classe de 6e. Dans les médias, les tribunes sont récurrentes pour déplorer le fait que les élèves n’apprendraient plus l’histoire de France. Ainsi, selon Jean-Paul Demoule, « il faut arrêter de penser qu’il y aurait une « France éternelle » à l’identité immobile, que l’arrivée récente de populations extérieures viendraient bousculer. Sur le temps long, on voit les choses autrement, l’histoire est un long continuum de brassage, elle est une recomposition permanentes ». Pour Alain Finkielkaut, ces propos illustrent une remise en cause de la nation française. Dans son émission Répliques sur France Culture, il développe l’idée erronée qu’il n y aurait pas de migrations majeure entre le Haut Moyen Age et le XIXe s. J.-P. Demoule qualifie, avec humour, de « point Finkielkraut », le moment où « une discussion, quel qu’en soit le sujet, en vient à évoquer les Arabes, les musulmans ou l’islam ».
Cette offensive nationale et réactionnaire s’est développée dans les années 1980, favorisée par une demande sociale d’histoire dans une période d’interrogation sur l’avenir. Cela favorise aussi l’archéologie préventive, mais aussi des ouvrages de vulgarisation plus ou moins sérieux.
J.-P. Demoule cite aussi des exemples de récupération politiques : les Gaulois sont ainsi récupérés à la fois par le FN, Nicolas Sarkozy et la mairie de Béziers. L’immigration est parfois comparée aux invasions barbares. Les migrations sont souvent minorées alors qu’elles ponctuent l’histoire de la France : Bretons, Arabes et Vikings au Ier millénaire, Anglais à partir du XIVe siècle, Tziganes, Juifs d’Espagne et Morisques aux XVe et XVIe siècles, cour accompagnant les reines de France et mercenaires aux XVIIe et XVIIIe siècles et enfin ouvriers italiens, belges, espagnols, portugais, polonais ainsi que des réfugiés politiques (Arméniens, Russes blancs, juifs d’Europe centrale, Républicains espagnols, allemands, italiens) aux XIXe et XXe siècles. Dans le sens inverse, il faut évoquer les protestants vers l’Angleterre et l’Allemagne après la révocation de l’édit de Nantes ainsi que les colons.
La germanité des Francs est gommée : Karl der Grosse vient Charlemagne et Aachen Aix-la-Chapelle. L’archéologie remet en cause l’idée d’un effondrement (notion étudiée par certains historiens comme Bryan Ward-Perkins, Eric Cline ou Jared Diamond). Or, les grands domaines agricoles et les villes continuent d’être occupés et les Barbares cherchent à s’intégrer à l’Empire. Les rois barbares se font représenter en empereurs romains comme Charlemagne.
Le mythe de Jeanne d’Arc récupéré par Philippe de Villiers lors d’une cérémonie grotesque du retour de l’anneau au Puy du Fou repose sur un anachronisme. La lutte contre les envahisseurs est en réalité une querelle dynastique. Jeanne d’Arc incarne le peuple à partir de Michelet qui en fait une héroïne. En 1920, elle est canonisée à partir d’une série de miracles qui auraient eu lieu au début du XXe s. A partir des années 1930, son image est récupérée par les mouvements d’extrême-droite.
L’archéologie, l’Europe, le monde et les fantômes de l’histoire
Dans les pays occidentaux, archéologie préventive et prévention du patrimoine dépendent avant tout des Etats. Aux Etats-Unis notamment, cohabitent une archéologie privée et une archéologie universitaire. Au Japon, cette archéologie privée est inexistante, alors que la Hongrie de Viktor Orban a entrepris le démantèlement de l’institut d’archéologie préventive et que le démantèlement des service publics en Grèce s’est accompagné de pression pour une privatisation de l’archéologie. J.-P. Demoule évoque les questions autour de la législation des fouilles préventives dans plusieurs pays et les problèmes qui se posent, puis aborde plus en détail les conséquences de la crise financière de 2008 sur l’archéologie en Grèce. Il développe ensuite l’exemple de l’archéologie japonaise, notamment après la catastrophe de Fukushima.
Sauver notre passé : une incapacité politico-administrative française
L’auteur expose la législation française à commence par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive et la création de l’Inrap, mais aussi l’ouverture à la concurrence depuis 2003 et les difficultés de financement de l’Inrap. Jean-Paul Demoule pointe les effets néfastes de ces mesures et récapitule les demandes des archéologue, il donne des exemples de destructions. Des tribunes des archéologues complètent son propos.
Jennifer Ghislain
______________________________
Jean-Paul Demoule est archéologue et ancien président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Il est professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
Archéologie et « identité » : les manipulations de l’histoire
Dans cette première partie, Jean-Paul Demoule explique, en 10 chapitres, comment l’histoire peut être instrumentalisée par les différents pouvoirs en place, par les hommes politiques, par les journalistes ou « pseudo-journalistes » au nom de l’identité française. On pense au projet d’une « Maison de l’histoire de France » lancée par Nicolas Sarkozy en 2009 pour renforcer « l’identité nationale » dans un contexte de montée du Front National ou l’histoire de la « bague de Jeanne d’Arc » montée de toute pièce par Philippe de Villiers pour attirer les visiteurs au Puy-du-Fou. L’auteur décortique les discours des hommes politiques pour montrer qu’ils correspondent bien peu aux découvertes archéologiques en les simplifiant à l’extrême.
On s’amuse du discours de Nicolas Sarkozy à Lascaux en septembre 2010 où il affirmait, en présence d’Yves Coppens, qu’il « faisait bon vivre » à cette époque pour l’homme de Néandertal, alors que Lascaux a été peinte en pleine période glaciaire et que l’homme de Néandertal avait alors disparu depuis au moins quinze millénaires … Les politiques se servent bien souvent de l’histoire et de l’archéologie pour alimenter un mythe qui les arrange comme la « prise en otage des Gaulois », utilisés à droite ou à l’extrême-droite.
L’auteur revient ensuite, avec l’exemple d’Alésia, sur le rôle des journalistes qui alimentent la polémique concernant la localisation précise du site lors de l’ouverture du « MuséoParc » d’Alésia, donnant la parole à des « révisionnistes » qui situent le site dans le Jura, alors que les nombreuses fouilles archéologiques menées à Alise-Sainte-Reine montrent les vestiges du siège qui correspondent aux descriptions de Jules César, ne laissant aucun doute sur la localisation de la célèbre bataille. Jean-Paul Demoule rappelle ici que la recherche scientifique et l’archéologie ne font pas le poids, dans le cirque médiatique, face aux polémistes dont les ouvrages sont en tête de rayon dans les librairies alors qu’on n’y trouve pas ceux des archéologues qui, preuves à l’appui, présentent les résultats de leurs travaux.
L’archéologie, l’Europe, le monde et les fantômes de l’histoire
Dans cette deuxième partie, l’auteur fait un inventaire des politiques en matière d’archéologie dans les autres pays. Il développe entre autres deux exemples : celui de la Grèce où l’archéologie pâtit des plans d’austérité et celui du Japon, pays qui dépense le plus au monde pour l’archéologie mais dont les moyens sont en baisse. Les politiques mises en place dans d’autres pays sont aussi expliquées pour montrer que partout, finalement, c’est le marché qui est le grand décideur. Jean-Paul Demoule montre aussi ici que les vestiges archéologiques sont souvent les premiers visés dans les conflits. Tout le monde se souvient de la destruction des monuments romains de Palmyre par Daesh en 2015.
Sauver notre passé : une incapacité politico-administrative française
Cette dernière partie relate la mobilisation des archéologues pour faire adopter des mesures de sauvegarde du patrimoine archéologique par les gouvernements successifs, aidés par un intérêt croissant des français pour cette discipline. De la bonne volonté affichée avec la demande de rédaction d’un « Livre Blanc » par un ensemble de professionnels en 2013 aux hésitations des politiques, enlisement de la réforme et relances de la part des archéologues, Jean-Paul Demoule, qui a participé aux travaux, nous relate le difficile combat pour « sauver le passé » en mettant en place une réforme de l’archéologie préventive, malgré la volonté des pouvoirs publics d’imposer leur idéologie néolibérale.
Jean-Paul Demoule nous livre un ouvrage très engagé où il fait un bilan des politiques mises en place depuis de nombreuses années sur l’archéologie. C’est un véritable plaidoyer pour l’archéologie préventive que fait l’auteur, qui a toujours donné de sa personne par sa participation à de nombreux ouvrages, colloques, émissions, commissions, etc. en tant que spécialiste reconnu.
L’ouvrage est de lecture aisée, accessible à tous, même sans connaissances particulières sur l’archéologie. La démonstration est appuyée de nombreux exemples dont l’auteur donne les références afin que chacun puisse aller consulter les articles ou les reportages qui illustrent son propos.