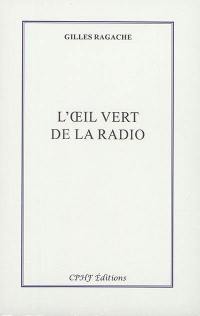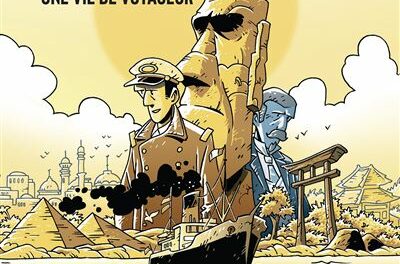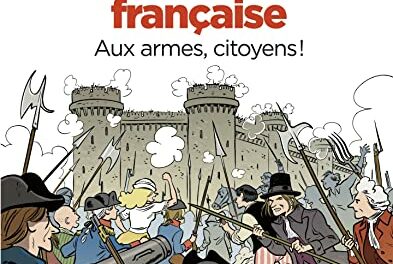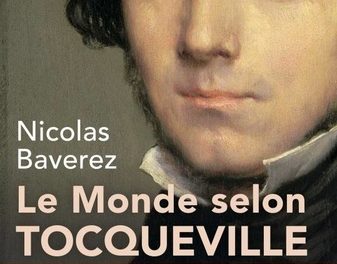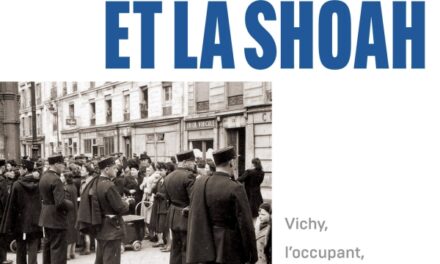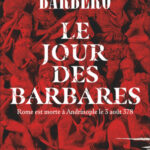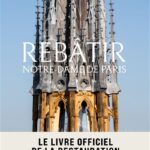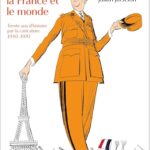L’auteur est historien et maître de conférences en histoire, il a publié de nombreux ouvrages sur la vie culturelle en France et la Seconde guerre mondiale.
Gilles Ragache propose ici un parcours nostalgique à la recherche des années d’enfance d’un petit parisien1. Un petit livre qui évoquera bien des souvenirs aux plus de 60 ans mais qui peut, par de courts extraits, donner vie à une approche de l’après-guerre et des «30 glorieuses pour des élèves de cycle32, des tranches de vie émouvantes ou drôles, fragments de mémoires.
Après le poste de radio et son œil vert vient le temps des vacances à la Tati et du Tour de France. Avec la rentrée des classes la discipline est sévère mais les sucreries si alléchantes.
Les menus objets du quotidien sont vus à hauteur d’enfant : porte-plume et stylo bic, buvard et « réclame », soldats Mokarex, chèque Tintin à découper sur les boites de produits du quotidien pour un petit cadeau, images du chocolat à coller dans des albums. Les souvenirs sont aussi olfactifs : café, encaustique ou gustatifs : eau coupée de vin, limonade.
Ce récit bien mené permet d’évoquer la France des Années 50 : le ravitaillement de Paris aux Halles en pleine ville, les courses quotidiennes de la ménagère ou de ses enfants en l’absence de réfrigérateur et les petits commerces du quartier. La crise du logement, étroit, peu équipé et la machine à laver le linge achetée au comptant. Les habitudes alimentaires et de boisson peuvent paraître étranges au lecteur d’aujourd’hui. Le progrès arrive lentement : électro-ménager (moulin à café électrique et « frigidaire »), le téléphone si rare encore, la voiture dont on compare les différents modèles et enfin la télévision.
Une plongée sympathique dans les Années 50, un réel plaisir quand on les a connues.
1 En fait il habite Issy-les-Moulineaux
2 A compléter avec un album d’Yvan Pommeaux, Avant la télé, École des Loisirs, 2002 et François Bertin, Souvenirs d’enfance, des objets racontent,Ouest-France Éditions, 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________
CR de Bruno Modica
Clefs pour l’Histoire de France CPHF Editions
Le hasard d’une sollicitation comme nous en recevons énormément, sur les réseaux sociaux, m’a fait découvrir cette maison d’édition, clefs pour l’histoire de France, chez laquelle l’auteur, Gilles Ragache publie l’essentiel de ses ouvrages.
Né en 1946, diplômé de Sciences-Po Paris, Gilles Ragache s’intéresse plus particulièrement à l’Histoire contemporaine de la France. Il a ainsi publié plusieurs ouvrages consacrés à la Seconde guerre mondiale, et plus largement à la vie politique, militaire et culturelle des années 1930 à 1970.
Il est également l’auteur, chez Economica, d’un ouvrage intitulé : « La France sous les bombes Allemandes. Anglaises. Américaines (1940 – 1945)»
Ce qui a retenu mon attention dans le catalogue de cette petite maison d’édition dirigée par Hervé Luxardo, lui aussi historien, a été cet ouvrage de Gilles Ragache « l’œil vert de la radio » – nos années 50. J’ai immédiatement pensé à l’intérêt que cet ouvrage pouvait présenter pour donner un peu de vie en complément de publications bien austères, sur la question des concours en histoire contemporaine pour les agrégations d’histoire et de géographie, l’agrégation interne, et le CAPES.
L’intitulé de la question, nous le connaissons tous, « culture, médias et pouvoirs, aux États-Unis et en Europe de 1945 à 1991 ». Mais encore faut-il s’entendre sur la question de la culture, notion vague s’il en est.
Dans cet ouvrage qui se lit avec une incontestable jubilation, lorsque l’on a commencé son existence dans les années 50 justement, on retrouve les éléments de ce que l’on pourrait appeler la culture matérielle dans laquelle l’auteur de ces lignes, et quelques autres, ont baigné dans leur enfance.
Il ne faut pas y voir simplement de la nostalgie, même si on a le droit de la cultiver, mais simplement l’intérêt de retrouver de très nombreuses références. L’œil vert de la radio, avant que le petit écran ne s’impose, constituait incontestablement l’ouverture au monde privilégiée, même si la presse écrite restait tout de même la référence. On appelait cet outil encombrant qui trônait dans la pièce de vie, cuisine ou salle de séjour, mais également dans les cafés, et dans certains magasins, « le poste ». Ce poste de radio qui ne comportait pas de transistors, mais des lampes, était un format imposant, et il fallait rechercher les stations en manipulant un bouton qui faisait bouger une aiguille permettant d’obtenir un son qui n’avait rien de stéréophonique. Cette écoute de la radio n’était en aucun cas exclusive. Les familles réunies se livraient à leurs occupations, Madame finissait de ranger la vaisselle, monsieur lisait le journal, tandis que les enfants faisaient leurs devoirs. (Dans cette période où l’on peut être très vite accusé de sexisme, je tiens à préciser qu’il ne s’agit en aucune façon de faire une promotion d’un modèle familial patriarcal, mais simplement de décrire la réalité.)
Le poste de radio servait d’ailleurs de support aux discussions familiales, et il était possible de « parler en même temps que le poste ». Ce qui signifiait que l’on commentait les informations politiques nationales, sportives, et même internationales. C’est ainsi que je me souviens, comme si c’était hier, de l’annonce de la mort du président Kennedy en 1963.
Mais il y avait aussi ces émissions, de véritables feuilletons, comme « les maîtres du mystère » ou encore « les nuits du bout du monde ». Le rêve s’invitait aussi avec l’émissions « reine d’un jour », ou une femme quelconque pouvait connaître la célébrité pendant 24 heures, en étant invité à Versailles, habillée par de grands couturiers, longuement entendue à la radio, avant de retourner à l’anonymat. Quand on voit comment la télé réalité a pu fabriquer d’étranges créatures du petit écran, on peut comprendre une certaine nostalgie pour « reine d’un jour ».
Le lien avec la presse écrite existait également, avec ce que l’on appelait le feuilleton : « la famille Duraton » racontait les aventures, ou plutôt la saga quotidienne d’une famille dans laquelle chacun pouvait se reconnaître.
Les jeux radiophoniques, les chansonniers, agrémentaient le tout, avec quelques interruptions pour la réclame.
Le choix qui est fait de présenter cet ouvrage, sous l’angle de la radio, sur la Cliothèque, est le point de départ d’une réflexion qui sera poursuivie sur Clio prépas, dans la mesure où, comme cela a été dit plus haut, cela s’inscrit clairement dans une réflexion que l’on peut avoir dans le cadre du concours.
Au-delà d’ailleurs du concours, on peut lire cet ouvrage avec beaucoup d’intérêt, d’une part en raison de la qualité de son écriture et de cette sensation douce-amère que l’on peut avoir devant le temps qui passe. Pour les plus jeunes, ceux qui n’ont pas connu la famille regroupée autour « du poste », l’écriture avec les plumes sergent major, les bâtons de bois de réglisse, les objets publicitaires des caravanes de tour de France, cela leur permettra peut-être de comprendre que cette matérialité des années 50 était fondamentalement différente de celle que nous connaissons aujourd’hui.
L’instantanéité au détour d’un clic de souris, la surabondance des écrans, la dispersion de l’information sous toutes ses formes, ont pu constituer une mutation culturelle majeure.
Et la perception que l’on peut en avoir en ressort forcément enrichie par ce regard dans le rétroviseur.