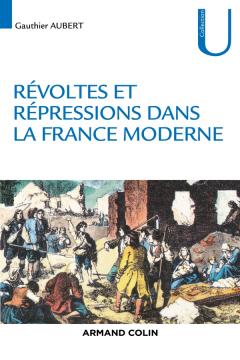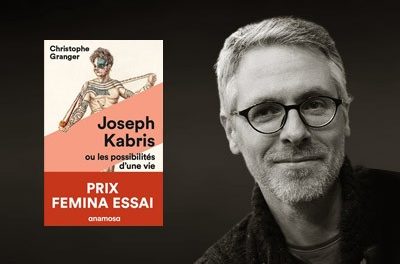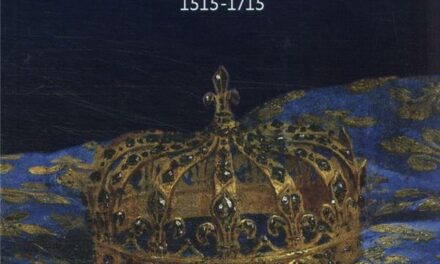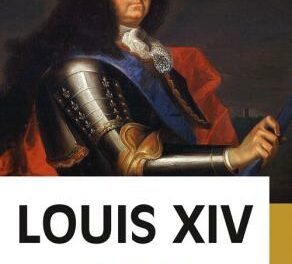« […] Dès juillet 1630, le chancelier de Marillac note que ‘’tout est plein de séditions en France’’ »
Gauthier Aubert, Révoltes et répression dans la France moderne, Armand Colin, 2018, p. 39.
« Alors que le fait rébellionnaire occupe une place de plus en plus marquée dans l’actualité du monde contemporain, l’étude des révoltes à l’âge moderne peut de son côté sembler passée de mode ».Gauthier Aubert, Révoltes et répression dans la France moderne, Armand Colin, 2018, p. 4. Étrange paradoxe car la France des XVIe-XVIIIe siècles est marquée par des périodes de rébellions et de révoltes, qui culminent avec la Révolution. Cet ouvrage, sous la conduite de Gauthier AubertGauthier Aubert, est membre du CERHIO-Rennes (UMR CNRS 6258). Après avoir passé l’agrégation en 1994, il a entamé une thèse sous la direction d’Alain Croix soutenue en 2000 intitulée La Noblesse, le pouvoir et le savoir dans la Bretagne des Lumières, d’où il a tiré un livre : Le Président de Robien, gentilhomme et savant dans la Bretagne des Lumières. Recruté comme maître de conférences en Histoire moderne à l’Université de Rennes 2 en 2002, il a orienté ses recherches vers l’histoire sociale et politique des gens de robe. Il a en particulier dans ce cadre organisé avec Olivier Chaline en 2008 un colloque sur Les parlements de Louis XIV, dont les actes ont été publié aux PUR en 2010. Dans le même temps, il a activement participé au programme de l’ANR « Conflits et politisation ». S’intéressant au rôle des gens de justice dans les révoltes, il a publié plusieurs articles sur les révoltes de 1675, ainsi qu’un livre : Les Révoltes du papier timbré, 1675. Essai d’histoire évènementielle, en 2014, tout en continuant de travailler sur le fait rébellionnaire et les processus de contestations…, constitue le premier manuel exclusivement consacré au fait rébellionnaire et ouvre un champ d’étude et de réflexion sur ce phénomène essentiel, au cœur de l’histoire politique de la France à l’époque moderne. L’auteur, professeur d’histoire moderne à l’Université Rennes 2, reprend ici, sous une forme enrichie et remaniée, une série de cours donnés à ses étudiants de licence.
Outre l’étude de la mise en place de l’absolutisme et ses implications sociales et culturelles, il établit les jalons d’une histoire du maintien de l’ordre et de la répression, en mettant en lumière ses traits originaux comme l’importance des processus de médiation, longtemps occultés.
_______________________________________________________________________________________________________
Dans un premier temps, l’ouvrage déroule, sur trois siècles, la trame événementielle des mouvements de révolte, populaires comme nobiliaires, en présentant le contexte, les acteurs et les réponses du pouvoir.
Tout d’abord, l’auteur s’intéresse aux révoltes nobiliaires. Ces « révoltés de sang bleu » constituent une part peu importante d’individus de rang social élevé, bien qu’ils puissent mobiliser un nombre plus ou moins important de partisans. Arlette Jouanna et Denis Richet ont contribué à enrichir les études sur ces révoltes qui ont longtemps eu mauvaise réputation. Ainsi, cette noblesse se doit de conseiller le prince tout en protégeant l’État et la société des abus de ce dernier. Depuis le Moyen Âge, les relations conflictuelles entre les princes et les nobles existent et les révoltes de sang bleu sont constitutives de l’affirmation de l’État (XIIIe et XIVe siècle). Outre des motifs visant à la défense ou la réforme de l’État (idéal du « bien public »), des motifs plus individuels (volonté d’élévation sociale, prestige, religieux…) motivent certains nobles à entrer en révolte. Avec l’affirmation d’un monarque absolu, on assiste à un désengagement de la noblesse du champ rébellionnaire (la « contagion de l’obéissance », René Pillorget), processus « facilité par le fait que les gens qui se révoltaient le faisaient de plus en plus nettement pour obtenir des avantages matériels dont l’importance reposait, en bout de chaîne, sur l’impôt du roi ».Gauthier Aubert, Révoltes et répression dans la France moderne, Armand Colin, 2018, p. 23. Les intérêts personnels dans la noblesse ont ainsi largement pris le dessus sur les intérêts collectifs en faveur du « bien public », à partir du XVIIe siècle.
Parallèlement aux soulèvements nobiliaires, existent des révoltes « populaires », terme débattu du fait de la diversité des révoltés où l’on peut trouver aussi bien des paysans que des nobles, des ecclésiastiques ou des bourgeois. L’une des questions que se pose Gauthier Aubert dans ce chapitre des « révoltes des peuples au XVIe siècle » est justement de savoir dans quelle mesure « la révolte est la lutte entre des classes sociales ou entre des communautés unies par-delà leurs différences sociales contre un ennemi extérieur, l’État en l’occurrence » (p. 29). La question de l’impôt est la principale cause de ces révoltes avec un nouveau cycle rébellionnaire et paysan important qui émerge dans les années 1540 avec la pression de la hausse de la gabelle et autres taxes, conjointement aux dépenses militaires croissantes. L’exemple significatif de la révolte du Sud-Ouest en 1548, durant laquelle des milliers de paysans armés (les « Pitauds ») se dirigent vers les villes trouvant parfois le soutien des habitants, eux-aussi hostiles à l’augmentation des taxes est développé. Cette révolte préfigure par bien des aspects, les contestations fiscales qui auront lieu durant le siècle suivant. L’auteur constate une évolution similaire entre révoltes populaires et mouvements nobiliaires : « une agitation à la fin du XVe siècle, puis une période de calme relatif durant la première moitié du XVIe siècle, suivi d’embrasements successifs qui se lovent dans les méandres des guerres de religion ».Ibid., p. 37.
L’extraordinaire densification du flux rébellionnaire s’effectue au XVIIIe siècle, notamment dans le second tiers du siècle, la contestation ciblant dans l’immense majorité des cas, la fiscalité royale. Cette nouvelle période de trouble « l’âge d’or des Croquants (1600-1660) » s’ouvre en effet avec la remise en ordre fiscale du royaume au début du XVIIe siècle. L’annonce de la nouveauté fiscale, le plus souvent une taxe sur la consommation, unit consommateurs, commerçants et producteurs dans une agitation d’abord urbaine (notamment Lyon, Rouen, Poitiers). L’entrée dans la guerre ouverte contre les Habsbourg en 1635 cristallise les tensions. Ces contestations antifiscales contaminent notamment les communautés rurales. Pour les révoltés, le « roi est trompé et ignore tout de la misère de ses sujets » (p. 46). L’action paysanne peut s’analyser en deux temps. D’abord une chasse aux gabeleurs impliquant le pillage de leurs biens et parfois de leur mort (défiscalisation du territoire insurgé) et dans un deuxième temps l’assaut par les armées des villes réputées être le refuge des gens de finance. Ici, la jonction est parfois faite avec les gens de la ville (mais pas systématiquement). L’exemple le plus célèbre de ces embrassements paysans antifiscaux du XVIIe siècle (« Croquants ») est sans doute celui du Périgord qui débute par l’assassinat de deux sergents (les « agents du fisc ») et se poursuit par l’assaut de Périgueux par près de 5000 hommes puis l’entrée de 8000 hommes armés et organisés sur le mode militaire qui font leur entrée dans Bergerac où ils installent leur quartier-général (p. 47). La révolte des Sabotiers (1658) marque la dernière grande révolte rurale du temps des cardinaux-ministres. La période de la Fronde, période d’affaiblissement des structures étatiques, est propice aux résistances antifiscales reliées plus ou moins au contexte politique d’alors.
Si les historiens avaient pris l’habitude de considérer que les années 1660 marquaient une rupture en matière de révoltes antifiscales, les travaux de Jean Nicolas montrent que le front intérieur fiscal, non seulement ne disparaît pas, mais connaissait une véritable poussée, en particulier dans le domaine de la contestation des impôts réels (p. 57). Gauthier Aubert, dans son chapitre « Les frondes du peuple (1660-1789) » explore notamment la/les mutation(s) de cette contestation antifiscale et du fait rébellionnaire entre les règnes de Louis XIV et de Louis XVI (notamment l’espacement graduel de ces grandes révoltes, la contestation en premier lieu des impôts indirects et le déclin de la présence des notables). Il tord ainsi le coup à l’idée souvent exposée d’un consentement de l’impôt comme marqueur de la seconde modernité (p. 67).
Dans « L’impossible multiplication des pains », l’auteur développe les questions des « révoltes de la faim » (p. 71) car « à côté de la question fiscale, la question frumentaire fait figure d’autre massif rébellionnaire » (p. 71). Ce type de révolte est d’abord printanier (entre mars et mai majoritairement), se déploie à 80% (entre 1661 et 1789) dans un cadre urbain et est d’une durée assez courte (le pillage ou une distribution de grains y mettent fin), l’émotion enfin, y joue un grand rôle. La crise alimentaire est ainsi un enjeu majeur pour les gouvernants, du roi aux autorités locales car le « fondement même du bon gouvernement est d’assurer la survie de tous » (p. 80).
À côté des questions fiscales qui sont la cause de frictions entre l’État incarné dans la personne du monarque et ses sujets, d’autres acteurs ou facteurs peuvent jouer un rôle important dans le déclenchement de la mécanique rébellionnaire : l’armée, la justice (ou l’injustice de certaines décisions), la volonté d’imposer l’unicité du royaume autour d’une même religion et l’intolérance religieuse, les inspecteurs du roi, etc. Dans le chapitre « L’État contre la société (XVIe-XVIIIe siècle) », est questionnée la question de « l’ordre » au cœur de « la définition d’un pouvoir qui se veut absolu et qualifie de désordres les oppositions qu’il rencontre » (p. 82). Les choses se compliquent ainsi parfois quand l’« État non seulement peut provoquer, mais inventer le désordre, car ses exigences entrent en collision avec d’autres régimes d’ordre » (p. 82).
Dans « la société contre elle-même (XVIIe-XVIIIe siècle) », l’auteur s’attache aux agitations que connaît la société, par définition plurielle, avec des mouvements ne concernant pas (ou pas directement), l’action de l’État, c’est-à-dire pas liés forcément à l’action décidée par le pouvoir politique. Sans dresser un inventaire complet de ces mouvements de révoltes, Gauthier Aubert recense, entre 1600 et 1789, les principaux types de conflits collectifs où, « l’étranger, l’ecclésiastique, le seigneur et le patron forment les principales figures qui peuvent être les cibles d’émeutiers » (p. 97).
Dans un second temps, ce manuel se consacre aux approches transversales et au décryptage de ces épisodes : quels sont les mots, les modalités, les temps et les lieux, les figures de la révolte ? Quelles sont les formes de règlement, pacifique ou violent, de ces épisodes par les autorités ?
Le vocabulaire pour désigner la révolte est varié : de « rébellion » à « émotion », la large palette utilisée par les autorités doit ainsi être décodée par les historiens selon une double grille de lecture : les niveaux d’intensité et des formes de révoltes d’un côté, et de l’autre ils sont des outils servant un discours qui doit être à chaque fois contextualisé. Il y a un écart entre « la richesse des mots qui disent la révolte et la rareté des images qui la montrent » (p. 117). Cette faiblesse des représentations du fait rébellionnaire est particulièrement nette dans le domaine français (p. 121).
« Où et quand naît la révolte ? Pratique foisonnante, reflet des actions les plus variées, la révolte est par définition diversité. Elle peut naître en tout temps et en tout lieu » (p. 127). Dans ce chapitre intitulé « Décors », les questions des temps et espaces du fait rébellionnaire sont explorés pour essayer d’en dégager de grandes tendances malgré la grande diversité des situations et dans certains cas, une certaine forme de mystère encore vive.
Les « modalités » (les principales étapes) des révoltes sont ensuite analysées. Dans une révolte, « moment d’expression politique collectif fondé sur la violence » (simple, contrainte ou massacre)Ibid., p. 141., se présente en deux temps. D’abord celui, analysé dans ce chapitre par l’auteur, de sa montée en puissance, de son organisation et de son extension (le moment le plus long) et dans un second temps celui de sa résolution.
Qui sont « les révoltés » ? Si l’on s’intéresse à la sociologie de la révolte et aux acteurs qui l’ont porté, il s’agit d’examiner ce qui se cache derrière le terme vague de « peuple » qui est l’acteur principal du fait rébellionnaire. En dehors des aspects sémantiques, l’auteur s’attaque à interroger la place d’une partie des composantes de celui-ci dans les révoltes : femmes, enfants, meneurs, élites etc. L’étude de la complexité de la société et de ses différentes composantes révèle ainsi une sociologie complexe du fait rébellionnaire épousant « les formes du corps social » (p. 181).
L’étude des « forces de l’ordre », dessine, elle aussi, un paysage complexe. À travers une grille de lecture « weberienne » largement partagée par les historiens, l’époque moderne apparaît comme une époque de confiscation progressive de la « violence légitime » par l’État qui « tend à reléguer et à disqualifier les forces de l’ordre trop autonomes » (p. 183). Par-delà « la diversité de ces forces de l’ordre, une série de tendances se dessine tout au long de la période : l’étatisation et son corollaire, une professionnalisation croissante, ainsi qu’un meilleur maillage du territoire » (p. 199).
« Comment protéger l’ordre social et politique lorsque celui-ci est violemment contesté ? En réprimant, dira-t-on » (p. 201). La démarche n’est pas aisée car maintenir l’ordre consiste en réalité à assurer la paix ou à la ramener. Pour conserver (ou rétablir) la concorde sociale, l’apaisement semble d’abord la première chose à faire pour le pouvoir. Si la fronde était menée contre les décisions royales, il s’agit ensuite pour le monarque de réprimer puis punir les révoltés afin de dissuader toute nouvelle tentative à venir, le but étant de cibler les meneurs, réels ou supposés, et d’en faire des exemples. Quand il apparaissait « que la révolte présentait une dimension communautaire, les punitions dépassaient le cadre individus effectivement condamnés » (p. 208) avec par exemple la ville de Lapalisse, en Bourbonnais, en 1736 qui suite à une émeute antifiscale, est assignée à comparaître et désigner un député pour plaider sa défense.
_______________________________________________________________________________________________________
En définitive, à travers une palette d’exemples savamment abondés de références pour compléter le propos et aller plus loin (13 pages d’une bibliographie « sommaire »), ce livre est une riche synthèse sur le fait rébellionnaire en France à l’époque moderne et le replace dans les débats et avancées historiographiques les plus récentes. Bien écrit, il conviendra à un public de licence auquel il s’adresse en premier lieu mais il sera également une base solide à (re)consulter pour les étudiants et étudiantes se destinant aux concours de l’enseignement (Capes et Agrégations externes d’Histoire et de Géographie) qui ont à plancher sur la question : « État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640 – vers 1780) ».