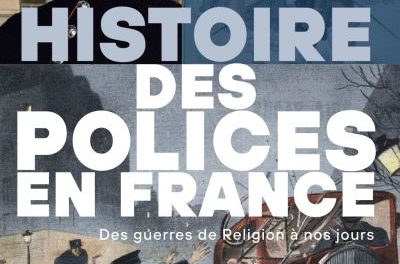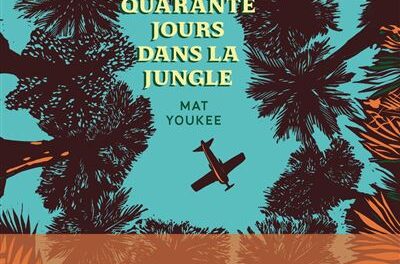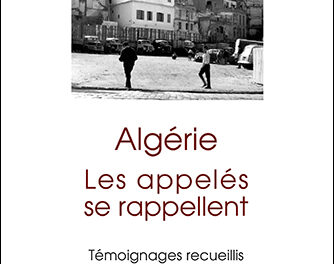Ce livre de 1983 a été traduit en français en 1995 sur le conseil de Denis Peschanski et publié avec une préface où l’auteur exposait les évolutions qui avaient affecté, dans l’intervalle, l’historiographie et ses propres conceptions. Le tout est réédité en poche aujourd’hui sans la moindre correction.
Ian Kershaw, venu de l’histoire médiévale, s’était intégré au milieu des années 1970 aux équipes dirigées par Martin Broszat qui étudiaient la vie quotidienne en Bavière sous le Troisième Reich. Il en avait profité pour écrire deux livres devenus classiques, l’un sur le « mythe de Hitler » et celui-ci, qui étudie les réactions de la population bavaroise au nazisme dans certains domaines et s’efforce de les généraliser avec prudence à l’Allemagne tout entière. Trois domaines sont abordés : la vie économique, la vie religieuse et la question juive. Les deux premiers ont vu se manifester des oppositions parfois fortes, aboutissant dans quelques cas à des reculs du pouvoir. Dans le troisième, on ne constate aucun phénomène de cette sorte, mais pas non plus beaucoup d’adhésion populaire aux obsessions antisémites du régime.
Outre les sources, les méthodes et la problématique, l’introduction présente un tableau synthétique de l’économie, de la société et de la vie politique en Bavière lors de l’accession des nazis au pouvoir. La première partie commence par reprendre plus en détail le tableau de l’agriculture, pour analyser ensuite les opinions exprimées par les paysans. Le mécontentement domine, malgré l’augmentation du revenu agricole pendant les premières années. Il est causé essentiellement par les mesures autoritaires du régime, qui suscitent parfois des craintes irrationnelles comme dans le cas du « domaine héréditaire inaliénable » cher au ministre Darré, qui ne concerne que les grosses fermes mais affole les propriétaires des petites. Dans les années précédant la guerre, malgré les subventions du « Plan de quatre ans » destinées à favoriser l’autarcie, la situation des campagnes s’aggrave en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ; l’attrait des emplois industriels que multiplie le réarmement ne saurait en effet être compensé par la mécanisation puisqu’on fabrique des chars plutôt que des tracteurs ; il faut recourir de façon croissante à la main-d’œuvre étrangère. Les rapports rédigés par les SS du Sicherheitsdienst (SD) et ceux de la Sopade socialiste (centralisant dans les pays limitrophes des données arrivées clandestinement) convergent pour décrire une paysannerie soit indifférente au nazisme, soit franchement hostile.
Un tableau complet
Le chapitre sur la classe ouvrière commence par indiquer qu’elle est plus rare en Bavière que dans d’autres régions et que les nazis n’y ont pas fait les mêmes efforts de séduction « socialiste ». De même, après la prise du pouvoir, la répression l’emporte sur l’endoctrinement. La passivité des directions socialiste et communiste les discrédite et l’apolitisme s’installe ; les « assemblées d’usines » instaurées par le pouvoir sont boudées, ainsi que les séances de cinéma à thèmes politiques ou les fêtes du calendrier nazi, comme l’anniversaire du putsch de Munich. Les problèmes matériels engendrent cependant des manifestations de mécontentement, surtout en 1935-36. Dans les années suivantes et jusqu’à la guerre, la croissance de la production industrielle et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée favorisent l’augmentation des salaires, même sans organisation et sans grève. Malgré tout cette augmentation résulte surtout de l’allongement de la durée du travail. Et le mécontentement économique comme les victoires revendicatives ne débouchent sur aucune remise en cause du régime.
Il en va de même dans les classes moyennes et supérieures qui font l’objet du troisième chapitre. C’est le seul des milieux étudiés où le nazisme ait recruté un nombre important d’adhérents mais, une fois au pouvoir, il y suscite un profond « désenchantement », perceptible dès 1934. Là encore, la priorité donnée au réarmement a des effets négatifs, du moins dans les secteurs délaissés. On voit notamment se développer des critiques contre les cadres du régime, en exceptant le Führer. En retour, ces mêmes cadres se plaignent de l’égoïsme petit-bourgeois de tous ces commerçants ou entrepreneurs incapables d’adopter un « esprit national-socialiste ». Une déception identique se fait jour dans la fonction publique et l’enseignement, devant une augmentation de la charge de travail liée aux tâches supplémentaires réclamées par le régime et la stagnation des revenus, sans parler du nombre d’élèves par classe, qui passe par exemple de 39 à 45 dans le primaire. Un tiers des enseignants, cependant, a rejoint le parti nazi en 1937, contre un quart en mai 1933 (date de la suspension provisoire des adhésions).
Les enseignants aussi
Détail pittoresque, certains se plaignent d’avoir à continuer l’enseignement religieux et notamment des leçons sur l’Ancien Testament alors qu’ils attendaient qu’un régime aussi mécréant et antijuif les en dispense, mais ce régime y voit un moyen de limiter l’influence du clergé. Ces chiffres et ces sentiments reflètent un degré certain d’adhésion au nazisme sur le plan idéologique, notamment chez les instituteurs, souvent mus par l’anticléricalisme. Mais leur grogne contre la détérioration des conditions professionnelles n’en a que plus d’écho. Au total, la dégradation de l’image du régime est bien symbolisée par la détestation dont fait l’objet Christian Weber, qui avait débuté comme petit chasseur d’hôtel. Ce nazi de la première heure devenu homme d’affaires est appelé par dérision le « roi de Munich », car il a tout simplement installé ses pénates dans le palais des Wittelsbach. Mais dans les milieux bourgeois petits et grands, « doléances et soumission » font bon ménage, comme dans les autres.
L’auteur aborde alors les questions religieuses, par un chapitre sur le protestantisme, minoritaire dans la plupart des régions bavaroises mais majoritaire en Franconie. Le protestantisme bavarois, assez bigarré et divisé, comportait une composante nationaliste qui se rapprocha du nazisme sans trop d’états d’âme et lui donna dès 1932 des scores électoraux impressionnants dans certains endroits. En mai 1933 les églises luthériennes de Bavière élurent pour évêque Hans Meiser, rallié au régime nazi mais soucieux d’indépendance religieuse. Il entra vite en conflit avec Ludwig Müller, proclamé « évêque du Reich » le 27 septembre 1933 et membre de la mouvance nationaliste des « chrétiens allemands » -qui s’était ralliée au nazisme en professant des théories telles que l’« aryanité » de Jésus. Au plan national, cela avait déclenché le schisme d’une « Eglise confessante » (et non « confessionnelle » comme l’écrit le traducteur !) animé notamment par le pasteur berlinois Martin Niemöller. En Bavière, le clivage prit la forme d’une rébellion de plus en plus profonde et visible de Meiser contre l’autoritarisme de Müller, dénoncé en chaire en mai 1934. Le 11 octobre, Meiser fut destitué et mis en résidence surveillée. Le scandale fut massif, les pétitions et délégations se succédèrent et le proscrit fut réintégré au bout de deux semaines avec les honneurs, y compris celui d’être reçu par Hitler.
Questions religieuses
Kershaw nous présente le catholicisme bavarois, très majoritaire, comme une véritable contre-société attachée non seulement à sa foi mais à toutes sortes de rites et de particularismes, dotée d’une capacité de résistance au pouvoir central inaugurée sous Bismarck et sur laquelle le gouvernement nazi a peu de prise. Ainsi de véritables mouvements de masse, souvent victorieux, s’opposent à des mesures telles que le report au dimanche des fêtes religieuses qui devraient avoir lieu en semaine ou l’interdiction des drapeaux jaunes et blancs de l’Eglise. Ainsi certains prêtres arrêtés pour « propagande antinationale » sont libérés sous la pression de la rue. En attendant la fameuse affaire du retrait des crucifix des salles de classe et le recul du pouvoir, en 1941, que l’auteur aborde dans un chapitre ultérieur. Il fait remarquer, pour le déplorer, que « l’indomptable cardinal Faulhaber » et les sept autres évêques, tous clairement antinazis, n’ont rien fait pour donner un débouché politique à ces protestations. Ils se sont notamment laissés dépouiller, malgré le concordat signé par Pie XI avec le gouvernement Hitler en juillet 1933, de l’enseignement confessionnel, entre 1936 et 1938. Dans le secondaire, les religieux sont purement et simplement interdits d’enseignement et dans le primaire se développe une « école interconfessionnelle », tirant parti de vieilles revendications laïques pour fusionner les écoles catholiques et protestantes et leur retirer toute référence chrétienne. Le régime utilise aussi –« à sa manière pseudo-plébiscitaire », note Kershaw- les questionnaires remis aux familles avant la rentrée pour mesurer leur attachement à l’enseignement confessionnel et s’appuie sur la baisse des chiffres pour justifier son extinction, en quelques années.
Le sixième chapitre, consacré aux réactions à la persécution des Juifs, débouche sur une conclusion devenue classique : « Si elle fut le fruit de la haine, la route d’Auschwitz fut pavée d’indifférence ». Kershaw s’oppose ici à une Lucy Dawidovicz, pour qui Hitler enrôle les Allemands dans une « guerre contre les Juifs », à un Kurt Pätzold pour qui il détourne par l’antisémitisme la colère des masses au profit du grand capital, ou à son maître Martin Broszat pour qui l’antisémitisme est manié par le régime pour masquer ses échecs et créer une « dynamique négative ». Il montre que, si le nazisme a mis à profit un « vieil antisémitisme », celui-ci n’a pas compté beaucoup dans les motivations des Bavarois qui adhéraient au nazisme, ni dans la passivité de ceux, plus nombreux, qui laissaient faire. Les mots d’ordre de boycott des commerçants juifs, en particulier, se heurtaient aux intérêts des paysans vendeurs de bétail, car ce commerce était en Bavière l’apanage des Juifs jusqu’à ce qu’on leur interdît toute activité économique, en 1938. La Franconie tranche un peu dans ce tableau, notamment grâce à l’influence de son Gauleiter Julius Streicher : il fut possible aux nazis d’y monter la population contre les Juifs dans certains cas, notamment lors de la nuit de Cristal (9 novembre 1938), qui dans le reste de la Bavière suscita une vague de désapprobation; les SS et les SA ne réussirent guère qu’en Franconie à recruter de simples habitants pour brûler les synagogues, casser les vitrines et arrêter les Juifs avant de les diriger vers des camps. Mais les violences les plus graves avaient eu lieu en mars 1934 à Gunzenhausen où l’agitateur nazi Kurt Bär, lors du dimanche des Rameaux, avait excité la population en prétendant que « les Juifs » avaient tué le Christ. Au printemps de 1935, l’Allemagne entière connut une vague de violences antijuives, qui se traduisit notamment par des échauffourées, fomentées par les SS en toute harmonie avec le ministre de l’Intérieur bavarois, dans le centre de Munich. Cela ne fit que rendre le parti un peu plus impopulaire. Après quoi le mouvement se calma, après l’ interdiction des actions antisémites sauvages par Hitler en août, puis les lois de Nuremberg à la mi-septembre, qui donnaient satisfaction aux antisémites ; enfin, la préparation des Jeux Olympiques fit mettre une sourdine à l’antisémitisme officiel.
Pendant la guerre
Commence alors l’étude de la période de guerre, suivant la même progression : questions économiques, religion, antisémitisme. Les paysans font l’objet de mesures de plus en plus autoritaires, pour les obliger à ravitailler les villes à des prix peu élevés. La désapprobation du régime s’amplifie, peu atténuée par les victoires quand il y en a, mais la passivité politique se maintient. Dans la classe ouvrière, les mesures prises au début de la guerre pour augmenter le temps de travail tout en rabotant les revenus donnent lieu à beaucoup de résistance passive et sont pour l’essentiel rapportées au bout de quelques mois. Les victoires de 1940 tempèrent le mécontentement lié aux pénuries, mais brièvement. Une aggravation du rationnement, en mars 1942, suscite beaucoup de protestations individuelles, que consignent les rapports du SD.Mais alors, comment expliquer l’absence de mouvements révolutionnaires à la fin de la guerre, contrairement à ce qui s’était passé en 1918 ? Par la terreur nazie, en grande partie, mais aussi par la destruction des organisations, la rancune envers les Alliés qui bombardent, la peur des vengeances soviétiques et les vestiges de la popularité de Hitler. L’état d’esprit des couches moyennes, plus difficile à appréhender, témoigne d’une crainte de disparaître, après la guerre ou même pendant, au profit d’une division binaire entre quelques monopoles et une masse de salariés. Fonctionnaires et magistrats souffrent d’être traités en boucs émissaires dans des discours de Hitler ou de Goebbels, et craignent de nouvelles atteintes à leur niveau de vie. Mais si la base sociale du régime se rétrécit, la naissance d’une alternative politique continue de se faire attendre.
Le chapitre 8 expose les répercussions dans l’opinion de l’« ultime affrontement » entre le nazisme et l’Eglise, en 1941. Comme Hitler avait plutôt calmé le jeu au début de la guerre, les nouvelles provocations sont soupçonnées, par Kershaw, d’émaner de la « base ». Le fait que, dans le « sommet », Bormann ait notoirement joué un rôle moteur ne relèverait donc que de lui-même. Tout commence dans l’automne de 1940 avec la fermeture des monastères et la saisie de leurs biens. Au premier semestre de 1941 surviennent toutes sortes de restrictions concernant la presse (interdiction pure et simple des publications religieuses qui subsistaient), l’école (suppression des prières), les crèches (éviction des religieuses), les fêtes (suppression, ou report systématique au dimanche). Mais surtout, la question de l’euthanasie devient brûlante. Hitler avait décidé au début de la guerre de faire mourir massivement les handicapés, notamment ceux qui étaient accueillis dans des asiles, et la consigne était appliquée sans beaucoup d’efforts de dissimulation. L’opposition qui se fait jour, notamment, dans la population chrétienne est, pour la première et unique fois, accompagnée et canalisée par le clergé. Cependant, elle est beaucoup moins forte, notamment en Bavière, que celle qu’occasionne le retrait des crucifix des écoles, décrété par le Gauleiter Adolf Wagner en tant que ministre bavarois de l’Education, le 23 avril 1941. La mesure devait prendre effet à la rentrée de septembre. Aux mouvements hostiles Wagner réagit d’abord en faisant du zèle et en impulsant le retrait des crucifix, puis en donnant le 28 août un ordre secret d’arrêt : il ne fallait pas poursuivre le retrait mais pas non plus remettre en place les symboles déjà enlevés. Cela créa un désordre et un flou propices à une agitation croissante, dans laquelle on vit souvent les femmes en première ligne, soit pour organiser une grève scolaire, soit pour écrire collectivement des lettres informant leurs maris soldats. Finalement presque tous les crucifix conservèrent leur place ou la retrouvèrent. Ce cas rare d’action collective, unique par son intensité, montre qu’il était possible de protester sous cette dictature, mais aussi que les chrétiens se mobilisaient essentiellement, voire uniquement, sur des sujets religieux ; le reste de la politique, ils ne se contentaient pas toujours de le subir, ils pouvaient aussi l’approuver bruyamment : ainsi bon nombre de protestataires, tant sur l’euthanasie que sur les crucifix, clamaient leur soutien à la « croisade » contre l’URSS. A commencer par Mgr Von Galen, l’évêque de Münster, qui avait prononcé contre l’euthanasie de courageux et décisifs sermons dans l’été de 1941.
La solution finale
Le dernier chapitre aborde la question des réactions de l’opinion devant la Solution finale. Il restait 10 000 Juifs en Bavière au début de la guerre, essentiellement dans quatre villes, Munich, Nuremberg, Augsbourg et Wurtzbourg. Une loi du 30 avril 1939 avait interdit les immeubles « mixtes », forçant les Juifs à se regrouper dans des bâtiments qui leur seraient propres : cela aboutissait à la création d’autant de petits ghettos, faciles à surveiller et à isoler. Quant à l’étoile jaune, elle fut instaurée et rendue obligatoire en septembre 1941. Les déportations vers les camps de l’est, dont presque personne ne revint, touchèrent 8376 personnes, essentiellement de novembre 1941 à septembre 1943. Les réactions de la population sont difficiles à connaître, car celles que les rapports du SD enregistrent vont de l’approbation à l’enthousiasme, en passant par l’idée qu’il faudrait faire plus et mieux. On peut en conclure que les opposants se taisaient, par crainte et désarroi, mais aussi que l’indifférence dominait. Les occasions de rencontrer les Juifs se raréfiaient et on les oubliait purement et simplement : « loin des yeux, loin du cœur », écrit Kershaw en reprenant le proverbe français, dans son introduction de 1995, pour résumer la question. Cependant, des bruits généraux sur le sort terrible des Juifs se mirent à courir et lors des bombardements aériens quelques habitants commentèrent que c’était une vengeance des Juifs… ce qui indiquait peut-être une désapprobation envers le régime mais aussi une adhésion à sa logique.
Ce classique reste d’une lecture utile, pour prendre connaissance de l’état d’esprit d’une région sous la dictature nazie, comme pour réfléchir sur les difficultés d’une telle recherche. Kershawdéclare en 1995 qu’il a songé à le réécrire et ne l’écrirait plus de même… sans dire ce qui, à son avis, mérite correction ou complément. Peut-être, en ce temps où il a entrepris sa grande biographie de Hitler, songe-t-il que le chef suprême est ici un peu absent. C’est en tout cas la principale lacune qu’on peut relever dans ce livre. Ian Kershaw est alors (en 1983, lors de lapremière édition) dans sa période purement fonctionnaliste, même si, on l’a vu, il lui arrive de prendre des distances avec Broszat, le fondateur de cette école. Le fonctionnalisme consiste à peindre le nazisme comme un bateau fou, où toute décision résulte de rapports de forces plutôt que d’un calcul. Ici, on a souvent l’impression que les gens se laissent mener par les nazis alors qu’il suffirait qu’ils se rebellent pour obtenir de grands changements. On en oublie qu’il s’agit d’une dictature, et des plus personnelles. Il siérait par exemple de se demander si les mouvements de protestation, dont l’auteur ne cesse de dire qu’ils se produisent dans des domaines limités et secondaires, ne sont pas des soupapes destinées à canaliser le mécontentement dans ces domaines, en même temps qu’à observer ce mécontentement et ses limites. La question vaut notamment pour l’affaire des crucifix, en 1941. Il n’est pas très prudent de décréter qu’elle part de la « base » et de faire du pauvre Adolf Wagner l’auteur de cette balourdise qu’encouragerait, dans le gouvernement national, le seul Bormann. Il y a eu des ballons d’essai, çà et là, en 1935-36 : Hitler, qui disserte beaucoup sur le catholicisme dans ses propos de table en 1941, dispose là d’une expérience ; il sait comment des communautés chrétiennes de Bavière réagissent à la suppression des symboles religieux : elles exigent leur rétablissement, tout en réaffirmant leur adhésion aux grands objectifs du régime. C’est exactement ce dont il a besoin en cet avril 1941 où il s’apprête à jouer le tout pour le tout en URSS. Il provoque la communauté catholique de Bavière qui est, Kershaw a raison de le dire, l’un des secteurs de la société allemande les plus réfractaires à son idéologie et les plus capables d’y réagir collectivement. Cette provocation sur un sujet marginal, réversible à tout moment en faisant croire qu’il s’agit de l’initiative maladroite d’un subordonné, est une belle occasion de faire surgir un mécontentement de part en part maîtrisé, afin d’identifier des meneurs, de mesurer l’état d’esprit des masses et d’obtenir des manifestations de soutien à sa politique globale. De même l’agitation antijuive de mai 1934 à Gunzenhausen, permet d’une part de tâter le terrain et, d’autre part, en désavouant le SA Kurt Bär, de créer une ambiance propice à la très prochaine nuit des Longs couteaux.
L’introduction de 1995 est à recommander spécialement pour ses informations et ses réflexions sur la notion de « résistance ». Broszat avait mis à l’honneur le terme de Resistenz pour désigner tout ce qui, dans la société allemande, ne se pliait pas aux canons nazis et réserver la notion de résistance (Widerstand) aux mouvements organisés, très minoritaires. Kershaw n’avait pas repris l’idée et il emploie tout au long du livre le terme de « dissension » pour désigner les mouvements protestataires ou les manifestations de mécontentement.
Comme trop souvent le traducteur, sans doute excellent sur le plan linguistique, ne fait pas assez d’efforts pour le vocabulaire spécialisé –et l’édition de poche aurait pu et dû être revue au moins sur ce plan puisque le succès de la première édition a probablement donné lieu au moins à quelques signalements. A l’Eglise « confessionnelle » signalée ci-dessus on peut ajouter ces « militants laïques » de la page 324 qui ne sont pas des anticléricaux mais, tout au contraire, ce qu’on appelle chez les catholiques des laïcs, c’est-à-dire des baptisés qui ne sont pas prêtres.